Dossier cinéma - Les années quatre-vingt (1980-1989)
Cinéma / Dossier - écrit par iscarioth, le 21/08/2006
On parle beaucoup de la mort du cinéma. Celle-ci serait annoncée par la fracassante arrivée de la vidéocassette. Les chiffres prouvent qu'en effet le cinéma semble, un peu partout dans le monde, agoniser. Deux exceptions majeures. La France, qui, au milieu de l'apocalypse, semble vivre un paradoxal âge d'or, et les Etats-Unis qui s'imposent comme le premier "fournisseur filmique" mondial. Finalement, on constate à la fin des années quatre-vingt que le cinéma doit faire avec la télé, et pas contre. Créativité et production vont au cinéma, la télévision se charge de la diffusion. Une formule à posteriori évidente mais qui se prêtait difficilement à la panique des années 70-80.
Aux Etats-Unis, le cinéma est depuis le début une industrie, au même titre que l'automobile ou l'agro-alimentaire. Du commencement jusqu'aux années soixante, c'est l'âge d'or, l'âge des nababs, pendant lequel Hollywood est une affaire de famille. Suite au déferlement télévisuel, le cinéma change. Dans les années soixante-dix, le cinéma américain traverse une crise. Humiliés au Vietnam, les Etats-Unis sont rentrés en récession et leur idéal dépérit. Cet idéal, ce sens du mythe, de la grandeur, de l'héroïsme, constituait l'essence du cinéma hollywoodien jusqu'à cet ébranlement. En conséquence, le virage va se faire sentir pendant ces années quatre-vingt. Les studios sont rachetés par des multinationales dont les activités s'étendent jusqu'au pétrole, l'immobilier ou la restauration rapide. Changeant de main, le cinéma passe sous le contrôle des "vrais" industriels. La production approfondie ses réflexes de rentabilité, elle se standardise. On ne prend plus de risques : le cinéma américain investit dans les recettes éprouvées, des films dont le succès commercial est imparable (continuation des genres au passé glorieux, films « à la manière de... », remakes, émergence du film d'action...) La dimension artistique du Cinématographe s'atténue. On reproduit ce qui se vend le mieux (de nombreuses séquelles pour des franchises qui amènent du monde en salle : Halloween, Rocky, Psychose, Alien, Star Wars...). Mais même en pleine hégémonie économique, les cinémas américains des années quatre-vingt semblent malades. Depuis la mort des ancêtres, courant des années 1970, ce cinéma, qui s'est toujours illustré par sa capacité à refléter avec lucidité les malaises de sa civilisation, n'offre plus grand-chose d'autre au monde que des films bas de gamme, académiques, sans saveur, dans l'incapacité d'innover. Symptomatique est, à cet égard, l'évolution de la carrière de Sydney Pollack. Cinéaste prometteur dans les années soixante-dix (Jeremiah Johnson), il se fourvoie par la suite auprès de la plupart des cinéphiles avec des productions superficielles (Out of Africa). Les années quatre-vingt, à l'image de Spielberg, multiplient les explosions du box office, préfigurant la « blockbuster mania » qui va déferler lors des années quatre-vingt-dix.
En Europe, la chute de l'industrie du Cinéma est on ne peut plus évidente. De 1970 à 1985, la Grande Bretagne voit sa production de longs métrages passer de 80 à 38, le taux de fréquentation de ses salles passer de 193 à 37 millions. L'Allemagne de l'ouest, toujours dans le même temps, voit sa production passer de 113 à 40 longs métrages par an ! Mais les chiffres les plus fous nous viennent d'Italie. De 1970 à 1985, la production de la péninsule passe de 230 à 90 longs métrages avant de remonter péniblement, grâce aux aides de l'état, à 120 en 1990. Alarmiste, l'italien Dino Risi émet un diagnostique sans appel : « On assiste à la fin d'une époque. Le cinéma est entré dans un coma profond, les jeunes auteurs ne travaillent plus que pour les festivaliers, puisque leurs films n'arrivent pas dans les salles ».
La France, elle, pendant les années quatre-vingt, fait plutôt figure d'exception. Comparé à ses voisins en chute libre, le cinéma français va bien (138 films produits en 1970, 136 en 1990). Mais, même si la France est le pays qui souffre le moins, elle est quand même atteinte par le phénomène, dans une certaine mesure. On passe de 200 millions de spectateurs en 1968 pour 125 en 1994. Sur cette courbe, une renaissance est entamée, lors des années 1980. La France est en forme, elle présente une Nouvelle Vague toujours active (Godard : Sauve qui peut la vie, Rohmer : Pauline à la plage, Bresson : L'Argent, Varda : Sans toit ni loi), de nouvelles stars (Pierre Arditi, Michel Serrault, Sabine Azema, Béatrice Dalle...), un renouvellement toujours effectif (Luc Besson, Jean-Jacques Annaud, Jean-Jacques Beineix...).
Ces évolutions à la baisse, soutenues et assénées à grand coup de chiffres, raisonnent comme des sentences apocalyptiques. Mais la chute de la fréquentation et la baisse de régime du cinéma ne tombent pas du ciel. Tout ceci est le résultat des évolutions techniques. La télévision enlève aux salles ses spectateurs, des chaînes comme Canal Plus se spécialisent dans le septième art, le magnétoscope permet une projection ad libitum... Des évolutions majeures qui changent la façon de "consommer" le cinéma. Le septième art semble donc emprunter les chemins de la mutation et pas ceux de la perdition. Daniel Toscan du Plantier, professionnel du Cinéma qui a travaillé pour Gaumont déclare : « Le cinéma n'a jamais été aussi demandé. Il y a une crise de l'exploitation en salle, pas de la consommation. Quand comprendra-t-on que le cinéma, ce ne sont pas des fauteuils, mais des images ? » Face à cette polémique qui enfle au sujet de la mort du cinéma, un autre monsieur prend position. Terminons cette introduction avec la sérénité objective de Luc Béraud dont les paroles semblent, avec le bénéfice du recul, être celles les plus emplies de bon sens : « La crise du cinéma est une expression qui doit dater de son invention, ou presque. C'est un art neuf, en perpétuelle mutation. Après la lumière artificielle, le parlant, la couleur, etc., il doit maintenant se définir en face de la télévision et des différents supports audiovisuels. L'industrie du cinéma a su s'adapter jusqu'ici à toutes les nouvelles craintes qu'elle a rencontrée, elle saura survivre à la télévision, le tout est de lui donner les moyens de lutter et le souffle pour tenir ».
Deux des films les plus marquants du cru 1980 nous viennent d'Angleterre. Il s'agit de The Shining de Stanley Kubrick et de Elephant Man de David Lynch.
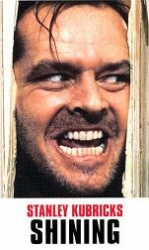
Cinq ans après Barry Lyndon, Kubrick présente l'adaptation d'un roman d'épouvante de Stephen King. Le film raconte l'histoire d'un écrivain qui accepte de garder un hôtel durant la saison morte, avec sa famille. Peu à peu, cet écrivain, incarné par Jack Nicholson, va devenir fou. Ce film, dit "d'horreur" brasse intelligemment de nombreux thèmes caractéristiques du fantastique : spectres, visions, folie, disparitions, apparitions, labyrinthes, télépathie, etc. Au-delà des thèmes choisis, la terreur et l'angoisse générées par le film sont essentiellement dues au talent de Stanley Kubrick, très novateur et faisant preuve de grosses qualités de réalisation. Kubrick innove en effet avec les longs travellings de Shining : il invente le stabilisateur d'épaule (la caméra est sanglée à l'opérateur, ce qui permet d'obtenir une image nette et sans à-coups). Il utilise aussi la Steadicam (il n'invente pas ce procédé, mais cette technique était toute récente à l'époque). Très perfectionniste, Kubrick ira jusqu'à tourner 187 prises pour la scène de l'escalier (un record). L'utilisation judicieuse des plans fixes et des champs/contre-champ viennent renforcer la très pesante atmosphère du film. Le Shining de Kubrick diverge assez du Shining originel, signé King. Le film est plus construit autour du personnage de Jack (Nicholson) qu'autour de celui de Danny (Lloyd), l'enfant, à l'inverse du roman.

Autre film à succès provenant de Grande-Bretagne, Elephant Man de David Lynch. Mel Brooks, producteur du film et grand admirateur d'Eraserhead, a dû se battre pour imposer sa décision de mettre Lynch aux commandes du projet. Elephant Man est le film qui sort David Lynch du carcan underground pour l'imposer aux yeux du monde entier comme l'un des plus grands réalisateurs américains de sa génération. Pour ce film grand public, le réalisateur a dû mettre de coté cette esthétique filmique si caractéristique, qui a déconcerté, avec Eraserhead, pour oeuvrer sur un film à ossature plus classique, pour un public très large. Soutenu à 100% par Mel Brooks, David Lynch parvient tout de même à faire revivre son esthétique si particulière, le temps de quelques séquences. Par exemple, l'onirisme, au début du film, d'une mère piétiné par un éléphant. Quelques images très marquées par le style du réalisateur, que Brooks a contribué à sauver face à une Paramount qui voyait cette ébauche esthétique d'un très mauvais oeil. Car ceux qui ont pu voir Eraserhead le savent, l'univers lynchien contraste très largement avec le style huilé attendu par la plupart des grosses maisons de production. Eraserhead et Elephant Man sont donc des films plutôt opposés. Dans le premier film de Lynch, le héros et son bébé deviennent au fil du récit de plus en plus monstrueux. C'est une véritable descente aux enfers. Avec Elephant Man, le regard du spectateur sur John Merrick, l'homme éléphant, s'adoucit de plus en plus, jusqu'à devenir sympathique puis compatissant, lors de l'explosion finale (« Je ne suis pas un animal, je suis un être humain »). Alors qu'Eraserhead visait un public averti, adepte du fantastique, Elephant Man est un film à portée universelle, transmettant des valeurs comme la tolérance et le respect de l'autre. Le thème de la monstruosité et de la différence n'a été abordé, aussi directement, auparavant, qu'avec Freaks de Tod Browning en 1932. A la différence de Browning, Lynch ne livre pas un pamphlet aux propos acerbes mais arrive à ses fins avec sérénité. L'apport de Lynch au cinéma, avec ce film, sur un plan dramatique, visuel et émotionnel est considérable. Dans un noir et blanc sublime, Lynch reconstitue pour ce film d'époque l'Angleterre victorienne (l'histoire de John Merrick s'inspire de faits réels) dans toute sa cruauté et son snobisme. La photographie de Freddie Francis est remarquée, tout comme la performance de John Hurt et d'Anthony Hopkins dans leurs rôles respectifs. Elephant Man remporte le Grand Prix du Festival d'Avoriaz en 1981, fait plus de deux millions d'entrées en France et est nominé par six fois aux Oscars. Malheureusement, le film n'en obtient aucun, Ordinary people de Robert Redford raflant les principales statuettes. Le lendemain de la cérémonie des Academy Awards, Mel Brooks déclare : « Dans dix ans, Ordinary People sera au mieux une réponse au Trivial Pursuit. Alors que Elephant man restera un film à voir ».

Akira KurosawaEn cette année 1980, deux cinéastes très différents mais tous deux très reconnus pour leur talent, se partagent la palme d'or. Il s'agit de Akira Kurosawa, pour son film Kagemusha et de Bob Fosse pour sa dernière grande comédie musicale : Que le spectacle commence. Kagemusha traite des guerres féodales qui déchirent le Japon du 16ème siècle. Le chef du clan Takeda, Shingen, a besoin d'un sosie pour le seconder dans les moments délicats. Un voleur, ressemblant étroitement au seigneur, va être trouvé. Avec ce film, ce qui intéresse Kurosawa, réputé pour son antimilitarisme, ce ne sont pas les batailles et la stratégie militaire. L'empereur du cinéma japonais va livrer un film à forte portée humaine, voir psychologique, posant des questions sur l'identité : quelqu'un qui me ressemble physiquement peut prendre ma place, malgré les différences de personnalité, de langage et de culture ? Jusqu'où l'identification du double à son maître peut-elle aller ?
En 1985, toujours dans cette même optique temporelle de guerre féodale dans le Japon du 16ème, Kurosawa transpose la tragédie shakespearienne du Roi Lear dans son film Ran. Dans la continuité de Kagemusha, le réalisateur japonais réédite la thématique du pouvoir, de l'aliénation, de l'individu, en emmenant son héros jusque dans la folie profonde.

Cannes témoigne son affection pour un ancien de la Nouvelle Vague, en cette année 1980. Alain Resnais est récompensé du prix du jury pour son film Mon oncle d'Amérique. Godard, de son côté, fait son come-back après des années de militantisme, avec son film Sauve qui peut (la vie). Le réalisateur revient au cinéma de fiction. Il présente d'ailleurs explicitement son film comme « un second premier film ». Un troisième film, peut-être le plus marquant, illustre ce retour en force des "anciens" de la Nouvelle Vague, en ce début de décennie. Le Dernier métro, vingtième long métrage de François Truffaut, relate de la vie d'un théâtre parisien sous l'Occupation. Le metteur en scène, juif, dirige la pièce du sous-sol en communicant avec sa femme. Celle-ci, incarnée par Catherine Deneuve, tombe peu à peu amoureuse d'un acteur qui fait ses débuts dans le théâtre parisien (Gérard Depardieu). « En écrivant, avec Suzanne Schiffman, le scénario du Dernier Métro, mon intention était de faire pour le théâtre ce que j'avais fait pour le cinéma avec La Nuit américaine : la chronique d'une troupe au travail, dans un cadre respectant les unités de lieu, de temps et d'action. Il y avait, entre les deux projets, une différence notable, c'est que ma connaissance du théâtre est superficielle et que, de toute manière, le montage d'une pièce est beaucoup moins riche, visuellement, qu'un tournage de film. » raconte Truffaut. Très impressionné par le travail de Marcel Ophuls pour le Chagrin et la Pitié, Truffaut nourrissait depuis longtemps le désir de faire un film sur l'Occupation, la période pendant laquelle il a vécu enfant. A posteriori, en 1984, Truffaut évoque ses intentions profondes dans un numéro de L'Avant-scène : « un film sur l'Occupation devrait se dérouler presque entièrement la nuit et dans des lieux clos, il devrait restituer l'époque par de l'obscurité, de la claustration, de la frustration, de la précarité et, seul élément lumineux, il devrait inclure, dans leur enregistrement original, quelques-unes des chansons qu'on entendait alors dans les rues et les postes de TSF ». Le dernier métro est très remarqué en 1981, lors de la tenue de la sixième cérémonie des Césars. Le film y reçoit six récompenses : meilleur film de l'année, meilleur réalisateur, meilleure actrice (Deneuve), meilleur acteur (Depardieu), meilleure musique de film (Georges Delerue). Un succès sans précédent dans la toute jeune histoire du Festival qui installe le film de Truffaut au top de l'historique palmarès de l'événement parisien.

RoboCopEn 1980 sort en salle un film qui connaît un bon succès, à la surprise générale. Il s'agit de Vendredi 13 de Sean S. Cunningham. C'est l'occasion de revenir sur le parcours vers la légitimation d'un sous-genre. Après la banalisation de l'érotisme dans la production cinématographique au niveau mondial, courant des années soixante-dix, c'est à un autre genre, jusque là parqué dans le ghetto des salles spécialisées, d'émerger et de se fondre dans le cinéma populaire. Les années quatre-vingt présentent l'émergence du genre gore sur grand écran. Le cinéma gore est souvent un cinéma dont l'histoire n'est que prétexte aux éviscérations, énucléations, décapitations, éventrements et autres démembrements sanguinolents. C'est un cinéma spécialisé, un sous-genre réservé à un public d'affectionados. Les années quatre-vingt marquent la dilution de ce genre très underground dans le cinéma dit "populaire". Trois chemins majeurs vont permettre au genre d'émerger. Tout d'abord, l'humour noir. Bien des productions gores du début des années quatre-vingt connaissent un bon succès en salle grâce à un scénario humoristique (Le Loup garou de Londres de Landis en 1981 et Creepshow de Romero en 1982). D'autres films de ces années-là, aux effets gores apparents bien que soft, bénéficient d'une grosse distribution et d'un bon casting pour les mettre sur la voie d'un succès commercial (Vendredi 13 de Cunningham en 1980). Mais la voie d'insertion la plus importante du genre gore vers le cinéma grand public est très certainement la "dilution". Beaucoup de films des années 1980 incorporent des effets gores, sans êtres conçus de bout en bout pour une exhibition de matières sanguinolentes. On passe du "cinéma gore" au "gore au cinéma". De nombreux exemples : Scarface de De Palma en 1983, Robocop de Verhoeven en 1987, Sailor et Lula, de Lynch, en 1990... A l'instar de l'érotique, qui est venu dépoussiérer le cinéma d'une mentalité frileuse marquée par les tabous, le gore, cherchant à dégoûter et à provoquer le spectateur, a permis d'installer au cinéma la vue du sang, chose restée extrêmement délicate jusque dans les années soixante-dix (le scandale Bonnie and Clyde de 1968 en est la preuve).

La sortie de La Guerre du Feu, en 1981, est un événement marquant pour le cinéma français. Tout d'abord, le film révèle au monde l'auteur de Noirs et blancs en couleur et de Coup de tête : Jean-Jacques Annaud. Ensuite, cette composition se distingue par son originalité et par sa force. Librement adaptée par Jean-Jacques Annaud et Gérard Brach du livre de J-H Rosny, alias Boex (1856-1940), le célèbre auteur de romans préhistoriques, La Guerre du feu raconte l'histoire de trois membres d'une tribu qui partent en quête du feu, élément nécessaire à la survie du groupe. Les adaptations filmiques des romans de Rosny étaient jusqu'alors prétexte à des débordements fantaisistes, misant sur le spectaculaire avec des affrontements entre tribus primitives et animaux monstrueux. Annaud a eu l'intelligence de miser sur la crédibilité ethnologique. Il s'est entouré, pour parvenir à ce résultat, de deux spécialistes de l'ère préhistorique : Desmond Horris et Anthony Burgess. Ce dernier a inventé une langue rudimentaire, sans valeur scientifique, mais suffisante pour en rajouter à la crédibilité du film. Si ces hommes préhistoriques s'étaient exprimés dans une langue connue, toute la crédibilité du film en aurait pâti et la production aurait eu vite fait de tourner à la parodie. L'utilisation de cette langue primitive et inconnue dans les rares dialogues du film accentue la pesanteur dramatique de l'oeuvre et laisse le spectateur à même de déceler les premières bribes de sentiment humain. La Guerre du Feu est une monstrueuse reconstitution qui a coûté près de 12 millions de dollars, une expérience inédite (le déguisement des éléphants en mammouth) au coeur de laquelle les acteurs sont aussi à saluer : Everett McGill, Ron Perlman, Nicholas Kadi et Rae Dawn Chong tenant les rôles principaux.

Toujours en France et en 1981, après les grands débuts d'Annaud sur un projet de grande envergure, nous assistons à la sortie du premier film d'un autre Jean-Jacques : Beineix. Jusqu'alors assistant réalisateurs sur différents projets, Beineix compose avec Diva sa première réalisation personnelle et son premier succès. Le film, par sa forme très inhabituelle, ne laisse personne indifférent. Il s'agit d'un polar, tourné autour du personnage d'un postier, mêlé à une sombre histoire d'enregistrements pirates. Avec ce film, Beineix lance un nouveau courant esthétique et filmique, consistant à privilégier l'image, les décors à la mode, les couleurs volontairement superficielles, plutôt que la vraisemblance. Il s'attache au pittoresque des personnages. Pour faire plus simple et plus court, on peut dire que plus de place est accordée à la forme et au style qu'à l'intrigue et au sens. Un élan remarqué en face duquel on évoque des prédécesseurs prestigieux tels Magritte, les surréalistes et les hyperréalistes, les baroques, Verdi, Raymond Chandler... « Du culot, de l'audace, de l'anticonformisme, du tempérament, du talent ! » s'exclame alors José Bescos. Une façon de styliser le réel qui n'est donc pas passé inaperçu et qui a même fait école. Toute une génération de cinéphiles et de cinéastes se retrouve dans le maniérisme de Diva qui rompt avec le naturalisme rampant du cinéma français. Avec Diva, Beineix inaugure un mouvement que l'on a appelé à posteriori « les nouvelles images » et ouvre la voie à deux principaux réalisateurs : Luc Besson (Le Grand Bleu, 1988) et Leos Carax (Les amants du pont neuf, 1991).

Après s'être frotté au film catastrophe (Les dents de la mer, 1975) et au film de science-fiction (Rencontres du troisième type, 1977), Steven Spielberg pose son regard réformateur sur le film d'aventure. Les Aventuriers de l'Arche Perdue (Raiders of the Lost Ark) ressuscite la grandiloquence du film d'aventure hollywoodien d'antan. Le slogan publicitaire du film parle de lui-même : « Le Retour de la Grande Aventure ». De folles péripéties, un mélange efficace d'action pure et de comédie, un tournage à grand coup d'effets spéciaux, de cascadeurs et de pyrotechniciens pour un film phare du cinéma dit "de divertissement". C'est précisément ce que la plupart des critiques reprochent à Spielberg. Le jeune cinéaste est déjà vu comme une extraordinaire machine à fabriquer du spectacle, quelqu'un au cinéma peu crédible sur le plan artistique, aux films lénifiants et dépourvus d'esprit critique. Début des années 1980, le nom de Spielberg est déjà associé, dans certaines bouches, aux dollars, au marketing et à l'infantilisme niais. Quoiqu'il en soit, Les Aventuriers de l'Arche Perdue est très chaleureusement accueilli par le public, dans le monde entier et le personnage d'Indiana Jones devient en peu de temps une légende. Voilà qui concrétise au sommet la carrière et la popularité d'Harrison Ford, déjà bien avancées par le rôle de Han Solo dans Star Wars. Et ce n'est pas par hasard que l'on retrouve dans le rôle principal des "Aventuriers" l'un des personnages principaux de La Guerre des Etoiles : George Lucas produit ce nouveau film de Spielberg. Même si Les Aventuriers de l'Arche Perdue est un film essentiellement basé sur une imagerie rêveuse, grandiose, voire enfantine, le film repose tout de même sur une certaine trame scénaristique, mais celle-ci reste très superficielle et manichéenne. Il est question de recherches archéologiques commanditées par Hitler à la veille de l'explosion de 1939. L'aventurier américain, Indy, personnage au fouet qui ne sort son arme que pour se défendre en cas d'absolu nécessité, doit faire face aux « méchants nazis » sur fond d'Arabie des contes de fée. Deux suites sont tournées : Indiana Jones et le temple maudit en 1984 et Indiana Jones et la dernière croisade en 1989.

Le succès des Aventuriers est assez impressionnant : environ 390 millions de dollars de recettes dans le monde entier, plus de 6 millions d'entrées en France. Le succès du film E.T., l'année suivante, est encore plus ahurissant. Sorti dans un peu plus de mille salles aux Etats-Unis, E.T. the Extra-Terrestrial totalise en seulement trois jours d'exploitation une recette de douze millions de dollars ! L'énorme battage publicitaire entourant la sortie du film n'a pas ménagé ses effets. En France, le film brasse sept millions de francs de recette le premier week-end et fait la une des journaux Le Monde et Libération. Le marchandising accompagnant la sortie du film est d'une ampleur incroyable. En un mois se vendent 500 000 exemplaires de gadgets à l'effigie de E.T.. Le film est, dès sa sortie, l'un des événements majeurs de la décennie. En apprenant que le créateur de Rencontres du troisième type se lançait à nouveau dans un projet d'extra-terrestre, le public s'attendait à une fresque très riche en effets spéciaux, avec des aliens immondes et agressifs. Là encore, comme précédemment, Spielberg brouille les pistes et surprend. Le réalisateur prend tout le monde au dépourvu en mettant en scène l'histoire d'un extra-terrestre fragile, bon, intelligent, émotif et attendrissant, et ce, sans overdose d'effets techniques spectaculaires. Le film raconte l'histoire d'amitié entre E.T. et le petit Elliot, il oppose le monde innocent de l'enfance et la cruauté adulte (arrogance du monde scientifique, bureaucratie bornée, comportements hypocrites et ambigus). L'enfance dans toute la splendeur de son innocence, un des thèmes de prédilection de Spielberg qui témoigne à propos de ses jeunes acteurs : « Ce que j'aime obtenir d'eux, c'est ça : la magie qu'ils apportent spontanément à un film... si on leur laisse une grande liberté, et si on leur permet de développer leurs inventions, leurs erreurs, leurs instincts, leur naturel... ». La marionnette articulée a été élaborée par l'italien Carlo Rambaldi. Celle-ci est activée par le nain Pat Bilon, de l'intérieur, pour certaines scènes. Le mime Caprice Roth s'est occupé de la gestuelle de l'extra-terrestre et la voix de E.T., dans la version originale a été obtenue par l'enregistrement de sons rauques émis par Pat Welsh mixés à des effets vocaux spéciaux de Debra Winger.

Être à la base d'une révolution n'aura pas suffi à Ridley Scott. Après avoir signé Alien, un film dont on connaît l'incroyable portée sur le monde de la SF, le réalisateur britannique ébranle une deuxième fois l'univers du fantastique avec Blade Runner. Début des années 2000, les journalistes d'une revue spécialisée en technologie, Wired, ont décidé de lister les 20 meilleurs films de science-fiction existants. Ils les ont jugés selon des critères très sérieux et Blade Runner, le film de Scott, arrive en tête devant Gattaca et Matrix. C'est dire toute l'importance de ce film dans l'histoire de la SF. A l'image d'oeuvres telles que 2001, Odyssée de l'espace ou Metropolis (les similitudes entre le film de Lang et celui de Scott ne manquent pas), le film de Ridley Scott n'est pas qu'une simple mise en scène fantastique, il s'interroge sur le probité de valeurs telles que le bien et le mal et pose des questions sur le devenir de l'humanité. Scott dépeint, avec Blade Runner, un Los Angeles du futur, perdu dans les brumes, dans lequel une marée humaine lutte pour un peu d'oxygène. Basé sur le roman Do Androids Dream of Electric Sheep (1968) de Philip K. Dick, le film de Scott est à la fois un film noir, un film de science-fiction et un drame. Blade Runner est un film noir à la fois dans son esthétique et dans sa thématique. Visuellement, le film noir, comme son nom l'indique, présuppose une atmosphère sombre et lugubre. Blade Runner est un film qui évolue lors de nuits pluvieuses dans une ville, Los Angeles, totalement dépourvue de végétation. Les nombreux faisceaux lumineux qui envahissent les rues et les résidences de l'univers de Ridley Scott créent une atmosphère lourde de claustrophobie et d'angoisses. Le personnage principal du film, Deckard, a tout du héros de film noir : le détective, policier, justicier quelconque, qui souffre toujours de désenchantement profond, souvent accompagné de vices tels l'alcoolisme. Les costumes des deux personnages principaux renvoient aussi aux années quarante, âge d'or du film noir. Bref, Blade Runner est un film noir déplacé dans l'univers de la science-fiction qui met en scène de veilles technologies pour donner l'impression d'un futur décadent.

Fanny & Alexandre est un film important. Premièrement,il marque la fin de la carrière d'Ingmar Bergman pour le grand écran. Deuxièmement, ce film met en relief l'oeuvre complète du suédois : une sorte de point d'orgue. Bergman affiche clairement sa décision, à la sortie du film, en 1982 : « Après Fanny et Alexandre, je ne ferai plus de longs métrages. Je ne me suis jamais autant amusé et je n'ai jamais autant travaillé. Fanny et Alexandre représente la somme totale de ma vie en tant que réalisateur. Les longs métrages sont pour les jeunes, à la fois physiquement et mentalement. Si j'écris encore, quelqu'un d'autre mettra en scène. Mais je n'ai rien contre la réalisation pour la télévision. Disons soixante minutes, pas plus. Ou, pourquoi pas, l'opéra ». Le cinéaste tiendra parole et Fanny et Alexandre est l'oeuvre qui conclut la filmographie du suédois en tant que réalisateur. Il confiera plusieurs projets à des réalisateurs comme Bille August. Fanny et Alexandre est aussi très marquant, second point, parce que très autobiographique, en ce sens où il est directement mis en rapport avec l'expérience personnelle et artistique de Bergman. Alexandre est un personnage nourri par les souvenirs d'enfance d'Ingmar Bergman. Mais, bien au-delà de ces souvenirs, c'est de l'oeuvre (gigantesque, environ 65 films réalisés) du cinéaste qu'il s'agit. Fanny et Alexandre est une espèce de rétrospective faisant référence aux nombreux films antérieurs de Bergman, compilant les personnages, lieux, décors, thèmes et fantasmes qui ont nourri l'oeuvre du plus grand des réalisateurs suédois.
Toujours accompagné de son fidèle Klaus Kinski, Werner Herzog présente en 1982 le film Fitzcarraldo. L'histoire d'un aventurier qui veut construire un opéra en plein coeur de la forêt L'homme ira jusqu'à sacrifier fortune et raison pour réaliser son rêve. On retrouve les traits du héros classique chez Herzog : un rebelle qui, pour réaliser ses rêves, pousse ses capacités à l'extrême limite. La folie, le rêve, la démesure... C'est un peu l'atmosphère du tournage... Certains films ont une malheureuse réputation et l'on parle plus d'eux en évoquant les péripéties du tournage plutôt qu'en dissertant sur leur contenu (souvenez vous de Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz). C'est malheureusement le cas du film de Herzog, Fitzcarraldo. Ce film, qui tient comme thèmes principaux l'échec et la démesure a subi d'innombrables revers : abandon du tournage de nombreux acteurs, hostilité de certains indiens, difficultés climatiques, problèmes financiers...
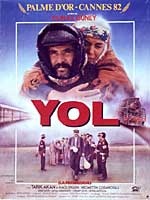
En 1982, la palme d'or cannoise est remise à deux films de dénonciation politique. Missing de Costa-Gavras et Yol de Yilmaz Güney. Le film de ce dernier suit cinq prisonniers en permission dans une Turquie hivernale. Un cinéma de l'émotion, un film tourné à distance par Güney, emprisonné pour délit d'opinion. Le film constitue un hommage vibrant au peuple turc, en dépit des pressions quotidiennes exercées par la politique et la religion. « Dans Yol, j'ai voulu montrer combien la Turquie était devenue une immense prison semi-ouverte. Tous les citoyens y sont détenus » témoigne le réalisateur. Le film contient en effet, cette symbolique forte. Une fois sorti de prison, chacun des cinq détenus en permission entrera dans une autre prison, plus vaste et imagée. La réalisation vient souvent renforcer cette impression. Le cadre est généralement très serré autour du personnage. Güney est d'ailleurs un cinéaste à la réalisation beaucoup plus descriptive que narrative. Le réalisateur turc refuse l'explicatif, le psychologique, il le dit lui-même : « Le cinéma, c'est l'illisible. »
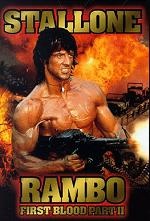
Après la crise identitaire du cinéma américain, courant des années soixante-dix, suite au traumatisme de la guerre du Vietnam, les Etats-Unis s'inventent de nouveaux héros. Au box-office, en 1982, triomphent dans les salles américaines deux films : First Blood (Rambo) de Ted Kotcheff et Conan le barbare de John Milius. Un sommet très symbolique, puisque Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger sont les deux figures emblématiques du film d'action hollywoodien des années 1980. L'Amérique s'est en effet trouvé une nouvelle race de héros. Cassant assez largement d'avec les héros traditionnels américains de l'époque western (ces fameux good badman qui jouaient au teigneux mais faisaient le bien), ces nouveaux héros sont des Hercule modernes, très musclés et brutaux, écrasant tout ce qui peut se trouver en travers de leur chemin avec une cruauté qui égale celle de leurs ennemis. Ces héros nourrissent des ambitions toutes personnelles et luttent impitoyablement pour leur survie ou pour arriver à leurs fins (Conan le barbare nourrit dès l'enfance, le désir de venger ses parents, Rambo s'extirpe des griffes des policiers dans le premier volet de la trilogie). Le film d'action est à ses débuts assorti d'un lourd message politique, épousant la politique farouchement anticommuniste de Reagan (Rambo corrigeant l'histoire dans Rambo II : la Mission, 1985). Mais le genre évolue vite vers le très strictement aseptisé et stéréotypé. Le film d'action ne laisse aucune place au rêve et à la réflexion. Le but ultime est, un peu comme pour le film publicitaire, d'en mettre plein la vue au spectateur. Tous les moyens sont bons : effets spéciaux spectaculaires, des scènes d'action et de fusillade en abondance, des couleurs vives, un montage furtif, une musique explosive... On ne donne pas l'occasion au spectateur de réfléchir sur le bien fondé de la quête du héros, sur la tangibilité de son but, sur la justesse de ses manières. Tout est fait pour que le comportement du héros soit vu comme légitime, allant de soi... Formule oblige, le genre se montre assez prolifique en nanars et navets.

Du côté de l'hexagone, le film le plus explosif de cette année 1983 est certainement L'Argent de Robert Bresson. Le film divise à Cannes critiques et public. Après la projection du film sur la croisette, Alan Parker, le réalisateur anglais, déclare : « C'est l'oeuvre d'un vieil homme. C'est un film ennuyeux, insupportable ». Truffaut, lui, regrette le « malentendu » et le fait que le public n'a pas été sensible à « la poésie de Bresson ». Pour en rajouter à la polémique, la participation au film de Caroline Lang, la fille du ministre de la culture de l'époque, dans un rôle important, n'est pas passée inaperçue et a permis à beaucoup de jaser. Quoiqu'il en soit, L'Argent est l'une des oeuvres maîtresses de Bresson. Avec ce film, le vieux cinéaste se retire sur une oeuvre forte et sombre. L'Argent évoque le triste destin d'Yvon, injustement compromis dans une histoire de faux billets qui l'entraîne dans une descente aux enfers. Librement adapté d'une nouvelle de Tolstoï, Le Faux coupon, L'Argent surprend par sa modernité. « J'ai travaillé à la fois de façon plus acharnée et d'une façon plus dégagée, plus libre, plus impulsive » confie le cinéaste aux Cahiers du Cinéma. On retrouve dans cette ultime oeuvre du réalisateur, certains thèmes qui peuplent sa courte filmographie : la prise d'un individu par un destin inéluctable, la capacité de l'esprit humain de supporter des difficultés physiques injustes (Le procès de Jeanne d'Arc et Au hasard Balthazar sont des films qui se frottent aussi à ces sujets). En quarante années de carrière, Bresson n'aura tourné que treize longs métrages. L'Argent est le dernier. Le réalisateur s'éteindra en 1999.

Le mythe de Carmen a souvent inspiré les cinéastes du passé (Christian-Jaque, De Mille, Feyder, Lubitsch, Welles...). Mais les héritiers du célèbre opéra de Bizet se montraient implacables vis-à-vis du grand écran et rejetaient bien souvent les propositions d'adaptation cinématographique (Le Carmen Jones de Preminger, réalisé en 1954, est interdit jusqu'en 1981 !). Début des années 1980, le mythe de Carmen tombe dans le domaine public. Une kyrielle d'adaptations filmiques vont donc se mettre en marche, ce qui explique la surexploitation du mythe de Carmen lors de ces années 1983-1984. L'adaptation la plus personnelle est très certainement celle de Jean-Luc Godard, qui, avec Prénom Carmen, remporte le Lion d'Or à Venise ainsi que le prix spécial du jury. Il y a aussi, du coté de l'Espagne, le Carmen de Carlos Saura mais encore, en France, le Carmen de Francesco Rosi... Albert Lopez réalise même, en 1984, une adaptation érotique : Carmen nue.

Paris, Texas de Wim Wenders connaît un écho terrible dans le monde entier mais surtout en France, où le film est ovationné unanimement par la presse et par le public. Cannes, très logiquement, donne sa palme d'or à ce qui est et reste le chef d'oeuvre de Wenders. A la fin de la première projection à Cannes, Paris, Texas est ovationné pendant plus d'un quart d'heure. C'est très rare qu'un film fasse autant l'unanimité sur la Croisette. C'est le film de Wenders qui connaît le plus grand succès en salle (près de 2 millions d'entrée en France) et qui a le plus touché le public par son potentiel émotif. Jusqu'alors, les films de Wenders n'étaient guère appréciés du grand public et, bien souvent, n'étaient abordés que par une minorité de cinéphiles et de cinéastes. Avec Paris, Texas, Wenders touche le public avec une histoire simple et vraie, entre un homme et une femme. Travis, personnage central du film, sorti des abyme d'un désert sud-américain, réapprend, à l'aide de son frère, à vivre et retrouve peu à peu son identité et ses souvenirs. Il ira jusqu'à retrouver son fils puis sa femme. On retrouve dans Paris, Texas les thèmes de prédilections de Wenders (déjà exploités dans Alice dans les villes par exemple) : l'errance, la solitude, le mystère, la paternité, l'identité, l'Amérique... Avec ce film, Wenders réalise son rêve : tourner en Amérique dans les décors grandioses et mythiques des films de western. Le casting est très remarqué et apprécié. Harry Dean Stanton tient le rôle principal, lui qui était jusque là un habitué des seconds rôles (Le Parrain II de Coppola en 1974 et Alien de Ridley Scott en 1979). Nastassja Kinski incarne la femme de Travis. L'actrice, révélée par Tess de Roman Polanski (1979) et consacrée par One From The Heart de Francis Ford Coppola (1982), tient là un de ses rôles majeurs. Avec le recul, l'incroyable effervescence de 1984 est remise en question. Certains critiques pensent à un « engouement irréfléchi » alors que d'autres jugent on ne peut plus légitime cette consécration. On a pu lire dans Le Point : « [...] en décernant la palme d'or à Paris, Texas de Wim Wenders, le jury du 37ème Festival de Cannes a pris acte d'une évidence : le réalisateur allemand est l'un des quatre ou cinq créateurs les plus brillants du cinéma mondial. Et il vient de signer son plus beau film [...] ». A l'opposé, on a pu trouver, dans Libération : « C'est presque un mélodrame [...]. C'est pour cela que le film a été ovationné à Cannes. [...] L'émotion était dans l'air du temps et, comme le temps, elle est passée. »
L'année 1984 est profondément marquée par le décès de François Truffaut, mort d'une tumeur au cerveau. Il avait cinquante-deux ans. Sa dernière composition pour le cinéma est La petite voleuse. Truffaut a écrit le scénario de ce film, réalisé en 1988 par Claude Miller et interprété par Charlotte Gainsbourg.

En 1984, après Hair, Milos Forman retrouve le chemin du film musical. Amadeus, adapté par Peter Shaffer de sa propre pièce de théâtre, est un film biographique sur Mozart. Le film est très musical en ce sens qu'il fait très intensément et abondamment revivre les compositions de l'artiste. La mise en scène est grandiose, impossible à déployer dans le cadre d'une pièce de théâtre. La vie du compositeur est ici contée par Antonio Salieri, incarné par F. Murray Abraham, qui révèle toute l'admiration qu'il porte à l'homme tout en racontant comment il a essayé de lui nuire. Le film, un des succès importants de l'année, est vivement critiqué pour sa représentation de Salieri et de Mozart. Beaucoup de critiques s'insurgent contre ce film qui ne respecte pas les descriptions laissées par l'histoire à propos des personnages principaux. La rivalité entre Salieri et Mozart est, dit-on, très romancée et la personnalité de Mozart, adolescent obscène au rire ridicule, est vue comme étant très tirée par les cheveux. L'année suivant sa sortie, en 1985, Amadeus reçoit huit Oscars : meilleur film, meilleur scénario, meilleur maquillage, meilleur son, meilleurs costumes, meilleure direction artistique et décors, meilleur réalisateur et... meilleur interprète masculin, un Oscar décerné à F. Murray Abraham (Salieri) et pas à Tom Hulce (Wolfgang Amadeus Mozart) ! L'avis général est que l'incroyable performance de Abraham éclipse complètement le personnage de Mozart dans un film qui lui est pourtant entièrement consacré.

Spielberg est partout, lors de ces années 1980. Quand il n'est pas à la réalisation d'un projet à succès, on le trouve à la production. Gremlins, le film réalisé par Joe Dante est la sixième production de Spielberg. En cette année 1984, Gremlins connaît un gros succès en salle. C'est un film ouvert à un large public : il peut être vu comme un bon divertissement pour adulte ou comme un film d'horreur pour enfant. L'histoire de Gremlins est celle d'une petite ville américaine envahie par de terrifiants petits monstres qui vont y semer une pagaille "dantesque". La fortune du film va générer des émules, et les années qui suivent la parution du film de Dante voient l'émergence de nouvelles petites créatures vicieuses comme les Critters ou les Ghoulies...
C'est en 1984 que se conclut la trilogie des Il était une fois... de Sergio Leone, entamée en 1968. Il était une fois dans l'ouest, premier volet du triptyque, était une élégie sanglante sur la disparition de l'ouest classique, le film-manifeste du western spaghetti qui stigmatise et amplifie les clichés du genre western. Avec Il était une fois... la révolution, en 1971, le ton se fait plus grave, le film opposant deux archétypes d'aventuriers incarnés par Rod Steiger et James Coburn, sur toile de fond mexicaine. Avec beaucoup de retard, la boucle est bouclée en 1984. Le troisième opus de cette mythologie léonienne de l'histoire américaine conclut avec une époque plus contemporaine. Il était une fois en Amérique se situe dans les années trente et observe les évolutions d'un groupe d'adolescents dans un quartier de New York, adolescents qui deviennent de véritables gangsters, profitant de la prohibition... Admirablement interprété par De Niro et James Woods, le film est sorti dans une version désavouée par Leone. La durée du film ayant été ramené de 277 minutes à 139...

Brazil1985 est "l'année du cinéma britannique" déclarent les Anglais. En effet, leur cru cinématographique pour cette année, une fois n'est pas coutume, surpasse celui du cousin à la bannière étoilée. Le film le plus marquant de l'année est sans conteste Brazil, le chef d'oeuvre de Terry Gilliam, l'ex Monty-Python. L'univers de Brazil est un monde de verre, de béton et d'acier, perdu quelque part dans un 21ème siècle où fonctionnaires et policiers incarnent un régime totalitaire, fascisant. Un peu comme avec Blade Runner, on a l'impression d'un "futur usé" où se côtoient le luxe et la misère, le neuf et le vieux. Dans cette vision apocalyptique du futur, ce n'est pas, comme dans de nombreuses productions éprouvées de la première moitié du 20ème siècle, une idéologie révolutionnaire qui est proposée pour soigner le monde malade. Gilliam invoque, pour sa part, l'imaginaire, il brouille les pistes entre réalité et rêves et surtout laisse le rire, même désespéré, régner sur la vie. Brazil est un délire mené de main de maître, qui rappelle les livres de Kafka et le 1984 de George Orwell. Avec ce film, Gilliam crée son esthétique propre, reconnaissable entre mille, proche de l'univers d'un Jérôme Bosch ou d'un Edward Munch... Cette esthétique sera reprise dans certains autres films à suivre comme L'Armée des douze singes (1995). Dans le monde totalitaire de Brazil, ultra hiérarchisé, administré et contrôlé, Gilliam fait passer sa dénonciation par l'image. Il évite l'écueil ronflant de la grande échappée lyrique et contestataire. Dans Brazil, toute dénonciation passe par l'image et le spectateur est le seul maître de sa pensée. Ainsi, le mot "fasciste" n'est prononcé qu'une seule fois mais les casques, bottes et fusils nous mettent ce mot à la bouche à plus d'une reprise. La liberté, elle, est incarnée en rêve par le héros, qui s'imagine à plusieurs reprises en Icare, s'envolant vers sa bien aimée...

My Beautiful LaundretteMy Beautiful Laundrette est l'oeuvre par laquelle Stephen Frears s'impose comme l'un des rénovateurs du cinéma britannique. Le cinéaste combine le réalisme documentaire et l'atmosphère du film noir. Le film est une percutante analyse sociale centrée sur un jeune couple homosexuel, composé d'Omar, émigré pakistanais et de Johnny, un « ex-voyou », qui gère une laverie dans un Londres rongé par la haine, le chômage, le racisme et la violence. Frears, avec une infinie tendresse, met en scène les oubliés de l'Angleterre thatchérienne : homos, immigrés, laissés pour comptes de la crise, marginaux. My Beautiful Laundrette est un film osé pour ces années 1980 réactionnaires pendant lesquelles la dame de fer faisait explicitement référence aux Ecritures pour condamner la drogue, les unions hors mariage et l'homosexualité et prôner la restauration d'un ordre moral qui offre paix et prospérité aux "vrais Anglais". Les ambitions de Frears sont claires : « La seule personne authentiquement cynique que je connaisse est Mrs Thatcher. Elle était poussée par la haine de classe, avait un mépris absolu des gens et les manipulait » témoigne à posteriori le réalisateur. A l'instar des films de Kenneth Loach, My beautiful Laundrette est saisi sur le vif, filmé à la manière d'un reportage. On le sait, cette technique ne peut qu'en rajouter à la crédibilité du discours.

En France, 1985 est une grande surprise, celle de Trois hommes et un couffin, le film de Coline Serreau. Si l'on dresse un palmarès des films français aux plus fortes recettes , allant de 1968 à 1993, on observe rapidement que le film de Serreau est en première position, avec 10 millions d'entrées sur le sol hexagonal. Mais le succès ne se limite pas à la France. La minuscule production signée Coline Serreau connaît un succès tellement fulgurant qu'elle est sélectionnée aux Academy Awards ! Un film tellement remarqué chez les américains qu'il fera l'objet d'un remake : Three Men and a Baby, qui sort en 1987. Partout dans le monde, Trois hommes et un couffin rivalise à l'affiche avec des superproductions comme Mad Max III ou Rambo II. L'énorme succès remporté par ce film à petit budget a de quoi rassurer les producteurs français, face à des statistiques de fréquentation en baisse, d'une année à l'autre (-8% de 1984 à 1985 en France).

Le nouveau film de Godard, un "remake" de l'immaculée conception, baptisé Je vous salue Marie, déchaîne la polémique en cette année 1985. Dans cette version moderne de la naissance de Jésus, Marie est la fille d'un garagiste et l'archange Gabriel vient lui annoncer l'arrivée de son enfant par avion... Son ami Joseph est, quant à lui, chauffeur de taxi ! Godard parle en ces mots de son film à scandale : « Il y a là comme le scénario du grand événement survenu autrefois et raconté par les Evangiles. Le film est la preuve que c'est possible puisque ça arrive sous nos yeux ». Le film de Godard est une réflexion sur le sacré, le mystère de l'Incarnation, des origines. Projeté à Versailles, le film provoque une violente manifestation qui nécessite l'intervention des forces de l'ordre. Je vous salue Marie est interdit à Versailles par arrêté municipal. Un membre du cabinet du maire déclare : « Personne à la mairie n'a vu le film. Mais nous ne sommes pas dupes. Je crois qu'il est question de la vierge qui tombe enceinte sans l'intervention du Saint-Esprit. Il paraît qu'on la voit toute nue. C'est un euphémisme de dire que Mr. Godard est dangereux. » La Confédération nationale des associations catholiques et l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne demandent la saisie du film afin d'en retirer « tous les passages obscènes et pornographiques », sans obtenir gain de cause.
Après Godard en 1983 avec Prénom Carmen, un autre cinéaste français de renom remporte avec son film le Lion d'Or de la Mostra de Venise. Il s'agit d'Agnès Varda qui, avec Sans toit ni loi, livre un drame juste et sensible mais sans excès de pathos ou de misérabilisme. Sans toit ni loi retrace le destin fatal d'une jeune femme errante prénommée Mona dont le corps sans vie est retrouvé, un matin d'hiver, dans un fossé. Agnès Varda pose sur la jeune femme incarnée par Sandrine Bonnaire un regard dépourvu de jugement. Elle ne cherche pas à expliquer ou à récupérer sa mort.
En 1985, le cinéaste yougoslave Emir Kusturica poursuit son chemin sur la route de la reconnaissance cinématographique mondiale. Après avoir remporté le Lion d'Or de la première oeuvre à Venise en 1981 pour Te souviens-tu de Dolly Bell, il séduit Cannes et remporte la palme d'or pour Papa est en voyage d'affaire. Ce film est une chronique de la vie yougoslave des années cinquante vue au travers du regard malicieux d'un enfant dont le père est parti en camp de rééducation. Ces deux films de Kusturica se distinguent par leur finesse et leur humour et imposent leur auteur comme le plus brillant représentant de ce que l'on a appelé « Le groupe de Prague » du cinéma yougoslave. A titre anecdotique, on peut signaler que le président de Cannes, cette année là, n'était autre que Milos Forman, certainement pas insensible au style et au parcours du jeune promu.

La Mouche« Notre première réaction devant une mouche, c'est d'être dégoûté. Mais s'il on commence à penser à elle comme à une créature magnifique, peu à peu elle devient belle ». Les mots sont de Cronenberg. En 1986, son film, La Mouche, est un bon succès commercial qui le popularise dans le monde entier. Le cinéaste est parti d'un film américain nommé La Mouche noire, réalisé par Kurt Neumann en 1958. Il exploite le mythe du savant fou pris dans sa propre toile et victime de son orgueil. L'humanité des personnages, la qualité de l'interprétation (Jeff Goldblum, Geena Davis) et le réalisme des truquages transforment ce vieux sujet de base en une fantastique réalisation. Métaphysique, philosophique, le remake de Cronenberg surpasse le modèle original pour bien des cinéphiles. Chez Neumann, la créature était une juxtaposition incohérente d'éléments pris chez l'homme et chez la mouche (un homme avec une tête de mouche). Chez Cronenberg, la fusion est totale, elle vient de l'intérieur. Les deux êtres ne font qu'un (Brundle-mouche). L'animalité progresse et prend progressivement le dessus sur cet homme apparemment sorti indemne d'une téléportation. Peu à peu, le savant se libère de toute sa personnalité rangée et "civilisée" pour laisser exploser ses instincts et sa violence. « La mouche est un être comparable à un extra-terrestre, à une forme d'existence parfaitement étrangère qui vit à nos cotés, avec laquelle nous ne partageons aucune valeur, aucune ressemblance » déclare le réalisateur. Le film de Cronenberg n'est donc pas un simple film horrifique destiné à chatouiller le box office. Il marque par sa dimension et sa portée philosophique, en plus de multiplier les références vis-à-vis de mythes (Docteur Jekyll & Mr Hyde) et d'écrits (Kafka) antérieurs.

Après le succès critique et public de La guerre du feu, Jean-Jacques Annaud se lance dans un film policier se déroulant dans une abbaye italienne du Moyen Age. Cette superproduction italiano-germano-française est l'adaptation du best-seller de Umberto Eco. Mais Annaud n'a pas cherché à adapter le roman philosophique de l'écrivain italien. Il le dit lui-même : « Le livre va sûrement transparaître dans le film, mais j'ai voulu filmer ma vision de ce livre qui peut-être lu à plusieurs niveaux. Et Eco, qui l'a très bien compris, m'y a d'ailleurs encouragé ». L'atmosphère de superstition érudite et les querelles idéologiques qui parsèment le roman transparaissent cependant largement à l'écran. Le film d'Annaud est un succès mondial. Le succès remporté par le film est assez surprenant puisque, au milieu de ces années quatre-vingt, aux genres très codifiés, tourner un film d'époque sans chevauchées ni effets spéciaux ou scènes de foule est un pari risqué. Le film d'Annaud n'est pas un film de grand spectacle. Dans la continuité de La guerre du feu, le réalisateur privilégie le réalisme à la surenchère spectaculaire, artificielle. Le nom de le rose est un édifice ultra-réaliste : les personnages (coiffures, vêtements, couleurs), les moeurs (la religion, l'héréticité, la sexualité, la pauvreté), la lumière (pas de lumière artificielle)... C'est de ce réalisme, assorti de thèmes universels, que le film tire sa force.

Le second métrage de Léos Carax, Mauvais sang, reçoit le prix Louis Delluc, au mois de décembre de l'année de sa sortie, en 1986. Le nouveau film de Carax était très attendu, l'auteur étant considéré comme la figure de proue de la « nouvelle Nouvelle Vague ». Le premier long métrage de cet héritier de Godard était Boy Meets Girl, sortie en 1984. Le film l'a popularisé comme un jeune loup à suivre. Mauvais sang raconte l'histoire d'Alexis (Denis Lavant), fasciné par la beauté d'Anne (Juliette Binoche), qui accepte une mission difficile proposée par deux gangsters (Michel Piccoli et Hans Meyer). Sous des airs de polar, avec une simple histoire de gendarmes et de voleurs, Carax démontre que ce qui compte, pour le septième art, n'est pas l'intrigue, le sujet ou le thème mais la façon de filmer, le style et la forme. C'est pourquoi l'on range souvent ce réalisateur, qui multiplie les références à Godard ou à Cocteau dans ses films, aux cotés de Besson et Beineix, dans la catégorie des « Nouvelles Images », mouvement inauguré par Diva. Mais coller une étiquette à Carax est une erreur. Mauvais sang se veut déroutant, dérangeant et finalement inclassable. Cette indépendance d'esprit qui marque l'oeuvre de Carax a valu au jeune auteurs de nombreuses comparaisons à Jean Vigo, lui aussi vu comme le « Rimbaud de son temps ». Le cinéaste a donc produit un effet certain sur les auteurs et cinéphiles français des années quatre-vingt.

En 1986, Jean-Jacques Beineix adapte à nouveau un livre, signé Philippe Dijan, l'auteur de romans noirs au style "mode". Tirant la leçon de son infortune commerciale (La lune dans le caniveau, 1983), Beineix récolte un grand succès avec 37°2 le matin. Son film décrit les rapports amoureux et les déchirements d'un couple de paumés. Betty, jeune femme excessive et sensuelle, est interprétée par Béatrice Dalle. Son ami à l'écran, Zorg, dépanneur mécanicien tenté par la création littéraire, est incarné par Jean-Hugues Anglade. 37°2 le matin permet aux deux acteurs de se révéler. « Ce film m'a apporté plus que tous ceux que j'avais fait précédemment réunis » témoigne Anglade. Mais c'est surtout Béatrice Dalle qui profite de ce succès. L'engouement pour le film, qui arrive même à percer aux Etats-Unis, où il est rebaptisé Betty Blue, vaut à l'actrice une célébrité instantanée. A Cannes, le film déchaîne la polémique, la critique traditionnelle ayant un du mal à se faire à l'esthétique immédiate du réalisateur. Le succès en salle est complet, le film attire un public jeune.

Encore une fois, le cinéma français à les faveurs de la Mostra de Venise. En 1986, Eric Rohmer reçoit le Lion d'Or pour son film Le rayon vert, cinquième et dernier volet de la série Comédies et Proverbes. Après Godard et Varda, c'est à Rohmer de recevoir cette prestigieuse récompense italienne qu'est le Lion d'Or. Preuve, finalement, que le cinéma français se porte bien. Le rayon vert tire sa force du fait qu'il a été tourné sur le mode de l'improvisation contrôlée. Cette méthode, au prix de quelques maladresses, confère au film une étonnante vraisemblance et un sentiment de liberté. On a parfois l'impression de saisir une scène non tournée, une réalité brute, ethnographique, dont on a du mal à croire que la sincérité n'est qu'en fait un jeu, derrière la caméra. Après Rohmer, la Mostra de Venise n'en a pas fini de récompenser le cinéma français. L'année suivante, en 1987, Louis Malle, pour son touchant Au revoir les enfants est récompensé du Lion d'or. Son film est l'évocation pudique d'un souvenir d'enfance : des enfants juifs dénoncés et emmenés par la Gestapo. Entre 1980 et 1989, cinq films français décrochent le Lion d'Or à Venise.
Enfin libéré et soulagé par le temps du poids vietnamien, l'Amérique se livre enfin sans concession sur son passé. Trois films majeurs, en cette fin des années 1980, reviennent sur l'horreur de la guerre du Vietnam et offrent une vision toute renouvelée du conflit. Un regard neuf et, généralement, plus objectif.

PlatoonOliver Stone aborde la réalisation de son film Platoon avec cette idée en tête : « Personne n'a encore fait de film réaliste sur le Vietnam ». Ancien soldat, revenu médaillé de l'offensive du Têt, Oliver Stone décide de revenir sur ce qu'il a vu et de l'exposer de façon objective. Avec Platoon, le spectateur suit les évolutions de Taylor, incarné par Charlie Sheen : sa cauchemardesque immersion dans la réalité de la guerre, ses épreuves. Au travers du regard de Taylor, le spectateur découvre les horreurs de la guerre et observe pour la première fois un film qui s'attache à dénoncer le comportement américain, mettant en scène les sévices infligés aux civils vietnamiens. C'est une première. Là où Voyage au bout de l'enfer ne faisait que décrire unilatéralement les souffrance américaines, là où des films manichéens et musclés comme Rambo II : la mission stéréotypaient l'ennemi, Oliver Stone, avec Platoon, montre la souffrance et les horreurs dans les deux camps. Platoon est le premier volet d'un triptyque sur le Vietnam. Il sera suivi par Né un 4 Juillet (1989) et Entre terre et ciel (1993). Preuve formelle que les choses ont bien changé, aux Etats-Unis, à propos de la guerre du Vietnam, Platoon récolte en 1986 quatre Oscars en plus de remporter un grand succès public et critique.

Full metal jacketA quelques mois d'intervalle, Platoon et Full Metal Jacket sortent dans les salles obscures. Les deux films sont très différents et proposent des visions opposées de la guerre du Vietnam. Contrairement à Stone, Kubrick n'a fait aucune guerre et ne connaît pas le Sud-est asiatique. Le tournage du film de Stanley Kubrick s'effectue intégralement en Angleterre (l'offensive du Têt, dont est revenu médaillé Stone, est reconstitué sur les bords de la Tamise). Les films de Stone et de Kubrick traitent donc du même sujet mais sont, de toute évidence, aux antipodes l'un de l'autre. Comme à chaque fois, Kubrick s'est beaucoup documenté avant de s'immerger dans son sujet (sept ans séparent la sortie de Shining de celle de Full Metal Jacket). Comme presque tous les films de Kubrick, Full Metal Jacket est structuré en trois parties distinctes : l'instruction des marines, l'arrivée au Vietnam et l'offensive du Têt. Dans le premier tiers du film, Kubrick nous donne à voir l'entraînement des marines, déshumanisant à souhait, mené avec cruauté par un sergent instructeur à la prodigieuse inventivité verbale : Hartman (Lee Ermey, un ancien marine, aussi violent et ordurier au naturel que pour le tournage, paraît-il). Lors de cet entraînement, l'ensemble des marines se retrouve progressivement désindividualisé (la plupart sont affublés d'un surnom ridicule). Tout est fait pour que ces hommes deviennent de parfaites machines à tuer, bien dociles. Les deux autres parties du film révèlent un Vietnam du cauchemar. La plupart des soldats avouent ne pas comprendre pourquoi ou pour qui ils se battent. « Tu crois que c'est pour la liberté qu'on bute du Viet ? » grogne l'un d'eux, vers la fin du film. Full Metal Jacket nous montre aussi les mensonges colportées par les officiers aux médias et les résistances farouches des populations vietnamiennes.

Good Morning Vietnam est tiré d'une histoire vraie, celle de Adrian Cronauer, premier disc-jockey à passer de la musique rock'n roll sur la radio des forces armées américaines au Vietnam. Le film de Barry Levinson est la toute première comédie sur la guerre du Vietnam. Levinson et son équipe ont eu du mal à trouver une société productrice qui accepte de financer une comédie sur ce thème. C'est finalement un producteur des Studios Disney qui se charge du projet. Avant la sortie du film, de nombreux articles s'indignaient, aux Etats-Unis. « Comment peut-on oser faire une comédie sur la guerre du Vietnam ? » Les réactions étaient totalement révélatrices des derniers tabous américains sur le sujet. Si Good Morning Vietnam est bien une comédie, il n'en reste pas moins un film de guerre, un drame sans concession. Aux images d'euphorie de l'extraordinaire animateur Cronauer à l'antenne, incarné par un Robin Williams au grand talent d'improvisation, s'opposent des images crues sur la réalité d'un pays en guerre : attentats, bombardements, morts, violences... En plus d'être le premier film à aborder la guerre du Vietnam par le biais de la comédie, Good Morning Vietnam décrit, comme jamais cela n'a été fait auparavant, la population vietnamienne. Adrian Cronauer développe des relations avec une jeune fille du pays et se lie d'amitié avec son frère. En nous donnant à observer ces personnages, le film s'attache à nous faire découvrir la vision vietnamienne du conflit. Good Morning Vietnam est aussi une découverte, non dénuée d'humour, des moeurs vietnamiennes.

Maurice PialatLe Festival de Cannes fête en 1987 son quarantième anniversaire. Pour la première fois, depuis 1960, un film français reçoit la Palme d'Or. Il s'agit du film de Maurice Pialat : Sous le Soleil de Satan. La cérémonie de remise des prix de ce quarantième Festival de Cannes est retransmise en direct et par satellite dans le monde entier. Et, pour ce grand événement, lorsque arrive la fortune du film Sous le soleil de Satan, des sifflets s'élèvent dans l'assistance, une partie de la salle hurle sa désapprobation. Fidèle à sa réputation et en réaction, Pialat lève le poing et commente amèrement : « Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus ». L'image est certainement l'une des plus connue de Cannes. L'histoire du film est celle du curé Donissan (Depardieu), prêtre visionnaire tenté par Satan qui doute de sa mission malgré le soutien de son doyen (Pialat). Son destin va croiser celui de la jeune Mouchette, une femme folle d'orgueil et suicidaire (Bonnaire). Sous le Soleil de Satan est une adaptation du roman de Georges Bernanos. Pialat annonce dès le départ qu'il a trahi l'auteur, apportant par là de l'eau au moulin de ses détracteurs possibles. Certains critiques ont du mal à voir l'écriture de Bernanos, si souvent liée indéfectiblement à Bresson (Journal d'un curé de Campagne), être remaniée par Pialat.

Les ailes du désirLors de cette année 1987, deux films venant d'Allemagne connaissent un bon écho mondial. Bagdad Café de Percy Adlon raconte l'histoire d'une grosse bavaroise prénommée Jasmin (incarnée par Marianne Sägebrecht), abandonnée par son mari en plein désert du Nevada. Jasmin s'impose peu à peu dans son nouvel univers et y trouve le bonheur au milieu de nouveaux amis. Percy Adlon réalise une fable très douce et optimiste, il met en scène des personnages aux émotions débordantes mais pudiques, deux héroïnes amusantes à fort caractère. Conte sur les sentiments humains, Bagdad Café tient comme centraux des thèmes comme la force, la vulnérabilité ou la solitude. Aux Césars, le film de Percy Adlon récolte le prix du meilleur film étranger et celui du meilleur film de la communauté européenne. Plus marquant encore est le film de Wim Wenders, Les Ailes du Désir. Il s'agit de l'histoire d'un ange, épris d'une trapéziste et qui souhaite, par amour pour elle, devenir simple mortel. Les Ailes du Désir est une fable merveilleuse qui ressuscite l'expressionnisme allemand de la grande époque : le cinéma de Murnau, de Lang... Les Ailes du Désir marque le retour de Wim Wenders dans son pays natal, après un passage états-unien. Wenders, avec Les Ailes du Désir, dresse le tableau de ce retour au pays, assez désenchanté. Terrains vagues, artères lugubres et graffitis font le paysage de ce triste Berlin. Les Ailes du Désir est une parabole de la survie d'une nation : l'Allemagne encore non réunifiée.

Avec des moyens exceptionnels, Bertolucci reconstitue en 1987 la Chine d'avant Mao, à travers la destinée de Pu Yi. Dernier empereur de la Chine, le jeune homme, enfermé toute son enfance dans le cocon impérial, découvre lors de ses premières années de vie adulte, lentement, la réalité du monde extérieur. Une fresque à grand spectacle, une biographie historiquement contestée, tournée en partie dans l'esthétique de la cité interdite : Pékin. Malgré l'ampleur des moyens déployés, de nombreuses difficultés se sont fait sentir au cours de ce tournage très cosmopolite. 19 000 figurants, 9 000 costumes, 270 techniciens appartenant à 6 nations différentes et 2 ans de négociations avec les autorités chinoises pour décider des lieux de tournages...

1988 est marqué par l'incroyable succès du film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Le réalisateur a soigneusement entretenu le secret de son film pendant toute la durée du tournage (neuf mois en Italie, Grèce, îles vierges, Etats-Unis, Pérou...) et du montage (huit mois). La première présentation publique a lieu en gala d'ouverture du Festival de Cannes, le 11 Mai. En même temps, Le Grand Bleu sort dans 240 salles en France. Un lancement soigneusement préparé pour un film qui a coûté 75 millions de francs. Le film de Besson raconte, ou plutôt montre, l'histoire d'amitié et de rivalité entre le français Mayol (Jean-Marc Barr) et le sicilien Enzo (Jean Reno), deux passionnés de la mer. Proposé à Mel Gibson et à Christophe Lambert qui ont tous deux refusé l'offre, le rôle de Mayol a été confié à Jean-Marc Barr, jeune inconnu. Dans le rôle de la fiancée de Mayol, on retrouve l'américaine Rosana Arquette. A Cannes, on accueille le film d'une façon mitigée. Les critiques ne se passionnent pas pour ce film qui leur apparaît comme étant fade, sans profondeur. De très belles et de très spectaculaires images de plongée sous-marine mais une histoire qui ne vaut rien. Un récit et des personnages transparents voire inexistants juge-t-on alors. Les honneurs vont venir du public adolescent. C'est en effet grâce aux jeunes, réellement pris d'engouement pour une large majorité, que le Grand Bleu va exploser au box-office. Le jeune public fait du Grand Bleu un film culte, porté aux nus par la magnificence des images sous-marines et l'extrême beauté de la musique composée par Eric Serra. Fin 1988, 700 000 exemplaires, tous support confondus, ont été vendus de la B.O. Un vrai phénomène "jeune" confirmé l'année suivante lors de la sortie de la version longue de trois heures (au lieu de deux). Qualités spectaculaires oblige, le film est aussi très bien accueilli aux Etats-Unis. Bien des historiens du cinéma et des critiques, s'interrogent encore aujourd'hui sur ce succès inattendu et tentent de l'expliquer. C'est le cas de Vincent Pinel : « La présence insolite du Grand Bleu de Luc Besson en tête du box-office mérite qu'on s'y arrête ». Les raisons apportées pour expliquer ce succès sont assez floues. On parle souvent du film comme une oeuvre capable de fasciner sans communiquer formellement, transmettre sans discours.... Le succès du Grand Bleu n'est pas réellement reconnu par "l'aristocratie du film". L'année suivant sa sortie, aux Césars, on préfère récompenser Camille Claudel de Nuytten et L'Ours de Jean-Jacques Annaud (meilleure réalisation et montage).
L'ours d'Annaud sort sur grand écran la même année que le Grand Bleu. Il attire de la même manière même s'il ne joue pas du tout sur le même terrain. C'est le coté spectaculaire du film qui attire le public. En ce sens, le film de Besson et celui d'Annaud sont proches. Le public de tous les ages s'est émerveillé des images inédites proposées par le film d'Annaud. Produit par Berri, le film d'Annaud est l'adaptation d'un roman d'aventure de James Olivier Curwood intitulé Le Grizzly et longtemps publié en France dans les collections pour la jeunesse. L'ours comporte peu de personnes humaines et donc peu de dialogues. Le film raconte le périple pour la survie d'un jeune ourson. Après La guerre du feu, Annaud réédite avec succès un exploit cinématographique. L'Ours, superproduction française, a misé gros et s'est risqué à de difficiles paris techniques (des prouesses, dans le domaine du dressage). Les efforts et la créativité de Jean-Jacques Annaud sont une fois de plus récompensés dans ce film, qui a su conquérir le marché international.

1988 est aussi l'année pendant laquelle retentit l'un des plus gros scandales et l'une des plus grosse polémique de l'histoire du cinéma. La dernière tentation du Christ de Scorsese n'est pas un enseignement religieux ou une simple illustration des Evangiles. Il propose un point de vue différent. Jésus y est montré comme un homme et non comme un prophète, il s'exprime comme un charpentier et pas comme le messie, il s'interroge et remet en cause sa foi, il fait preuve de libre arbitre. Martin Scorsese a voulu, avec ce film, porter à l'écran l'adaptation du roman de Niko Kazantzakis dans lequel Jésus est un homme en proie au doute, réticent d'assumer sa mission divine. Alors qu'il n'est qu'un simple projet, La dernière tentation du Christ est déjà la cible des passions religieuses. De nombreux studios renoncent à produire le film, sous la pression. C'est le cas de la Paramount. A l'annonce du tournage au Maroc, produit par la Universal, religieux de tout poil mènent croisade contre le projet. Un pasteur propose de réunir dix millions de dollars pour racheter le film aux studios et faire ainsi avorter le projet. Un réseau câblé de programmes religieux déclare que le film « déchaînera sur le pays le pire châtiment qu'il ait connu ». 25 000 manifestants défilent devant les studios de la Universal. La General Cinema Theaters prive le film de droit de cité dans ses mille salles. Le cinéaste Franco Zeffinelli dénonce un film qui « détruit l'image du Christ » et qui véhicule des « fantasmes vulgaires ». En France, les cardinaux De Courtray et Lustiger déclarent : « Nous n'avons pas vu le film de Martin Scorsese, La Dernière tentation du Christ. Nous ignorons la valeur artistique de cette oeuvre et, cependant, nous protestons d'avance contre sa diffusion ». Cette réaction est symptomatique du climat d'alors. Les extrémistes religieux de tout poil critiquaient La dernière tentation du Christ sans avoir ni lu le livre, ni vu le film. Partout dans le monde, la guerre sainte commence et s'emploie à ce que ce film ne soit pas vu. Par des moyens légaux tout d'abord, en attaquant juridiquement le film. Mais la plupart de procès tournent en la défaveur des associations religieuses. L'obscurantisme religieux va donc s'exprimer plus radicalement. Manifestations, dégradations, violences... Les cinémas du monde entier sont le théâtre d'événements. Le Cinéma Saint-Michel est incendié, à Paris. On déplore alors une quinzaine de blessés. Scorsese se défend du blasphème. Son film met en scène un Christ s'imaginant des jours et une vie paisible d'homme normal, en compagnie de Marie Madeleine. Scorsese commentera son film en ces mots : « La dernière tentation du Christ, c'est celle d'être un homme ordinaire, de vivre jusque soixante ans, de se marier puis de faire l'amour avec sa femme pour avoir des enfants. On ne peut pas trouver plus catholique comme préoccupation ! Pour moi ce film est un acte de foi ».
En 1988 sort en salle ce qui est certainement la réalisation la plus retenue de Clint Eastwood pour les années quatre-vingt : Bird, une biographie filmique du génie du jazz Charlie Parker. Parmi tous les comédiens de sa génération à avoir osé la réalisation (Paul Newman, Robert Redford, Jack Nicholson), Eastwood est le seul à avoir su imposer son style, avec des films combinant classicisme et modernité. Depuis le début de sa carrière de réalisateur en 1971 avec Play Misty for me, Eastwood a investi plusieurs genres, avec succès (western, policier, guerre). Il se consacre à la musique avec Bird. Il signe avec ce film le plus grand mariage entre la musique jazz et le cinéma et surpasse tout ce qui a été fait jusque là en la matière. Pour célébrer la légende du bebop, Eastwood a eu l'audace de construire son film exactement comme un morceau de jazz, avec une alternance entre les moments de décontraction et les brusques flambées de violence. Bird est une révélation du genre biographique. Il surpasse les biographical Pictures d'Hollywood (Vers sa destinée de Ford en 1939) et s'avère être un portrait honnête sur Parker. Ni hagiographique ni reconstructeur du mythe américain comme la plupart des bio-pics, Bird se concentre sur le musicien Parker. Dans cette optique, le film met à l'écart des morceaux choisis de la vie du jazzman, comme son apprentissage, ses mariages, sa consommation de drogues... « Je n'ai pas voulu faire un junkie movie de plus mais un film sur Parker musicien. Sur son mystère » nous confirme Eastwood.
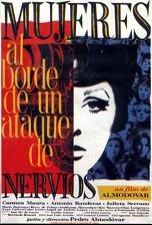
Pendant toute la période de la dictature franquiste, le cinéma espagnol nous renvoyait l'image d'un pays sage aux valeurs traditionnelles et patriarcales bien encrées et conservées. Après la mort de Franco, courant des années soixante-dix, les films d'Almodovar, chef de file de la Movida cinématographique espagnole, démontrent qu'il n'en est rien. Avec Femmes au bord de la crise de nerf, le réalisateur, s'inspirant vaguement de La Voix humaine de Cocteau, brosse le portrait d'un groupe de jeunes femmes madrilènes dont l'une d'elle, incarnée par Carmen Maura, actrice fétiche d'Almodovar, cherche à retrouver son amant. Cette farce très maîtrisée obtient un succès monstre en Espagne et devient le plus gros phénomène hispanique aux Etats-Unis depuis Belle de Jour de Bunuel. Alors lancé par ce succès, Almodovar devient le chef de file du cinéma espagnol dans le monde entier. Une popularité internationale que seul Luis Bunuel a atteinte jusqu'alors. Malgré une légèreté apparente, Femmes au bord de la crise de nerf est une véritable explosion. Le film dynamite les tabous de la bourgeoisie madrilène et évoque en termes crus et avec des images chocs le bouleversement culturel de la société espagnole post-Franco.

L'oeuvre épistolaire de Chaderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, est adapté par deux fois, en cette année 1989, pour le grand écran. La première version est celle de Stephen Frears. Pour beaucoup d'adeptes du chef d'oeuvre de Laclos, Les Liaisons dangereuses de Frears est l'adaptation la plus juste. Elégant et cynique, le film est l'adaptation de la pièce de théâtre de Christopher Hampton, elle-même adaptée du fameux roman. L'impressionnant casting du film (Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves, Uma Thurman...) éclipse complètement une deuxième adaptation, Valmont, menée par Milos Forman et dont la sortie suit de peu le film de Frears. La fastueuse reconstitution de Forman sacrifie le plus important de l'oeuvre de Laclos : l'intrigue et la psychologie des personnages, occultant un des thèmes majeurs de l'oeuvre originelle : la perversion. Frears n'est pas tombé dans ce piège, ce qui explique que son film est l'adaptation la plus retenue. Malkovich et Close incarnent un Vicomte de Valmont et une Marquise de Merteuil conformes au roman, calculateurs, cyniques et vicieux.

Enorme réussite commerciale pour le film de Tim Burton, Batman, adaptation filmique du fameux comics sur l'homme chauve-souris. En 1989, le box office américain, en augmentation de 13% par rapport à 1988, dépasse les cinq milliards de dollars, brisant ainsi un record. Le numéro un de ce box office est Batman, qui réalise quarante millions de dollars de recette les trois premiers jours de son exploitation ! Le film est le plus gros succès commercial de l'année. Il faut dire que rien n'a été laissé au hasard. Les opérations publicitaires et de marketing ont été savamment organisés. Tim Burton, déjà auteur du très remarqué Beetlejuice, confère à Batman une esthétique propre. Les couleurs prédominantes du film sont celles de la nuit : le bleu-gris et le noir. Le Joker, incarné par Jack Nicholson, est habillé de couleurs violettes, oranges, vertes et bleues. L'architecture de Gotham City est on ne peut plus lugubre et gothique, faisant penser à une ville étouffée par le fascisme. Burton, avec Batman réussit à imposer à cette superproduction son univers d'un baroque glacé et poétique.

Le cercle des poètes disparusAprès son exceptionnelle prestation dans le film de Barry Levinson, Good Morning Vietnam, Robin Williams confirme ses extraordinaires talents de tragi-comédien avec Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society). Le film de l'australien Peter Weir est le succès inattendu de cette année 1989. Son intrigue est assez éloignée de celle de l'archétype du film à succès américain. Le Cercle des Poètes disparus traite de l'arrivée d'un professeur anticonformiste et passionné dans un collège huppé et fort traditionaliste. Libertaire, la philosophie du professeur, incarné par Williams, s'en prend au conservatisme et se résume en une devise latine : « Carpe Diem », « profite du jour présent ». Le film de Weir, touchant un large public, devient un véritable phénomène, en 1989, pointant son nez parmi les dix premières places de cet impressionnant box office 1989. Beaucoup de critiques d'alors s'insurgent contre le succès de ce film applaudi tel un phare de l'utopisme contemporain. Jean Douchet écrit dans Les Cahiers du Cinéma que « le phénomène de ce succès renvoie à une déportation de la conscience réflexive du cinéma ». L'appel démagogique à l'affirmation de soi du film a été mal reçu par beaucoup. Le message délivré par le personnage du professeur est jugé facile, trompeur et simpliste. Les critiques s'en prennent aussi à la réalisation de Weir, n'hésitant pas à comparer Le Cercle des Poètes disparus à un téléfilm !
Le premier film de Spike Lee, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, sorti en 1986, a valu au jeune réalisateur le surnom de « Woody Allen noir ». Son premier film, racontant les amours d'une jeune femme, ne manquait en effet pas de mordant. Avec ce premier long métrage, Spike Lee se révèle être un auteur à suivre. Avec Do the Right Thing qui sort en 1989, le réalisateur confirme tout le bien qu'on a dit de lui. Il impressionne critiques et public avec cette tragicomédie colorée et rythmée comme un vidéo-clip, dans laquelle la caméra donne à plusieurs moments l'impression d'être un personnage à part entière. Do The Right Thing traite du racisme ordinaire dans le ghetto noir de Brooklyn. Des thèmes que l'on retrouvera dans la suite de son oeuvre...
Sexe, mensonges et vidéo, premier long métrage d'envergure d'un cinéaste inconnu de 26 ans, est la révélation de Cannes 1989. En plus d'avoir été palmé, le film connaît un bon succès en salle. Sexe, mensonges et vidéo représente le triomphe des indépendants américains. Un budget modeste, des acteurs presque tous débutants (Andie MacDowell et James Spader), un contrôle artistique optimal jusqu'au montage sont autant d'éléments qui caractérisent cette libre production. Avec ce film, Soderbergh devient le plus jeune réalisateur à recevoir la palme d'or cannoise.
Nanni Moretti est la figure emblématique du cinéma italien des années 1980. Dans ce laps de temps, son film le plus populaire mais aussi le plus acerbe est Palombella Rossa. L'auteur-acteur principal règle ici ses comptes avec la société italienne contemporaine : la politique (P.C.I.), la religion, la morale, les médias, et au travers tout ça, il règle ses comptes avec lui-même. Palombella Rossa, c'est, selon les propres mots de Moretti, « l'histoire d'un communiste qui ne sait plus qui il est et qui reconstruit sa vie pendant un match de water-polo ». Nanni Moretti se confie sur sa vie, au travers de son film, en même temps qu'il se cache derrière son personnage Apicellae. Palombella Rossa est très métaphorique, la piscine dans laquelle prend place le match est le cadre du combat des idées (feintes, coups sous l'eau, lobs et autres tromperies).
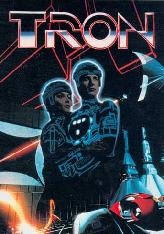
Une autre décennie s'achève, sur des évolutions majeures. Tout d'abord, l'évolution technique et technologique. Rivalisant d'effets spéciaux, les grosses productions des années quatre-vingt repoussent toujours plus loin les limites du faisable et stimulent l'avènement de nouvelles techniques. L'image de synthèse envahit les productions audiovisuelles et ne tarde pas à faire son trou au cinéma. Des films comme La Guerre des Etoiles ou Star Trek utilisent l'image synthétique. Tron (1982) de Steven Lisberger, marque comme étant le premier long métrage à utiliser l'informatique dans ses trucages. 80% des décors du film sont peints par ordinateur et quinze minutes sont réalisées sans intervention humaine. L'image de synthèse révolutionne les effets spéciaux et l'animation.

Qui veut la peau de Roger Rabbit ?Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé par Robert Zemeckis et animé par Richard Williams est un bon et grand exemple de l'intervention des techniques d'animation modernes dans un film de fiction. Toutes ces évolutions techniques promettent de nombreuses performances et des rebondissements pour les années à venir. Alors que l'on criait à l'aube de la décennie, à la mort du cinéma, les années quatre-vingt ont démontré que le cinéma change mais ne meurt pas. Après le passage du muet au parlant, puis celui du noir et blanc à la couleur, le cinéma a dû s'adapter à nouveau, courant des années 1980, et a dû apprendre à cohabiter avec la télévision par satellite, le câble et la cassette vidéo. Aux statistiques alarmistes de fréquentation des salles répondent des succès extraordinaires comme ceux remportés par les films de Spielberg (la trilogie Indiana Jones, E.T.). Avec des films comme Batman qui atomise les records en cette fin de décennie, le cinéma montre, qu'en plus de n'être pas mort, il représente une gigantesque "pompe à fric" universelle. Mais cette industrialisation du cinéma n'est pas à diaboliser. Les indépendants et autres "libres penseurs" existent. L'innovation et la créativité cinématographique, même dans une Amérique commercialement surorganisée, sont des valeurs qui persistent. En attestent les films de Steven Soderbergh, des frères Coen, de Jim Jarmusch ou de Spike Lee, par exemple et pour ne se limiter qu'aux Etats-Unis.