Dossier cinéma - Les années soixante-dix (1970-1979)
Cinéma / Dossier - écrit par iscarioth, le 09/08/2006
L'époque post-soixante-huitarde est un moment très faste pour le cinéma militant qui se décentralise en des groupes de production et de diffusion très actifs, tournant en 16mm ou en vidéo, autour des principales luttes de l'époque : féminisme, combat ouvrier, paysan, pacifique, etc. Des coopératives s'attaquent au système cinématographique en place, avec le Cinema Action en Angleterre ou l'Ecole de Berlin en RFA. Le cinéma français aborde l'envie de "déconstruire", selon la formule de Derrida, le réel. Jean-Luc Godard théorise au sein du groupe Dziga Vertov. Partout dans le monde, les cinémas filment la lutte sociale ou la libéralisation nationale (Woodstock de Wadleigh en 1969 pour les Etats-Unis et L'heure de la libération a sonné de Srour en 1974 pour le Liban). Les réalisateurs, devenus auteurs, militent au travers de leurs films et pensent faire changer les mentalités, évoluer les choses. Certains vont même jusqu'à risquer leurs vies, en Amérique du Sud. Certains pays comme la Suisse ou le Canada font leur mu assez tardivement, avec entre dix et quinze ans de décalage par rapport à des pays comme la France (Nouvelle Vague) ou l'Angleterre (Free Cinema). L'Allemagne sort d'un long coma cinématographique. Un cinéma d'une extrême richesse s'y développe dans les années 1970 en RFA avec des hommes comme Werner Herzog et Wim Wenders. Le cinéma d'auteur prend une assise planétaire. A coté de cela explose le pornographique, aux Etats-Unis, d'abord, puis dans le monde. A grand coup de scandales, un peu partout, le cinéma dit "porno", que l'on voit aujourd'hui plus comme un cinéma érotique, va venir dépoussiérer toute une mentalité assujettie au puritanisme. Nagisa Oshima lance son film de "pornographie artistique" en 1976, L'empire des Sens. En France, il y a Emmanuelle de Just Jaeckin en 1974, qui attire huit millions de spectateurs et la Bonzesse de François Jouffa. Puis éclate le scandale de Histoire d'O. Le travail de libération sexuelle entamée dans les années 1960 va trouver un parachèvement dans les années 1970 au travers de cette "libéralisation de la pornographie". En France, on passe de 15 à 111 salles spécialisées, entre 1972 et 1975. Aucune coïncidence. Un cinéma porno qui gagne tous les cinémas mais aussi un air de pornographie qui gagne tout film d'alors. Des films qui ne sont pas pornographiques à proprement parler banalisent la nudité et le sexe en entraînant même le star-system. Rappelons nous Les Valseuses avec Miou-Miou , Patrick Dewaere et Gérard Depardieu et Dernier tango à Paris avec Maria Schneider et Marlon Brando. D'ailleurs, pour parler du star-system, il se porte on ne peut mieux. Un énorme renouvellement générationnel a lieu. Aux Etats-Unis, Al Pacino, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robert Redford et Robert De Niro, pour les hommes, lançent leurs carrières. Pour les femmes, on parle de Faye Dunaway, Diane Keaton et Jill Clayburgh. En France, Dominique Sarda, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Léaud et Claude Brasseur viennent enrichir les productions. Chez les femmes, Miou-Miou, Nathalie Baye, Isabelle Adjani et Isabelle Huppert s'imposent. Aux Etats Unis, après Easy Rider en 1969, naît le nouvel Hollywood, le nouvel âge d'or. L'industrie hollywoodienne en crise, fin des années soixante, va débusquer de nouveaux talents dans les universités. Le cinéma n'est plus une affaire artisanale, il s'intellectualise. Sous l'impulsion de la Nouvelle Vague française et poussé par le désastre de grande entreprises financières comme Cléôpatre (1963), Hollywood va faire preuve d'une volonté de renouveau. Les nouveaux talents qui émergent dans les années soixante-dix aux Etats-Unis sont pour la plupart des anciens universitaires : Francis Ford Coppola (U.C.L.A), Martin Scorsese (N.Y.U.), Brian De Palma (Columbia University), George Lucas, John Carpenter (U.S.C., Californie). Cette nouvelle génération est plus consciente de l'impact du cinéma et tente de moderniser les sujets, elle s'impose très tôt dans les années soixante-dix... Ainsi, les nouveaux nababs d'Hollywood s'appellent Coppola, Lucas, Scorsese, Spielberg, avec des films clés comme Taxi Driver, Les dents de la mer ou Le Parrain... A noter aussi, la production cinématographique à partir de 1970 est colorisée à 99%. En 1960, le cinéma couleur ne représentait que 9% de la production cinématographique totale. Une avancée fulgurante alors que de nouvelles innovations comme le magnétoscope pointent le bout de leur nez...

L'enfant sauvageL'enfant sauvage, le dixième film de Truffaut, est réalisé dans un noir et blanc magnifique. Le film reprend le récit écrit en début de siècle par un médecin, sur le cas d'un enfant loup découvert en 1798, en pleine forêt. Truffaut s'est inspiré de l'histoire la plus crédible et du cas le plus extrême, celui observé par le Docteur Jean Itard, qu'il incarne dans le film, qui a conservé son expérience dans un mémoire. Le médecin en question a tenté de faire d'un enfant hirsute et se déplaçant comme un animal, un homme. Les années 1970 sont peut être davantage marquées par Truffaut acteur que par Truffaut réalisateur. Avec L'enfant sauvage, Truffaut se donne pour la première fois un rôle. « De cette expérience, je ne retiens pas l'impression d'avoir joué un rôle mais simplement d'avoir dirigé le film devant la caméra et non derrière, comme habituellement » nous confie-t-il. Jean-Pierre Cargol, un enfant gitan, tient le rôle du sauvage dompté. « Pour la première fois, je me suis identifié à l'adulte, au père » avouera Truffaut. Avec L'enfant sauvage, Truffaut boucle en quelque sorte le cercle entamé avec les Quatre cents coups, tourné un peu plus de dix ans plus tôt. « Je m'en suis aperçu après coup ; pendant que je tournais le film, je revivais un peu le tournage des Quatre cents coups pendant lequel j'initiais Jean Pierre Léaud au cinéma, pendant lequel je lui apprenais au fond ce qu'était le cinéma ». D'ailleurs, la même année, sort en salles le quatrième opus des aventures d'Antoine Doinel. Il s'agit de Domicile Conjugal. Depuis les Quatre cents coup, Truffaut, en compagnie de Léaud, son acteur fétiche, a réalisé Antoine et Colette en 1961, un sketch sur l'amour, puis, Baisers Volés en 1968 où l'on voit Antoine rentrer du service militaire et chercher du travail, pour finalement découvrir l'amour. A propos d'Antoine Doinel, Truffaut avouera franchement dans plusieurs interviews que le personnage est une synthèse de deux personnes réelles, à savoir lui et Jean-Pierre Léaud. Même si la dimension autobiographique et la gravité du propos s'allègent, dans cette série, depuis les Quatre cents coups, l'écriture de Truffaut a gardé toute sa fraîcheur et sa nostalgie.

Yves Montand et Simone Signoret sont reconnus pour leurs convictions communistes. Ils reviennent avec l'Aveu sur certaines de leurs erreurs à ce sujet. Parce qu'il avait fermé les yeux sur bien des méfaits perpétrés par les dictatures de l'est, Yves Montand avait besoin de se racheter et de régler ses comptes avec son passé politique. L'Aveu se déroule à Prague, en 1951 où un ministre est enlevé dans la rue, pour subir de violents interrogatoires. Le film est adapté par le scénariste Jorge Semprun, lui aussi gauchiste marqué, du roman autobiographique d'Arthur London. Il dénonce une Tchécoslovaquie aux méthodes policières. Pour incarner le rôle d'Arthur London dans L'Aveu, Yves Montand, acharné et plein de convictions, se soumet à un régime draconien. En six semaines, il perd une quinzaine de kilos. A la sortie du film, la presse salue unanimement l'incroyable performance de l'acteur qui fait véritablement corps avec son personnage. Costa-Gravas commentera : « Il était complètement dans le personnage. Il le vivait. Il souffrait jour et nuit. Je pense que c'est un cas unique où un acteur a pu à ce point s'impliquer dans son rôle. » Le film représente le meilleur pèlerinage politique qu'un acteur de la classe de Montand puisse offrir au public.

Les auteurs de la Nouvelle Vague sont assez productifs cette année. Truffaut, on l'a vu, avec ses deux films, mais aussi Rohmer avec Le Genou de Claire qui raconte les troubles d'un trentenaire face aux genoux d'une jeune fille, dans la chaude ambiance d'un été édénique au bord du lac d'Annecy. Enfin, la quatrième roue du carrosse après Jean-Luc Godard, Claude Chabrol et son Boucher. Mademoiselle Hélène, institutrice (Stéphane Audran) rencontre au cours d'une noce le boucher Popaul (Jean Yanne). Le jovial Popaul va s'avérer être en fait un dangereux assassin. Avec Le Boucher, l'auteur nous livre un film qui ne manque pas de piquant sans toutefois verser dans la méchanceté. « Le jeu du boucher, c'est la nature humaine, sa foncière ambiguïté, le bien, le mal, l'innocence, la perversion, l'ambivalence... »
M.A.S.H. est le film américain de l'année 1970 au plus fort retentissement mondial. Sur la croisette, le film de Robert Altman remporte le grand prix. Il s'agit d'une comédie qui se 
déroule pendant la guerre de Corée, dans un hôpital militaire où trois chirurgiens se préoccupent plus de leur vie sexuelle que de leur métier. Le film est une parabole à la guerre du Vietnam et se prononce ouvertement et avec humour contre les boucheries inutiles. Altman était devenu un réalisateur actif dès les années 1960 mais c'est M.A.S.H. qui le fait accéder à la reconnaissance internationale. Lorsqu'il accepte de mettre en scène le scénario de Ring Lardner Jr (adapté du roman autobiographique de Richard Hooker), Altman succède à plus d'une dizaine de réalisateurs qui ont tous jetés l'éponge face à un film dont le seul tournage déchaîne les scandales. M.A.S.H. est peut être le film le plus irrévérencieux et le plus engagé de tout le cinéma américain traitant des problèmes du pays en Asie du sud-est... Plusieurs films américains osent traiter du sujet ouvertement, mais rarement aussi tôt. Nous sommes en 1970, rappelons le. L'insolence est portée à l'écran par les anticonformistes et antimilitaristes capitaines Hawkeye, Duke et Trapper.
Film de guerre bien plus conforme, Patton de Franklin J. Schaffner est un portrait du fameux stratège américain, le général George Patton : son génie, son charisme, sa victoire sur Rommel et sa chute. Le film est encensé par les critiques à sa sortie et récolte huit oscars l'année suivante. A ce propos, pendant le cérémonie, Schaffner, nominé dans la catégorie du meilleur réalisateur, refuse l'Oscar qui doit lui être remis, car il se dit « écoeuré par les bassesses auxquelles se livrent les autres comédiens pour avoir la statuette ». C'est une première dans l'histoire des Academy Awards.
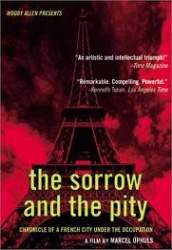
Le Chagrin et la Pitié est un documentaire signé Marcel Ophuls pour la télévision. Le film est un coup porté au mythe gaulliste d'une France unanimement résistante. Le cinéaste présente, sous forme de chroniques, la vie quotidienne d'une ville sous l'occupation, Clermont-Ferrand. Le film devait être réalisé pour la télévision française. L'ORTF a refusé d'acheter le film et ce sont finalement les télévisions de Suisse et de RFA qui l'ont acquis. C'est la démystification d'une France trop souvent vue comme unie courageusement contre l'envahisseur. Un chef d'oeuvre du cinéma de montage de plus de quatre heures, Le Chagrin et la Pitié contraste avec les fictions héroïques et chauvines produites par le cinéma français de l'époque sur le sujet. Le film est très marqué à gauche et renvoie Pétain et De Gaulle dos à dos. Malgré la subjectivité, inhérente à tout travail de montage, la synthèse est très pertinente. Avec le recul, on rend souvent hommage à ce film pour avoir crevé l'abcès de l'Occupation, exorcisé les vieux mythes du resistancialisme gaullien et montré pour la première fois une France peuplée à 80% de lâches et à 20% de héros, et non l'inverse. Sous-titré Chronique d'une ville française sous l'occupation, le film est diffusé sur le petit écran en RFA, en Suisse, en Hollande et même aux Etats-Unis où il récolte un franc succès. Mais pour la France, il se heurte au blocus de l'ORTF, qui refuse d'acheter les droits. Le PDG de l'ORTF, Jean-Jacques Bresson, dira à propos du film qu'il « détruit les mythes dont les Français ont encore besoin ». Mais justice sera faite par l'intermédiaire du grand écran. Le Chagrin et la Pitié sort en avril 1971 dans une petite salle parisienne et triomphe peu de temps après un peu partout en France.

En Grande Bretagne, Family Life saisit par la probité de son discours. Un constat irréfutable qui va défrayer la chronique de l'autre coté de la manche. Kenneth Loach, dans un style toujours très documentaire, de « reportage », va suivre l'adolescence douloureuse de Janice, enceinte. Ses parents sont de petits bourgeois aux idées bien arrêtées. Sa mère délivre des jugements sans appel sur, entre autres, l'avortement (« c'est dégoûtant, ce n'est pas chrétien »), la sexualité (« une très belle chose quand elle est à sa place, dans le mariage »). Apprenant que leur fille est enceinte, ces derniers vont l'obliger à avorter puis à consulter un psychiatre. Ce dernier tend à convaincre la petite famille que l'origine des troubles de la jeune femme est l'atmosphère même du foyer. Les parents se braquent et envoient leur fille chez un autre psychiatre, grand adepte des tranquillisants et des électrochocs. Loach met en question l'institution familiale et psychiatrique en démontrant avec rigueur comment parents et société peuvent transformer une simple crise d'adolescence en maladie mentale. Le témoignage, la véracité de ce film-reportage, saisi sur le vif amène un constat irréfutable et accablant. Le film choque tellement les associations de parents réactionnaires et le corps médical traditionnel que la sortie du film à Paris est ajournée pour être ensuite cantonnée à une petite salle du Quartier Latin en VO. Car si le film de Loach perturbe, c'est bien parce qu'il n'est pas qu'une simple fiction. On retrouve dans l'Angleterre des années 1970 le même climat qu'en France fin des années soixante. La jeunesse étouffe sous le poids d'une société aux valeurs obsolètes. A l'instar de la France, la Grande-Bretagne remet en cause la société et ses assises : sa structure, son fonctionnement, ses objectifs. Le film de Loach illustre bien cet esprit de contestation en s'interrogeant sur le rôle de la famille, vecteur de transmission des valeurs établies. D'où l'universalité et l'atemporalité de ce film, au discours d'une importante crédibilité. L'oeuvre toute entière de Loach, cet héritier du Free Cinema, peut se résumer en une seule phrase : « Le cinéma doit restituer la vie dans sa totalité ».

Aux Etats-Unis, en 1971, sort un florilège de films qui révèlent de nouveaux chefs d'oeuvre ou les balbutiements de nouvelles carrières. Tout d'abord, la justice faite à un homme ; Dalton Trumbo, le scénariste de Spartacus, qui récolte enfin les honneurs qui lui sont dus après les difficiles années du maccarthysme et celles de l'errance. Ce grand ami de Bunuel livre en 1971 sa seule et unique réalisation : Johnny s'en va-t-en guerre, le plus efficace des pamphlets contre la guerre et ses barbaries, reconnu à ce jour. Le film raconte la souffrance d'un homme démembré et qui a perdu, à la suite d'un éclat d'obus, tous ses sens. Il ne lui reste plus que son front et son torse pour ressentir la chaleur du soleil qui pénètre sa chambre d'hôpital, par la fenêtre. Un hôpital dans lequel il se retrouve confiné, à l'abri des regards. Présumé décérébré, le soldat est choisi pour donner son corps mutilé à la science. Pourtant, Joe vit toujours. On entend ses vociférations craintives supplier ses bourreaux, en voix off. Sa seule échappatoire à la souffrance est le refuge dans un monde de souvenirs et de rêves. Lorsqu'il arrive, par l'intermédiaire du morse, à se faire comprendre, ses bourreaux lui interdiront la toute dernière chose qu'ils puissent faire pour le soulager de cette existence déshumanisée : l'euthanasie. On ne peut que s'identifier à la victime, Joe, martyre incarné avec sobriété et lyrisme par Timothy Bottoms, et souffrir avec lui. Dalton Trumbo a adapté pour ce film son propre roman, écrit en 1938, à un moment peu favorable à l'expression de pensées pacifistes. Jusqu'à de nos jours, bien des écrits qui traitent des vétérans et des blessés de guerre renvoient au chef d'oeuvre de Trumbo, qui exprime avec une véracité inégalée la souffrance de profondes blessures que l'on camoufle. Une oeuvre intemporelle et universelle qui reçoit le prix spécial de la critique internationale à Cannes en 1971.

Orange mécaniqueCôté anglais, un autre film à message et ayant fait parler de lui défraye la chronique. Il s'agit de Orange mécanique, le chef d'oeuvre de Stanley Kubrick. Ce film, selon les propres mots de son créateur, parle « des tentatives pour limiter le choix de l'homme entre le bien et le mal ». Une oeuvre jugée étrange, excessive, déplaisante, violente, provocante, visionnaire... Bref, un sujet qui divise à l'époque autant qu'il impressionne. Le film se déroule dans un monde futuriste où la volonté individuelle d'un adolescent de seize ans, incarné par Malcolm MacDowell, est combattue par la violence sociale, organisée, hiérarchisée... Comme la plupart des films de Kubrick, Orange Mécanique est divisé en trois parties : la première est la description de la violence gratuite et jubilatoire (l'attaque du clochard) qui déroute par sa façon de mêler instincts animaux de l'homme (lutte pour la domination et le territoire) et évolutions culturelles (sensibilité à l'art, Beethoven). Puis survient l'arrestation d'Alex, abandonné par ses sbires, et sa domestication, qui passe par une déshumanisation, le vidant de toute pulsion sexuelle ou agressive. « Les aventures d'Alex sont une sorte de mythe psychologique. Notre subconscient trouve un soulagement en Alex comme il en trouve un dans les rêves. Il souffre de voir Alex bâillonné et puni par les autorités pendant qu'une bonne partie de notre conscient avoue qu'il faut qu'il en soit ainsi ». commentera Kubrick. Le film est l'un des premiers à ce point montreur de violences, avec des scènes de viol, notamment. Il déchaîne les ligues de vertu. Beaucoup de critiques s'effraient devant ce qui semble être une sophistication de la violence. Alex se fait le bourreau d'un couple en dansant et en chantant comme dans un film de Minnelli, devant un mari qui voit sa femme violée. Sur des tonalités quasi-artistiques, Alex déchire esthétiquement la robe de la jeune femme de manière à ce que l'on voit ses seins. Le film génère une ambiguïté scandaleuse que s'empresse de contrecarrer Kubrick qui insiste sur le fait que Orange Mécanique est bien une dénonciation du sadisme et pas son apologie. Un député travailliste, au moment de la sortie du film, écrit dans Evening News que « les oranges mécaniques sont des bombes qui font tic-tac ».
Comme nous l'avons souligné tout à l'heure, 1971 est une année marquée par les débuts de nouveaux monstres sacrés d'Hollywood. Avec tout d'abord les débuts américains du tchécoslovaque Milos Forman, immigré depuis 1968. La greffe avec les Etats-Unis prend bien. En atteste le succès du film Taking off dans lequel il évoque l'affrontement de deux générations à travers la fuite d'une jeune fille (Linnea Heacock). Avec ce film, Milos Forman, issu d'un régime communiste, pose un regard d'une objectivité nouvelle sur l'american way of life. Dans le film, les parents de la jeune fugueuse vont jusqu'à se droguer et s'initier aux orgies pour tenter de comprendre leur fille !
Il y a ensuite Woody Allen qui, avec son quatrième film, Bananas, perce véritablement à Hollywood. Allen, révélé au grand public avec Prend l'oseille et tire-toi en 1969, explose véritablement dans ce film. Ce juif-athée de Brooklyn, féru du non-sens, surdoué de l'aphorisme et fils spirituel de Groucho Marx est, aux yeux du monde et pour de nombreuses années, vu comme le maître du comique made in New York. Un génie ? Juste un bon dialoguiste disent certains. Quoiqu'il en soit, Bananas, comédie satirique sur la situation révolutionnaire dans un pays d'Amérique du Sud, remporte un franc succès en cette année 1971.
Cette année de cinéma est aussi marquée par Cannes et son 25ème anniversaire. Pour l'occasion, un prix spécial est décerné. Luchino Visconti reçoit le prix du 25ème Festival pour son film Mort à Venise. La dernière oeuvre du maître italien raconte l'arrivée de Gustav Aschenbach dans une ville meurtrie par une épidémie de choléra et à la veille de la première guerre mondiale. Le compositeur tombe rapidement amoureux d'un beau et riche adolescent. Autre film primé, Le Messager de Joseph Losey qui reçoit le grand prix. Le film raconte l'histoire d'un garçon pauvre invité par son richissime ami dans le château familial. Il va servir de messager à des amours impossibles.

Le parrain1972 est une bonne année pour Marlon Brando, au sommet de son art. Il s'illustre dans deux films au fort retentissement : Le Parrain de Francis Ford Coppola, un moment important dans l'histoire du cinéma et le sulfureux Dernier Tango à Paris de Bertolucci, un film qui marque, lui, plus la chronique des scandales. Le prestige de l'acteur s'était un peu assagi. Fin des années soixante, début des années soixante-dix, plus personne n'engageait Brando, réputé pour ses humeurs insupportables sur les plateaux. Le succès du Parrain donne un nouveau souffle à la carrière de l'acteur. Le Parrain est adapté du best-seller de Mario Puzo et nous plonge au coeur des familles mafieuses des années quarante. Don Vito Corleone, grand patron de la Mafia et personnage principal du film est incarné par Marlon Brando. A la mort de ce dernier succède à la tête de l'empire le fils : Michaele Corleone, alias Al Pacino, qui doit poursuivre l'oeuvre du père avec la même impitoyable cruauté. A ces deux acteurs de classe s'ajoutent des pointures comme Robert Duvall et Diane Keaton. Le scénario est musclé et signé Coppola, avec des dialogues soignés. Le film est aussi bien servi par la bande originale, menée par Nino Rota. Mais, au-delà de l'ampleur du budget et du casting, c'est certainement le choix du réalisateur qui s'est avéré primordial et qui a permis un aussi grand film. La Paramount, au lieu de confier la réalisation du film à une valeur sûre d'Hollywood qui aurait certainement bouclé un énième film policier prévisible à souhait et bourré d'académismes, confie le projet à un jeune chien fou, impatient d'en découdre : le petit-fils du chef d'orchestre Carmine Coppola : Francis Ford. Il est à noter que la société productrice du film, avant de faire appel à Coppola, s'était tournée vers trois autres réalisateurs : Peter Yates, Costa-Gavras et Arthur Penn, qui ont tous refusé de faire le film. A titre anecdotique, on peut souligner le scandale de Brando aux Oscars. L'acteur refuse l'Oscar pour le rôle de Don Corleone en signe de protestation contre le massacre des Indiens perpétré par l'Etat américain.

Le dernier tango à ParisRevenons donc à Brando. Après Le Parrain, Dernier Tango à Paris. Le célèbre réalisateur italien Bernardo Bertolucci réunit pour le coup une série de grands comédiens, d'horizons différents : "l'enfant" de Truffaut : Jean-Pierre Léaud, une débutante : Maria Schneider et le monstre d'Hollywood : Brando. Le premier rôle masculin du film a été proposé à Jean-Louis Trintignant qui a écarté, par pudeur, la proposition de Bertolucci. Alors que très peu du film a transpiré (celui-ci ayant été tourné intra-muros), une réputation sulfureuse le suit déjà de très près. Le synopsis est assez révélateur. Il s'agit de l'histoire d'un jeune américain cynique à la recherche d'un appartement qui rencontre une jeune française avec laquelle il va vivre une grande passion sexuelle. Interdit aux moins de seize ans en France, ce poème entre Baudelaire et Bataille est un monument de l'érotisme. Véritable explosion scandaleuse du début des années soixante-dix, le film a été interdit dans plusieurs pays et classé X dans d'autres. Beaucoup s'offusquent face à ce film aux corps à corps fiévreux et sadomasochistes dans lequel Marlon Brando sodomise sa partenaire avec du beurre. On s'offusque aussi de la nudité quasi-constante de Maria Schneider. Henry Chapier écrit pour Combat : « Ce poème est un cri perçant, une gifle, un coup de poignard dans le dos ». Comme souvent, les défenseurs de la morale élèvent la voix. L'US Catholic Conference inscrit Le dernier tango à Paris sur la liste de ses films condamnés, liste qui contient d'ailleurs un certain Tramway nommé désir !
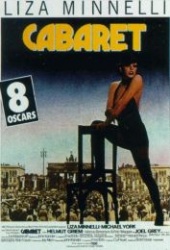
Avec West Side Story, Cabaret est le dernier grand avatar de la comédie musicale hollywoodienne. Un film qui est en quelque sorte le chant du cygne du genre musical. Le danseur, chorégraphe et metteur en scène Bob Fosse exorcise le nazisme par le chant et la danse. Bob Fosse est parti d'un film anglais de 1955, signé Henry Cornelius et nommé I am a camera. Cabaret se déroule dans le Berlin des années trente et raconte l'histoire d'une « néo-Lola-lola » amoureuse d'un jeune homosexuel anglais. A l'image de l'immortelle Marlene Dietrich dans L'Ange Bleu, Liza Minnelli, digne fille de Judy Garland et de Vicente Minnelli, accède à la gloire avec ce premier grand rôle pour lequel elle obtient un Oscar. Lorsque Bob Fosse se lance dans cette tragi-comédie berlinoise, sa filmographie n'est épaisse en succès que du film Sweet Charity, tourné en 1969. Bob Fosse, avec Cabaret, s'aventure sur des terres encore inexplorées : celles du musical politique. Aborder l'Allemagne hitlérienne des années trente sur une trame musicale : le pari était osé, il a été remporté.

DélivranceAutre film marquant de l'année 1972 aux Etats-Unis, Délivrance du réalisateur anglais John Boorman. Une fresque écologique qui vire au drame. Il s'agit de quatre jeunes citadins qui décident de s'éloigner de l'univers urbain et de s'aventurer en Georgie du Nord, où la nature est aussi sauvage que la population. Nos aventuriers en herbe sont attaqués par des autochtones. Le film est une référence pour toute une génération de jeunes cinéastes et de cinéphiles spécialisés dans le film gore ou d'épouvante. Alors que dans les années 70, toute une partie de la jeunesse prônait le retour à la nature dans laquelle les hommes pourraient vivre en parfaite harmonie, John Boorman nous donne à voir un état de nature d'une extrême violence. L'homme est sauvage, primitif. Seule la civilisation permet de dompter ses bas instincts. Deliverance va faire des émules, et ce, jusqu'à nos jours.
On peut signaler La Dernière maison sur la gauche, un film de Wes Craven, deux ans seulement après la sortie du film de Boorman, qui lui aussi s'attaque aux doux rêves du retour à la nature et du calme sauvage. Plus récemment, on peut noter Le Projet Blair Witch de Myrich et Sanchez.

Jeremiah JohnsonLors de cette même année 1972, Sydney Pollack exploite lui aussi le thème de la nature, d'une façon toute différente, avec Jeremiah Johnson. Fuyant la civilisation, Jeremiah Johnson s'est réfugié dans les montagnes du Colorado. Entretenant de bonnes relations avec les Indiens, il adopte un enfant de pionniers massacrés, se lie avec un trappeur et épouse la fille d'un chef indien. Installé dans une cabane d'hiver, il mène avec sa famille une vie sereine jusqu'au jour où les Indiens, irrité par la profanation de leur cimetière, se vengent en tuant sa femme et son fils...Le film de Pollack est en cassure avec la tradition westernienne. Ce n'est plus un peuple qui s'érige en nation mais un homme qui se forge une identité. Une odyssée solitaire filmée avec simplicité, éloignée des codes usés du genre d'aventure. La construction cyclique, la majesté du site naturel et le talent de Robert Redford s'allient pour nous offrir ce western à dimension universelle.

Charles ChaplinLe cinéma américain se porte bien, début des années soixante-dix. Il est en pleine mutation, en pleine régénération. C'est à ce moment, où Hollywood retrouve une nouvelle jeunesse, qu'une des grandes figures de son passé resurgit. Chaplin, alors octogénaire, reçoit à l'occasion de la 44ème cérémonie des Academy Awards un Oscar spécial pour « sa contribution exceptionnelle inappréciable à faire du cinéma l'art du XXème siècle ». Un Oscar de réconciliation. Assez injustement, Chaplin est écarté de la cérémonie des Awards depuis le commencement, c'est-à-dire 1929. Monsieur Verdoux et Un roi à New York, films aux messages qui ont fortement déplu aux autorités états-uniennes, sont réhabilités au cinéma et à la télévision américaine. Charles Chaplin s'éteint quelques années plus tard, en 1977.
Le cinéma hongrois a toujours été pauvre. Ce si petit pays a longtemps été handicapé par des moyens de production médiocres et/ou archaïques. La plupart des grandes personnalités du cinéma du pays se sont exilés (Alexander Korda, Michael Curtiz). Pendant la guerre froide, le pays se trouve du côté rouge du rideau de fer et son cinéma met du temps à s'extirper de l'influence stalinienne et à renaître de ses cendres. Cette renaissance se manifeste fin des années cinquante et est effective dans les années soixante. La figure de proue du Nouveau Cinéma Hongrois est sans conteste Miklos Jancso (Les Sans-Espoirs, 1965). C'est de lui que nous vient le Psaume Rouge de cette année 1972. Depuis toujours, Jancso traite de sujets graves, sur trame historique : l'univers concentrationnaire et la traque des révoltés dans Les Sans-Espoirs, les répressions de 1919 dans Silence et cri. Dans son dernier film, Psaume Rouge, il ne change pas d'optique. Il décrit dans ce film les révoltes paysannes hongroises du siècle dernier et la répression sanglante qui s'ensuit. Ce n'est pas un hasard si Jancso s'éternise sur ces mêmes thèmes de rébellion, de tyrannie et de souffrances. Il est à l'image de son pays et de son histoire : meurtri par les injustices.
Du côté de l'hexagone, la sortie de Tout va bien marque le retour de Jean-Luc Godard sur grand écran. En consultant la plupart des filmographies sélectives que l'on dresse à propos de la carrière du cinéaste, on peut observer un curieux vide entre 1967 (Week-end, La Chinoise) et 1972 (Tout va bien). Godard a pourtant réalisé un bon nombre de films pendant ce laps de temps. Mais ceux-ci restent assez méconnus, difficilement trouvables, ce sont des films militants, produits avec la cellule audiovisuelle de gauche Dziga-Vertov. On peut citer, en vrac, Vert d'est, Pravda (1969), Lotte in Italia, Jusqu'à la victoire, Vladimir et Rosa (1970)... Tout va bien est un film à plus grande portée. Il est à l'affiche dans presque tous les cinémas de France. Selon les propres dires de Godard, il a pour but de fournir « une ambiance mondiale » aux thèses gauchistes. Le film, une analyse didactique d'une grève, déçoit beaucoup par son militantisme forcené et, disent certains, « infantile ».

En 1973 perce George Lucas avec American Graffiti. Tourné avec moins d'un million de dollars de budget, le film de Lucas n'a pas le profil de la bombe commerciale. Et pourtant ! Son film, nostalgique de l'Amérique du début des années soixante et largement inspiré de sa propre jeunesse est le succès de l'année. Beaucoup courent voir le film qui ressuscite les rythmes endiablés de l'Amérique pré-Vietnam, relatant de la soirée estivale d'un groupe de jeunes copains. George Lucas, le fameux réalisateur de la saga Star Wars, lance sa carrière avec ce premier succès. C'est aussi le cas de Martin Scorsese qui, dans un genre tout différent, signe sa première réussite avec Mean Streets. C'est le début d'une longue et fructueuse collaboration entre Robert De Niro et Martin Scorsese avec ce film qui prend pour centre la vie d'une bande de petits truands de la Little Italy de New York.
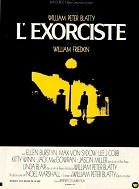
Les Etats-Unis, en 1973, frémissent devant le film de William Friedkin qui est, pour beaucoup, l'un des summums du genre fantastique. Après The French Connection qui a fait de lui, en 1971, un réalisateur de renommée internationale, William Friedkin signe L'Exorciste. Réalisé avec un budget conséquent, le film propulse le genre sous-exploité de la démonologie au statut de superproduction. Un film d'une telle violence ne présumait pas un succès commercial si prononcé. L'exorciste reste dans les mémoires comme étant le film le plus terrifiant jamais produit. Un engouement et un mysticisme extraordinaire entoure rapidement cette oeuvre qui ne repose pas sur le seul thème de l'exorcisme. Le prêtre du film, qui a de sérieux doutes sur sa foi, incarne une église qui a perdu de sa spiritualité et de sa force. Le simple fait que l'innocente fillette, dont la vie quotidienne nous est narrée lors des premiers moments du film, soit ainsi malade et possédée, inconforte le spectateur dans son impuissance.
Coté français, on peut souligner la grande année de Jean-Pierre Léaud. Le fils prodigue de Truffaut est à l'affiche des deux films les plus marquants de 1973 : La Maman et la Putain et La Nuit américaine. Celui qui restera à jamais dans les mémoires Antoine Doinel fait preuve de ses talents dans un nouveau film de Truffaut. « Même quand il dit bonjour, nous basculons dans la fiction, pour ne pas dire la science fiction » a écrit ce dernier sur son protégé. La Nuit américaine est une mise en abyme du cinéma, le film raconte la vie d'une équipe sur un tournage.

La maman et la putainLa Maman et la Putain est l'oeuvre phare de Jean Eustache. L'une des créations les plus fortes du cinéma français d'alors. Jean-Pierre Léaud s'y illustre aux cotés de Françoise Lebrun et de Bernadette Lafont. Dans le Paris des années soixante-dix, filmé comme un village, trois êtres vivent entre eux des rapports à la fois banals et inédits, exacerbés par le regard impitoyable du réalisateur. Ce dernier, un peu à l'image de Jean Vigo, est l'un de ces cinéastes "maudits". Véritable cinéphile, se tenant toujours à l'écart des notions de notoriété, de réussite et de carrière, Eustache avoue tourner sous le coup d'une forte nécessité intérieure. Sa légende est scellée lorsqu'il se suicide en 1981. Réalisateur attaché aux choses simples, ordinaires, Jean Eustache sait en prélever la sève et en percer l'intériorité d'une façon impressionnante. La Maman et la Putain est un exemple flagrant. Construit autour de longs plans séquence captant des discussions souvent faussement anodines car très écrites, le film peut être vu comme très naturaliste. Eustache explique son cinéma en ces mots : « C'est le parti pris de ce film que tout soit raconté et que rien ne soit vu. Mon sujet, c'est la façon dont les actions importantes s'insèrent à travers la continuité des actions anodines. C'est la description du cours normal des événements sans le raccourci de la dramatisation cinématographique ». Les dialogues choquent par leurs coté cru. A cet égard, beaucoup de répliques restent mythiques (l'épisode du Tampax). Là encore la présence de Jean-Pierre Léaud est d'une importance capitale. Au sens propre, c'est un rôle taillé sur mesure pour sa personne. « J'ai écrit ce scénario car j'aimé une femme qui m'avait quitté. J'ai fait ce film pour elle et Léaud. S'il avait refusé de le jouer, je ne l'aurai pas écrit » avoue Eustache. Très largement autobiographique donc, La Maman et la Putain parait cinq ans après Mai 68 et l'on dit du film qu'il est le chant du signe de la Nouvelle Vague. A l'étrange scandale qui accompagne la sortie du film (on ne sait trop s'il était suscité par ce qui était montré ou par ce qui était dit) se juxtaposent paradoxalement des comparaisons très élogieuses. On parle des dialogues en citant Flaubert, Marivaux, Musset...

La grande bouffeLa Maman et la Putain a été choisi pour représenter la France au Festival de Cannes. Protestations et sifflets ont accompagné la projection du film sur la Croisette. Jean Eustache n'a pas été le seul réalisateur à subir les foudres de Cannes. Marco Ferreri, représentant lui aussi la France avec La Grande Bouffe, déchaîne les défenseurs du bon goût et de la morale. De nombreux « cinéphiles-patriotes » repoussent des deux mains ce film qui entache le prestige du cinéma français. Le secrétaire d'Etat Olivier Stirn déclare que le film de Ferreri n'est pas « représentatif de la culture française » mais qu'en réclamant sa censure on lui « fait une publicité qu'il ne mérite guère ». La Grande Bouffe relate l'histoire de quatre bourgeois qui s'enferment pour passer un « séminaire gastronomique » pendant lequel, à grand renfort de prostituées et sur fond de pets et de rots, il vont s'empiffrer jusqu'à en mourir. Robert Bresson, fâché que son film Lancelot du Lac n'a pas été admis dans la compétition, s'indigne : « Le Festival de Cannes enfonce le cinéma dans la médiocrité et l'erreur ». « Honte pour le producteur de ce film, honte pour son réalisateur, honte pour les comédiens » clame Jean Cau dans Paris-Match. Unanimement, la presse se déchaîne contre La Grande Bouffe. Louis Chauvet parle d'un film « gratuitement répulsif », Le canard enchaîné, de « comble de l'ordure ». Philippe Noiret, qui ne mâche pas ses mots, commente cette levée de bouclier : « Je suis stupéfait de la brutalité des réactions. Je pensais bien que ce film ne laisserait pas les gens indifférents mais à ce point là ! Ce sont des réactions viscérales, on se croirait revenu à l'ordre moral du Maréchal Pétain, à l'époque où l'on rendait responsable de notre défaite la pédérastie de Gide ». Le scandale vient peut-être de l'image que La Grande Bouffe renvoie de la société occidentale : une société décadente qui ne pense qu'à s'empiffrer et à forniquer. Ferreri s'explique : « J'ai réuni quatre exemplaires de l'homme physiologique : il y a le pouvoir (le juge), la culture (le producteur TV), l'aventurier (le pilote de ligne), l'art de préparer la bouffe (le cuisinier). Ce qui les rassemble, c'est le besoin de jouer à fond leur rôle de machine, une machine à manger, à baiser, à chier. Avec l'obsession de la mort, toujours présente ». Ferreri filme le fonctionnement de la machine humaine comme s'il s'agissait, au fond, de la réduire à sa nature primitive (l'homo sapiens). « C'est un reportage élémentaire au royaume de la physiologie. Rien de philosophique là-dedans » avoue-t-il lui-même.

De l'autre côté de l'Atlantique, un autre film est critiqué pour son prétendu mauvais goût et son obscénité. Il s'agit de Deep Throat ou Gorge Profonde de Gérard Damiano. Le film, à la base cantonné aux salles spécialisées, a connu un succès tel qu'il s'est étendu jusque dans les plus prestigieuses des salles new-yorkaises tel le Trans-Lux 85. C'est la première fois qu'un film pornographique sort ainsi du carcan qui lui a été dessiné. Un préambule aux polémiques qui ne vont pas tarder à agiter la France. Deep Throat, l'histoire d'une stakhanoviste de la fellation ayant le clitoris au fond de la gorge, représente un monde dont les règlements en matière de cinéma sont en plein dégel. Aux Etats-Unis, c'est l'abandon du code Hays qui a permis qu'on ose Deep Throat mais aussi, en 1974, Devil in Miss Jones, du même Damiano : l'histoire d'une vierge condamnée à forniquer pour l'éternité.
C'est en 1973 que B.B. fait ses adieux au cinéma. Déçue par l'échec du film Don Juan 73 de Roger Vadim dans lequel elle s'illustre aux côtés de Jane Birkin, dix-sept ans après Et Dieu créa la femme, elle annonce sa retraite prématurée (elle n'a alors que trente-neuf ans). Après une brève apparition dans L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise de Companeez, elle s'éloigne définitivement des plateaux. Elle n'hésite pas, au passage, à cracher dans la soupe : « J'ai tourné quarante-huit films. Sur ce total, il y en a eut cinq de bons. Le reste ne valait rien. Je ne tournerai plus. » Fidèle à sa réputation de femme parmi les plus belles au monde, elle rajoute : « Et je ne me rendrai jamais chez un chirurgien esthétique ! ».

Aguirre ou la colère de DieuDu côté de l'Allemagne renaissante, Werner Herzog offre un spectacle éloigné de ses oeuvres précédentes (des courts et des longs métrages d'avant-garde réservés à un public restreint), avec Aguirre ou la colère de Dieu, un film qui contrairement aux apparences, ne se veut pas historique. Allégorie au Troisième Reich, renouveau romantique, quête du Graal, mégalomanie... Beaucoup de choses viennent en tête lorsque l'on regarde le film d'Herzog, un film qui pose le problème du pouvoir politique et de ses abus au travers du personnage d'Aguirre, qui exerce une force entre fascination et répulsion sur ses troupes. Le style d'Herzog s'emploie à dénoncer l'imbécillité de la colonisation et du missionariat. Il s'agit d'une satyre qui s'inspire des exploits improbables du conquistador Don Lope de Aguirre. Le film est le début d'une collaboration fructueuse entre le talentueux réalisateur Werner Herzog et le frénétique acteur Klaus Kinski. Ce dernier incarne le personnage d'Aguirre au sens propre du terme. Il rentre réellement dans la peau de ce dément mégalomane, d'où quelques problèmes sur le tournage... La principale difficulté de ce tournage périlleux, mouvementé et conflictuel a tout de même été le cadre : l'Amazonie péruvienne, au climat difficile.
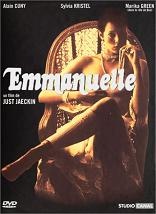
Comme on l'a vu plus haut avec Deep Throat aux Etats-Unis, le genre pornographique, jusque là parqué dans les salles spécialisés, gagne le public et tend à la banalisation. La tendance n'est pas marquée qu'aux Etats-Unis. En France, les films dits pornographiques sont maintenant projetés dans les salles de prestige, aux Champs Elysées et dans le Quartier Latin. Les affaires vont bien pour les producteurs et les distributeurs de films pornos. A vrai dire, elles n'ont jamais été si florissantes. Produire un film pornographique est très peu coûteux et peut rapporter beaucoup. La production triple lors de l'année 1974. Emmanuelle, porno très soft du réalisateur français Just Jaeckin est la preuve de cette effervescence. En à peine quelques mois, Emmanuelle est connue de tous et s'impose comme un modèle du genre érotique. En deux semaines, le film brasse deux millions d'entrées. Sylvia Kristel, actrice vedette du film, voit sa notoriété s'élever à un niveau qui n'a rien à envier aux stars d'un cinéma plus « classique ». L'intrusion de ce cinéma, aujourd'hui vu comme beaucoup plus érotique que pornographique (dans Emmanuelle, pas de pénétration, que des jeux sexuels), propose une évolution cinématographique conforme à l'évolution des moeurs. L'érotisme, en explosant, s'extirpe des limites géographiques dans lesquels on l'a contenu jusqu'alors (des salles de cinéma spécialisées aux cinémas de renom) et se diffuse dans l'ensemble de la production cinématographique d'alors. Le cinéma de grande industrie n'hésite plus, dès lors, à verser dans l'érotisme. Le phénomène déteint même sur cinéma d'auteur. Jusqu'alors, l'expression du désir sexuel n'a été permis que par la lointaine suggestion (on se souvient de Stroheim, avec son film Queen Kelly, sérieusement fustigé pour avoir dépassé les limites de la bienséance cinématographique). L'exhibition, en plus d'être désormais possible, se banalise. Autre référence de 1973 ayant fait hurler les défenseurs de la morale, La Bonzesse de François Jouffa.

Les valseusesLes Valseuses, film de Bertrand Blier, est symptomatique de cette libération sexuelle au cinéma. D'ailleurs, le courant de libération véhiculé par ce film n'est pas seulement sexuel, il est aussi moral et social. A tel point qu'on a parlé d'un « Orange Mécanique français ». Révélé par Hitler, connais pas en 1963, Bertrand Blier explose avec Les Valseuses, film adapté de son propre roman, qui récolte en cette année 1974, un grand succès en salle. Le film conte la dérive de trois loubards, empreints de liberté et fort portés sur le sexe. Le film ne manque bien évidemment pas de faire scandale par la crudité des dialogues et des situations, il est interdit aux moins de 18 ans. Le scandale est tel que les critiques ne se gênent pas pour déverser des flots d'injures contre le film. Ces derniers rivalisent d'inventivité pour vilipender le film de Blier : « décharge publique », « putride comme un abcès mal soigné », « moralement hideux », « cinématographiquement nul »... Mais leurs échappées lyriques sont sans effet sur la carrière du film. Les Valseuses n'est pourtant pas vide de sens et on tente de l'interpréter, avec le recul, comme étant l'annonce prophétique du malaise social qui va couvrir la France à partir des années quatre-vingt. Certains voient plus le film comme un pamphlet post-soixante-huitard, dans le sens où les deux libertaires du film, Jean-Claude et Pierrot, illustrent parfaitement quelques slogans tirés du mois de mai comme « Il est interdit d'interdire » ou encore « Tout, tout de suite ». Jean-Claude et Pierrot, annonçant les Rmistes et SDF des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, sont dépeints par un Bertrand Blier compréhensif et compatissant. Repérés par Blier au café-théâtre, Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et Miou-Miou sont, du jour au lendemain, grâce à ce film, élevés au rang de vedettes. Les Valseuses lance leurs trois carrières.

Autre film à scandale en cette année 1974, à la thématique toute opposée aux Valseuses, Lacombe Lucien de Louis Malle. L'histoire d'un jeune paysan de 17 ans pas très futé qui s'engage dans la collaboration après avoir appris que la Résistance ne voulait pas de lui. Le très ambigu personnage interprété par Pierre Blaise déchaîne les passions. Un grand débat a divisé et divise encore aujourd'hui ceux qui perçoivent Lucien Lacombe comme un anti-héros naïf et, au fond, victime, de ceux qui le voient comme l'archétype de l'irresponsable et pensent que Malle livre là un film révisionniste et négationniste sur l'Occupation. La gêne ressentie est morale et politique. Jean Delmas, qui écrit pour Jeune Cinéma, semble profondément choqué par l'ignominie du personnage principal, qu'il qualifie de « salaud », de « pauvre type », ou encore de « con ». Beaucoup de gens ont la même réaction que Delmas, face au personnage, et, comme lui, effectuent un rejet, font l'amalgame entre ce Lucien violent et imbécile et le film de Malle. Ce qui est un écueil car le film ne justifie jamais son personnage. « Faire un film sur le fascisme ordinaire, montrer un jeune paysan français qui aurait pu devenir résistant et qui, par accident, entre au service de la Gestapo, c'était certes provoquant, mais dans le bon sens » commente Louis Malle. Politiquement, le film choque pour les même raisons que Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls : il s'en prend à ce que Jacques Siclier appelle le « mythe d'une France presque unanimement résistante ». Jusque dans les années soixante-dix, le cinéma français a eu du mal à dénoncer la collaboration. Celui-ci traitait le sujet d'une manière soit romantique (Vive la liberté, Jeff Musso, 1946), soit triomphaliste (Jéricho, Henri Calef, 1946), soit humoristique (Mais où est donc passé la septième compagnie ?, Robert Lamoureux, 1973). Jusque dans les années soixante-dix, la quasi-totalité des films traitant de la guerre sont une célébration de l'héroïsme des Alliés contre le Mal Absolu.
Pour rester en France, on peut souligner les débuts particulièrement brillants d'Isabelle Adjani dans La Gifle de Claude Pinoteau. Ce dernier signe son deuxième film et récolte le très valeureux prix Louis Delluc. Une récompense en grande partie due à Adjani, alors âgée de 19 ans, fraîchement débusquée du théâtre. Le film tire son titre d'une gifle restée célèbre, flanquée à Adjani par Lino Ventura qui incarne dans le film un père particulièrement rustre.
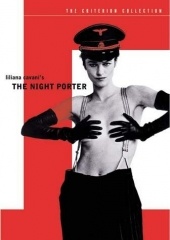
En Italie, deux films de 1974 n'ont rien d'autre en commun que le fait de raviver les temps de l'avant et de l'après-guerre : Amarcord de Federico Fellini et Portier de Nuit (Il Portiere di notte) de Liliana Cavani et avec Charlotte Rampling, future célèbre membre du jury à Cannes. L'actrice incarne dans le film de Cavani une ancienne déportée retrouvant après la guerre son bourreau et se donnant à lui au travers d'une relation sado-masochiste. La jeune femme a, pendant la guerre, accepté d'être le jouet d'un officier SS pour survivre. Après la guerre, lorsqu'elle retrouve l'individu, c'est par fascination qu'elle se soumet sciemment à lui. Caviani est extrêmement réputé en Italie pour ses reportages effectués sur le IIIème Reich, Staline ou Pétain pour la télévision italienne. Elle marque par son objectivité. Avec Portier de Nuit, qui n'est pas sa première réalisation pour le grand écran, Cavani est sérieusement prise à parti. De vives polémiques encadrent son film, au sujet brûlant. En Italie, le film est carrément interdit. « Interdit pour obscénité, vulgarité excessive des scènes montrant des rapports sexuels, atteinte aux bonnes moeurs. Ce film, doublement pernicieux parce que réalisé par une femme, montre une scène ignoble où l'on voit l'interprète féminine prendre l'initiative dans les rapports amoureux » commentent les censeurs italiens. Une lettre de protestation de cinéastes - signée entre autres par Pasolini, Visconti, Bertolucci et Antonioni - est adressée à la Commission de censure. On reproche notamment à Liliana Cavani d'avoir esthétisé ce sujet difficile sans l'avoir réellement traité ou encore d'avoir réduit une tragédie collective à un cas particulier des plus extrêmes. « Caviani est tombée dans la séduction de son sujet. Vouloir montrer les pulsions sado-masochistes du nazisme, c'est plonger dans ses propres abysses et en ramener à la surface des lambeaux éblouissants de noirceur. Cela ne se peut sans connivence » écrit Francis Mayor pour Télérama. Insistant sur la troublante fascination exercée par le nazisme, le film est interprété par beaucoup, et, on peut l'affirmer objectivement, à tord, comme une exaltation du IIIème Reich. Caviani aura beau expliquer qu'elle a voulu dénoncer le nazisme présent en chacun des êtres humains, qu'elle a voulu « montrer les côtés obscurs de l'âme » et pointer du doigt la présence en Autriche d'anciens nazis, son film est taxé de sensationnalisme, on l'accuse de vouloir rendre le nazisme fascinant. On peut faire un rapprochement entre Portier de Nuit et Lacombe, Lucien dans le sens où ces deux films jettent un regard nouveau sur la Seconde Guerre Mondiale, un regard éloigné de l'image apportée par le récit des aînés. L'éclosion de films proches de Portier de Nuit en Italie (Salo de Pasolini, Les Damnés de Visconti) est directement liée à la situation politique de l'Italie d'alors : « les années de plomb », pendant lesquelles les attentats terroristes se déchaînent et les gouvernements se succèdent. Filmer un épisode relatif au drame de la seconde guerre mondiale, c'est en quelque sorte dénoncer les dangers d'une résurgence fasciste et commenter la violence du temps présent.
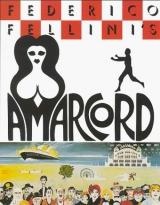
« Je m'en souviens ». C'est ce que signifie « Io mi ricordo » (« Amarcord ») dans la Romagne natale de Fellini. Alors quinquagénaire, Fellini se souvient de l'Italie des années trente. Son film est un bric à brac pittoresque, une oeuvre invertébrée tantôt grotesque tantôt onirique qui tire son essence de la capacité qu'a l'enfant à idéaliser ses souvenirs. Un gros mélange entre autobiographie, lyrisme, sature sociale et fantasmagories. A la sortie du film, Fellini aimait déclarer qu'il ne savait pas si celui-ci était issu de ses souvenirs ou de son imagination. « Chacun de mes films se rapporte à une saison de ma vie » déclarait il aussi. Le petit monde d'Amarcord, ville imaginaire en bordure de mer qui ressemble fort à Rimini, lieu de naissance du cinéaste, est un grand capharnaüm à peine représentable : une salade de dialectes qui a nécessité un sous-titrage même pour les italiens, un tourbillon d'images et de parlotes, où le rêve et la réalité se côtoient et se mélangent. Un film poétique donc, mais aussi très politique. Amarcord est une plongée dans l'enfance de Fellini, jonchée des marques laissées par le fascisme. Amarcord est le film le plus politisé de Fellini. Dans l'Italie campagnarde et fasciste, « 99% de la population sont inscrits au Parti ». Amarcord stigmatise avec virulence le fascisme ordinaire dans toute sa bouffonnerie (cortèges saluant l'image du Duce, statues fleuries de Mussolini). Les images sont ici plus fortes que le plus argumenté et le plus articulé des procès.
En 1974 sort en salle la suite du Parrain dont nous avons déjà parlé. Fait très rare, ce second volet dépasse pour l'unanimité le niveau atteint avec le premier opus en 1972. Trois ans après la sortie de The Godfather, Coppola remet le couvert avec un nouvel épisode de la "saga" des Corleone raconté avec une grande subtilité narrative (alternance entre les séquences au présent : activité de Michael/Al Pacino et les séquences au passé : l'ascension de Vito/Robert de Niro, et plus Brando). En 1977, la télévision américaine redécoupe les deux épisodes selon une chronologie linéaire et augmentée de nouvelles scènes pour faire The Godfather saga, une fresque de 450 minutes qui tient la comparaison avec Autant en emporte le vent. Pour le quarante-septième anniversaire des Oscars, en 1975, le film, nominé dans presque toutes les catégories (onze) remporte six Oscars dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur second rôle masculin (De Niro).

1974 est une très bonne année pour parler de Mel Brooks. C'est cette année que le célèbre satiriste livre ce qui est peut-être la plus populaire de ses oeuvres : Frankenstein Junior ou Young Frankenstein. Le paroxystique Melvin Kaminsky Brooks y parodie le fameux mythe du savant fou et de sa créature, un peu comme Jerry Lewis parodiait, en son temps, le mythe de Docteur Jekyll et Mr. Hyde (Docteur Jerry & Mr Love, 1962). Brooks rend hommage aux précédentes oeuvres cinématographiques sur Frankenstein par de nombreux clins d'oeil. Choisissant de tourner son film en noir et blanc, il ressuscite la magie des films fantastiques de la Universal des années trente. Ce proche de Woody Allen parodie sans cesse : le western dans Le Shériff est en prison en 1974, le burlesque muet dans La dernière folie en 1976, le style hitchcockien dans Le Grand Frisson (1977). C'est aussi dans les années soixante-dix qu'une troupe de comiques au talent ravageur et tout aussi irrévérencieux, s'illustre dans les salles obscures. Il s'agit des Monty Python. Ces jeunes Anglais débutent à la télévision en 1969 avec une émission, Monty Python's Flying Circus, diffusée sur la BBC, qui va se poursuivre jusqu'en 1974. En 1971, Michael Palin, Graham Chapman et autre Terry Jones s'illustrent pour la première fois sur grand écran avec And now for something completely different (La première folie des Monty Python). Après l'arrêt du Flying Circus en 1974, le groupe commence une carrière au cinéma dans des longs-métrages qu'ils réalisent eux-mêmes : Monty Python, sacré Graal en 1975 et La Vie de Brian en 1979 restent leurs deux gros succès.
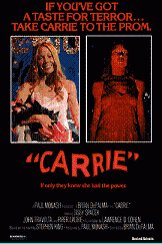
Phantom of the Paradise ou Le Fantôme du Paradis de Brian De Palma est un film d'épouvante musical. De Palma, en avance sur le temps du reality show, y dénonce avec virtuosité les manipulation de consciences par l'image. Deux ans plus tard, en 1976, le réalisateur enchaîne sur Carrie au bal du diable. De Palma aime à être comparé à Hitchcock. Son style s'en rapproche et le réalisateur n'hésite pas à citer dans ses films des répliques issues de grands classiques hitchcockiens. Phantom of the Paradise et Carrie au bal du diable ont tous deux décroché le grand prix du Festival du Film Fantastique d'Avoriaz, en 1974 et 1976. Une véritable consécration quant on connaît la crédibilité d'Avoriaz dans le genre fantastique.
Jack Nicholson incarne un détective privé spécialisé dans les filatures matrimoniales dans Chinatown de Roman Polanski. Le réalisateur polonais souhaitait depuis longtemps s'investir dans un vrai film noir à l'américaine. Polanski ressuscite ici un genre à l'agonie depuis la chute des grands studios, il rend hommage aux années quarante. Chinatown contient tous les ingrédients du genre : la femme fatale (Faye Dunaway), l'adversaire puissant et corrompu (John Huston), l'atmosphère malsaine et obscure, le détective (Nicholson)... Un policier qui ne s'écarte des règles du genre que lors du final, plutôt tragique. L'image la plus célèbre liée à ce film noir est celle de Nicholson et de son sparadrap sur le nez tailladé par la lame d'un truand... Petite déception cependant pour le film aux Oscars. Nominé dans onze catégories différentes (meilleur film, meilleur réalisateur , meilleur acteur dans un premier rôle, meilleure actrice dans un premier rôle), il ne remporte que l'Oscar du meilleur scénario (Robert Towne).
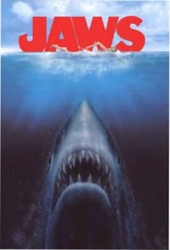
Steven Spielberg fait ses débuts sur grand écran avec Sugarland Express en 1974, une fantaisie sur le thème de la poursuite automobile, un film qui laisse entrevoir le goût du rythme et du découpage du cinéaste. Richard Zanuck et David Brown avaient repéré Spielberg, jeune réalisateur pour la télévision et misaient beaucoup sur lui. L'échec commercial de Sugarland Express n'a pas découragé ces producteurs qui lui ont confié un autre projet anodin : le premier grand succès du réalisateur. Les Dents de la Mer ou Jaws sort en 1975. Le film se déroule à Amity, une petite station balnéaire américaine dans laquelle un squale d'environ huit mètres sème la terreur et contraint trois hommes différents à s'associer pour le vaincre (un shérif, un océanographe, un aventurier-pêcheur). Jouant sur les peurs archaïques du spectateur, Les dents de la Mer renouvelle le genre catastrophe. Le film amène le qualificatif "blockbuster". Il remporte un succès inédit et inattendu au box office. Il est le premier, dans toute l'histoire du cinéma, à dépasser le niveau symbolique des 100 millions de dollars de recette dans les seules limites des Etats-Unis.
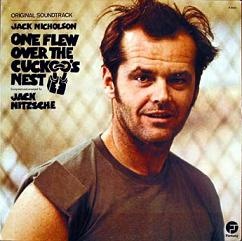
Milos Forman, l'enfant du Printemps de Prague, réalise en 1975 l'un de ses films les plus populaire : One Flew Over the Cuckoo's Nest, traduisez Vol au dessus d'un nid de coucou (en anglais, "cuckoo" signifie "cinglé"). On connaît le réalisateur pour ses qualités. Il sait dynamiser une oeuvre, adapter une histoire pour le grand écran. Ici, le roman qui a inspiré le film est le best-seller signé Ken Kesey. Le livre a été écrit d'une façon très onirique et délirante, à la première personne, il est le faux témoignage d'un interné (l'indien). La substance du roman a été clarifiée et transformée en un récit à portée universelle. On reconnaît aussi à Forman un grand talent dans le choix et la direction des acteurs. Vol au dessus d'un nid de coucou est peut-être son film au casting le plus remarqué : Nicholson brille dans un rôle qui lui va comme un gant, Louise Fletcher est très crédible dans le rôle de l'infirmière en chef, Danny DeVito, Will Sampson et autre Christopher Lloyd incarnent avec beaucoup de talent les malades de l'hôpital psychiatrique. Le film peut-être vu comme une brillante critique des méthodes psychiatrique et à plus forte raison des méthodes carcérales. L'infirmière Ratched incarne le pouvoir, l'agent d'une normalisation et d'une dépersonnalisation glaciale. Elle est le symbole d'un système autoritaire, rigide qui s'oppose au compagnonnage euphorique et pacifique incarné par Mac Murphy, le libertaire et subversif "sain" parmi les "fous". Une opposition grandiose et cocasse. Ici, la force du film tient à son ambiance, à son atmosphère. Forman ne pêche pas dans un discours direct et moralisant. Le film est considéré comme l'un des chefs d'oeuvre du cinéma américain des années soixante-dix. En 1976, aux Academy Awards, il rafle les cinq Oscars principaux à savoir celui du meilleur film, de la meilleure mise en scène, du meilleur scénario, du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Ceci n'était pas arrivé depuis It Happened One Night en 1934.
Robert Altman, le réalisateur de M.A.S.H. atteint le sommet de sa carrière cinématographique avec Nashville. Là encore, Altman renvoie au visage du conservatisme américain une cinglante satyre. Cette fresque évoque les liens étroits entre la politique et le spectacle au travers d'un gigantesque concert country qui se déroule en parallèle d'une campagne électorale. Le corrosif critique de l'american way of life effectue une brillante démonstration de sa vision du renouvellement hollywoodien.
« La description douce d'émotions violentes ». C'est en ces mots que François Truffaut parle de son dernier film : Histoire d'Adèle H.. Cette histoire est celle d'un amour fou, entre la fille du célèbre écrivain français Victor Hugo (incarnée par Isabelle Adjani) et un officier britannique, vers 1860. La jeune fille poursuit l'homme en question à travers le monde en vain. Une passion désespérée et à sens unique qui est tirée de faits réels : le journal intime d'Adèle Hugo.
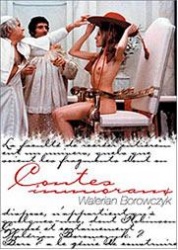
La polémique au sujet du porno rebondit en 1975. Les films pornos, qu'ils soient soft ou hard, déferlent dans toutes les démocraties du monde. Du coté de l'Espagne, pays étouffé par la dictature franquiste, les ibères frontaliers envahissent des villes comme Perpignan pour y voir des films interdits chez eux comme Dernier tango à Paris. La pornographie s'étend à un point que beaucoup ont peur que cette "dérive" ne vienne "pourrir" le cinéma et envahir la totalité des salles. Des mesures s'imposent. La France choisit de trancher au vif. Le gouvernement Jacques Chirac adopte le 31 octobre un décret, sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Culture Michel Guy, excluant les films X de l'aide automatique au cinéma. Ces mesures provoquent de vives polémiques et un gros mécontentement de la part des producteurs qui clame le caractère à l'origine non sélectif de l'aide au cinéma. La Commission de Contrôle des films cinématographiques aménage une liste titrée "X" recensant tous les films à caractère pornographique mais aussi les films jugés trop violents. Désormais listé, un film tatoué du sceau infamant "X" sera victime de l'apartheid commercial et artistique : plus de subvention, parcage dans les salles dites "spécialisées" et surimposition. La marque X ne fera d'ailleurs presque aucune distinction entre pornographie et érotisme. Certains films comme Histoire d'O de Just Jaeckin, La Bête de Walerian Borowczyk ou encore Les Onze mille Verges d'Eric Lipmann sont classés X, sans réelle distinction d'avec des films de l'industrie pornographique, alors qu'ils ont presque tous été dès le départ reconnus pour leurs qualités cinématographiques, voire pour leurs qualités littéraires.

Considéré à sa sortie par beaucoup comme une oeuvre indigne, infamante et pornographique, Salo ou les Cent Vingt Journées de Sodome est le dernier film de Pier Paolo Pasolini. Il déclanche une polémique à sa sortie, une polémique intensifiée par la mort de son auteur, assassiné sur une plage d'Ostie, au même moment de la sortie du film. Le film est tiré du roman éponyme du Marquis de Sade, Salo ou les Cent Vingt Journées de Sodome, et présente la vision la plus terrifiante et macabre de la condition humaine : une humanité prisonnière et détruite par l'atrocité des sévices et des tortures infligées à la jeunesse humiliée. L'histoire se déroule à Salo, petite République fasciste dans laquelle quelques hauts dignitaires s'affairent à transformer le corps de dix-huit jeunes gens en objet de leur plaisir. Rien n'est épargné à l'oeil. Les tortures proférées par les bourreaux fascistes sont dépeintes sans ombrage. « Faire manger de l'excrément ? Enucléer un oeil ? Mettre des aiguilles dans un mets ? Vous voyez tout : l'assiette, l'étron, le barbouillage, le paquet d'aiguilles, le grain de la polenta ; comme on dit, rien ne vous est épargné » écrit Roland Barthes pour Le Monde. Salo est interdit en Italie pour obscénité et soulève l'indignation de nombreux critiques en France. A l'annonce de la mort du marxiste révolté, en ces temps de grand désordre politique en Italie, les extrémistes de droite se frottent les mains. Révulsé par les tourments politiques et sociaux qui déchirent l'Italie des années soixante-dix, Pasolini a saisi l'occasion de transposer un fait fictif (le roman de Sade) en dénonciation d'une période donnée (l'Italie de ces années soixante-dix) sur fond d'un passé historique tourmenté (le fascisme, la seconde guerre mondiale). Le film, qu'il dégoûte ou qu'il fascine est un outil dans le cadre de la réflexion sur les horreurs commises pendant la seconde guerre mondiale. Une oeuvre antifasciste et anti-négationniste tout aussi nécessaire que Nuit et Brouillard d'Alain Resnais.

Barry LyndonAdapté d'un roman de Thackeray, Barry Lyndon, nouveau film de Stanley Kubrick, a demandé 300 jours de tournage. Après l'expérience sociologique de la violence (Orange Mécanique, 1971), Kubrick se plonge dans l'Europe du 18ème siècle et se centre sur les tribulations d'un jeune arriviste irlandais. Une superproduction surtout remarquée par son incroyable beauté technique et ses qualités plastiques. L'ambiance du siècle des Lumières est ici tout bonnement ressuscitée. Dans l'ouvrage de Michel Ciment consacré à Stanley Kubrick, le réalisateur explique le travail effectué sur le réalisme et la lumière pour Barry Lyndon : « L'éclairage des films historiques m'a toujours semblé très faux. Une pièce entièrement éclairée aux bougies est très belle, mais elle est complètement différente de ce que l'on voit d'habitude au cinéma. J'ai fini par trouver l'objectif Zeiss ouvert à F:0,7 : la plus grande ouverture existante. Il n'avait jamais été utilisé pour le tournage d'un film. Il a fallu aménager spécialement une caméra pour le fixer. Dans les scènes éclairées à la bougie, nous utilisons un très faible éclairage complémentaire venant du plafond, mais la source principale a toujours été les bougies ». Dans toutes les brochures, magazines ou livres destinés au film, on peut voir les mêmes photographies assorties des mêmes commentaires : « une scène intégralement filmée à la lumière de la bougie ». Tourné en Grande-Bretagne, le film est plutôt mal accueilli par le public et la critique américaine. Pourquoi ? La conclusion cinglante et pessimiste du film, qui reflète bien l'ambiance générale peut nous apporter quelques éléments de réponse. La phrase en question rappelle que tous les personnages du film ont vécus lors du règne de Georges III et que, « bon ou mauvais, beau ou laid, riche ou pauvre », tous sont égaux dans la mort.
Kurosawa, surnommé au Japon, non sans ironie, « L'empereur du cinéma japonais » traverse après 1965 la période la plus déprimante de sa vie : projets inaboutis à Hollywood, échecs commerciaux de Dodes' caden en 1970 et, à la suite, faillite de sa maison de production, tentative de suicide en 1971... Boudé dans son propre pays, « Kuro » verra son salut arriver de l'étranger. Mondialement connu et reconnu, Kurosawa va être sollicité par le voisin soviétique. C'est pour le compte de l'U.R.S.S. qu'il réalise en 1975 son nouveau film Dersou Ouzala : une méditation sur la vie, une fresque lyrique et écologique. Dersou Ouzala raconte la rencontre entre un chasseur asiatique et un officier tsariste au coeur de la taïga sibérienne. Les mémoires de l'explorateur russe Arseniev ont servi de base au scénario. La rencontre du vieil animiste chasseur Dersou et de l'homme moderne Arseniev est aussi celle de l'orient et de l'occident. Une rencontre grandiose et simple, dépeinte avec humanisme et sagesse. Une oeuvre universelle, donc, qui immortalise de son vivant Kurosawa comme un grand cinéaste à portée universelle. Le film obtient un succès mondial. Il décroche l'Oscar du meilleur film étranger à la cérémonie des Academy Awards.
1976 est l'année pendant laquelle cartonne le film Rocky. Le film de John G. Avildsen récolte l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur l'année suivante aux Academy Awards. Révélant Sylvester Stallone (acteur principal et scénariste du film), future figure de proue du cinéma d'action américain dans les années quatre-vingt, le film ressuscite le héros traditionnel américain, le battant, le self-made man, parti de rien pour arriver au sommet grâce à ses qualités d'acharnement et son caractère de feu. Pour le premier opus de Rocky seulement, on relève aussi une très grande dimension sociale. La caméra de Avildsen suit Rocky dans les bas-fonds de son quartier pauvre et dévoile toute une misère. Face à l'image traditionnelle du héros américain, plusieurs autres contre modèles émergent aussi, qui mettent fin à l'hypocrisie : Jack Nicholson dans Cinq pièces faciles en 1970, Dustin Hoffman dans Macadam Cow-boy en 1969 et surtout... Robert De Niro dans Taxi Driver en 1976.
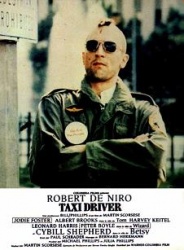
L'Amérique des paumés, des marginaux, des minorités (les Italiens de Mean Streets), l'Amérique nocturne et urbaine, l'Amérique du doute et de la contestation, l'Amérique des losers... Martin Scorsese révèle la face cachée de l'Amérique, ses bas-fonds, jusqu'alors trop souvent dissimulées par les facéties hollywoodiennes. Travis, dans Taxi Driver, est un personnage complexe, à l'image de la jungle urbaine new-yorkaise. Marqué par la guerre du Vietnam pendant laquelle il s'est battu en tant que marine, pris d'insomnies et observant la nuit, de son taxi, le New York des marginaux, Travis est alimenté par l'imagerie de l'héroïsme à l'américaine et veut « nettoyer la ville », lui qui n'est pourtant pas un grand modèle de stabilité. Il trouve une échappatoire à sa solitude en se réfugiant dans la justice individuelle. Scorsese démythifie l'image du héros. Travis Bickle est l'antithèse, la critique vivante de l'American Dream. Tourné rapidement (Robert De Niro est alors très demandé, en pleine ascension depuis son Oscar pour Le Parrain II), uniquement en extérieur, dans les bas quartiers de Manhattan, souvent de nuit, le film est d'une grande force psychologique. Très oppressant, il est soutenu par une grosse performance de la part de Robert DeNiro et par un style très documentaire (des dialogues semi improvisés). Scorsese dit avoir voulu transposer dans le contexte américain L'Etranger de Camus. Le réalisateur connaît, peu de temps après, un nouveau succès avec cette fois ci une comédie musicale, se déroulant toujours dans la ville de son coeur : New York, New York. Liza Minnelli, dernière fée du genre musical, célèbre pour sa prestation dans le Cabaret de Bob Fosse, s'illustre aux cotés de Robert DeNiro. Il s'agit d'un hommage nostalgique à la comédie musicale des années cinquante, aux films de Minnelli, de Donen ou de Curtiz. La nostalgie d'un âge d'or révolu, celui de l'après guerre. « J'ai voulu exprimer, à travers l'évolution du jazz, les changements intérieurs de 1945 à 1955, aussi bien dans le pays qu'à l'intérieur des personnages » témoigne Scorsese. Chauffeur de taxi ou boxeur (Raging Bull, 1979), Scorsese a trouvé en De Niro son "loser idéal". A Cannes, Taxi Driver obtient la Palme d'or alors que le président, Tennessee Williams, juge le film "trop violent".
A la seconde place, au palmarès, on retrouve Cria Cuervos, qui remporte le prix spécial et qui sonne la libération du cinéma espagnol. La mort de Franco en 1975 libère en effet la péninsule ibérique du marasme cinématographique provoqué par les conditions de vie artistiques impossibles de la dictature. De 1939 à 1975, le pays subit une censure intransigeante. Les censeurs encouragent la production de films dont les héros sont soit des religieux soit des militaires, soutenant des valeurs de morale et d'ordre. Les films un tant soit peu sceptiques vis-à-vis de l'ordre établi sont chassés. Par des moyens détournés, quelques cinéastes espagnols d'alors arrivent à réaliser des films qui, par la parabole, l'allégorie, critiquent les fondement du régime franquiste. C'est le cas de J.A. Bardem, de L.G. Berlanga et surtout de Carlos Saura (Peppermint frappé, 1967, La Madriguera, 1969, Ana et les loups, 1972, La cousine Angélique, 1973). Dans un style très personnel, mêlant passé et présent, rêve et réalité, Carlos Saura aborde notamment les problèmes des traumatismes infligés à la société par la religion, ses tabous et ses interdits. Cria Cuervos, réalisé après la mort de Franco, est le troisième volet d'un triptyque consacré à l'enfance. Cria Cuervos est le plus populaire et le plus abouti des films de Saura. Son succès commercial est soutenu par la musique du film, extrêmement populaire : « Porque te vas ».

L'empire des sensL'empire des sens est le plus gros succès international de Nagisa Oshima. Le film est basé sur un fait divers scandaleux ayant défrayé la chronique en 1936 : une passion dévorante avait poussé une geisha à tuer son amant en lui tranchant les parties génitales. Filmant pour la première fois au Japon des actes sexuels réels, Oshima lève le tabou de la représentation cinématographique du coït et déchaîne les censeurs. D'abord interdit par la censure, le film sort ensuite dans une version très épurée avec des images coupées en deux lors des scènes de copulation pour masquer les parties génitales. Le titre original du film est « Ai no Corrida », ce qui signifie « la corrida de l'amour ». Il illustre bien l'aventure sexuelle des personnages, célébrant l'amour fou comme un rite sacrificiel dont le seul aboutissement possible est la mort. Dans L'Empire des sens, l'érotisme est abordé d'une façon quasi mystique. Cet hymne à la jouissance sans frein concrétise les théories hédonistes de Sade. Une influence reconnue par Nagisa Oshima (le nom de l'héroïne, Sada, fait curieusement référence au célèbre marquis). Avec ce film, Oshima concrétise un paris osé : concilier exigences esthétiques et exhibition érotique. L'empire de la passion, une suite beaucoup moins érotique, remporte le prix de la mise en scène à Cannes en 1978. L'histoire de L'Empire des Sens a déjà inspiré un autre réalisateur nippon : Noboru Tanaka, qui en avait fait un Roman-porno baptisé Abe Sada. La compagnie Nikkatsu, pour se préserver de la faillite, s'était investie dans l'érotisme. Le Roman-porno était une série à succès lancée au début des années soixante-dix par la compagnie. Les films étaient des réalisations pornographiques à faible budget, très rentables. Un procès oppose la Nikkatsu et la censure et s'étale presque sur toute la décennie : il est très symbolique de l'évolution des moeurs japonaises.
Pour cette année 1977, on note deux grands films fantastiques, aux propos et aux styles forts différents, tout deux réalisés par deux maîtres hollywoodiens qui récoltent là un grand succès. Il s'agit de Star Wars ou La guerre des Etoiles de George Lucas et Close Encounters of the Third Kind ou Rencontres du Troisième Type de Steven Spielberg.

Rencontres du Troisième Type met en scène l'émerveillement juvénile d'êtres hantés par la vision d'OVNI. Cette superproduction de 18 millions de dollars est une rencontre spirituelle entre les habitants de la terre et ceux venus de l'espace. Le film est très critiqué pour sa mièvrerie, son sentimentalisme naïf et autres "gamineries". Le film de Spielberg est surtout remarqué par des effets spéciaux très impressionnants pour l'époque. Le casting affiche en première position Richard Dreyfus, l'acteur fétiche de Spielberg mais aussi François Truffaut, son grand ami français...
C'est en 1977 que paraît le premier opus d'une saga désormais culte. Star Wars ou La guerre des Etoiles propulse George Lucas au zénith. Le film évoque la résistance d'un groupe de rebelles face à un empire totalitaire qui fait régner la terreur dans toute la galaxie. Lucas force avec ce film un nouvel imaginaire, une nouvelle mythologie qui fait date dans l'histoire du fantastique, inspiré de chansons de geste, des récits mystiques et des romans de cape et d'épée. Le film, et plus largement sa saga, est un des plus gros succès commercial du cinéma américain. George Lucas bénéficiait pourtant d'un budget serré pour un projet de cette ampleur : onze millions de dollars ont été fournis par la 20th Century Fox, le seul studio ayant accepté d'ouvrir ses portes au projet fou de Lucas.
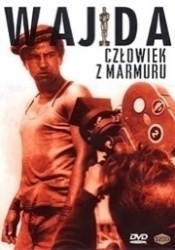
Le polonais Andrzej Wajda présente en 1977 son film politique majeur : L'homme de marbre. Même si l'étau communiste s'est largement desserré sur la Pologne, le film reste très osé. Wajda a trouvé le courage de revenir sur un passé douloureux trop souvent refoulé. Le projet du film a été conçu dans les années soixante, tandis que la Pologne se trouvais encore sous tutelle soviétique. Le projet n'avait alors pas abouti, les instances en place étaient alors très hostiles à ce qui leur apparaissait comme une évidente remise en cause du stakhanovisme. Avec L'homme de marbre, Wajda livre au monde un film tiré d'une anecdote authentique : l'histoire d'un jeune et brave maçon, Birkut, ouvrier modèle, fêté comme un « héros positif » par la propagande socialiste. Irrités par les cadences infernales imposées par les records du jeune ouvrier prodige, des collègues passent un jour à Birkut une brique chauffée à blanc, qui le brûle gravement. Un homme est accusé à tord de ce sabotage et Birkut prend sa défense avec courage et énergie. Il est jeté en prison et son image est démythifiée. Il finit oublié de tous. Cette histoire de la grandeur et de la décadence de ce modèle ouvrier est remarquée techniquement par un traitement dans le plus pur style wellesien du Citizen Kane. Une jeune journaliste TV mène l'enquête sur ce « nouveau rosebud ». Qu'est devenu l'ouvrier si présent sur les images de propagande de l'époque ? La structure du film, qui montre les personnages avant et après, sur le modèle d'un puzzle, par fragment, rend hommage au chef d'oeuvre de Welles que Wajda se projetait sans arrêt à l'école de cinéma de Lodz. Ce film, qui jette la pierre à la manipulation de la réalité par la propagande et à l'industrialisation forcée de la Pologne, dérange évidemment les autorités de l'époque, mais celles-ci n'osent pas interdire le film. Elles se contentent de contrôler ses échos dans la presse : interdire les critiques favorables et limiter les critiques négatives qui poussent encore plus les polonais en salle. A la suite de l'immense succès obtenu par le film, le ministre de la Culture qui avait accordé à Wajda l'autorisation de tournage est limogé.
Sous l'impulsion du président Rossellini, mort peu de temps après le Festival de Cannes, les frères Taviani remportent, en plus du prix de la critique, la Palme d'Or pour Padre Padrone, leur premier grand succès international. Le film dépeint la vie solitaire d'un berger sarde qui réussira à devenir professeur de linguistique. L'histoire est inspirée de l'autobiographie de Gavino Ledda.

En 1978, le second film de Michael Cimino, auteur de Thunderbolt and lightFoot, crée l'événement. Voyage au bout de l'enfer ou Deer Hunter montre la vie d'avant, pendant et d'après la guerre du Vietnam d'un groupe de copains ouvriers d'une communauté lithuanienne de Pennsylvanie. Trois d'entre ces hommes, incarnés par Christopher Walken, Robert DeNiro et John Savage, s'apprêtent à rejoindre le Vietnam. Le traumatisme vietnamien et ses effets destructeurs sur la population américaine sont remarquablement abordés. « Le grand film américain des années soixante-dix [...] Epopée de l'échec, The Deer Hunter est aussi requiem grandiose dédié aux souffrances et à la stupéfaction de l'Amérique face à la plus grande défaite de son histoire » écrit Jacques Lourcelles. Voyage au bout de l'enfer est le premier film a inscrire le conflit vietnamien dans la réalité quotidienne de la vie américaine, l'un des rare à esquiver les écueils de l'autojustification, de la dénonciation politique ou de l'horreur offerte en spectacle. Le film inaugure une nouvelle vague d'oeuvres ayant pour trait commun la guerre du Vietnam et tentant, en cette fin de décennie, d'exorciser la plus traumatisante des guerres menée par les Etats-Unis. Suivront des films comme Apocalypse Now, Platoon, Full Metal Jacket...
En surface, Le Mariage de Maria Braun de Rainer Werner Fassbinder est le portrait d'une jeune femme arriviste dans l'Allemagne de l'après-guerre jusque dans les années cinquante. Le film est en fait une critique de l'Allemagne d'Adenauer, repue dans sa richesse et dans son égoïsme. Maria est la métaphore de l'Allemagne d'après-guerre : ruinée, anéantie, en détresse. Elle ne doit son salut économique qu'à l'aide américaine. L'extraordinaire enrichissement de cette « pirate du bonheur individuel » (selon la propre formule de Fassbinder) c'est évidemment la furtive remontée économique de l'Allemagne d'Adenauer. Une amère parabole aux années d'après-guerre pour une Allemagne condamnée à se prostituer pour survivre. Les années passent et le pays perd de son identité en sacrifiant son âme. Ce mélodrame puissant et sulfureux est le symbole de cette « troisième génération » du cinéma allemand dont la figure de proue est le très prolifique Rainer Werner Fassbinder. La filmographie de ce dernier est épaisse de trente neuf longs métrages pour seulement treize ans de carrière.
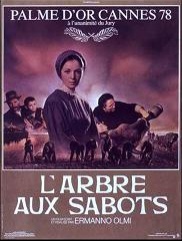
En 1978, c'est l'italien Ermanno Olmi qui décroche la palme d'or cannoise pour son film L'Arbre aux sabots. Jusqu'alors connu par un cercle très réduit de cinéastes et de cinéphiles, Olmi est cette année propulsé sur le devant de la scène. L'arbre aux sabots s'immisce dans la vie quotidienne d'une ferme lombarde, fin du 19ème siècle. Une oeuvre ethnographique soulignant les difficiles conditions sociales de la vie rurale d'alors. Des conditions de vie intolérables, dénoncées sans élever la voix, sans brandir de poing rageur et sans rhétorique. L'art de Olmi s'inscrit dans la descendance du néoréalisme italien. « A l'instar de Rossellini, il pratique un cinéma pour l'homme, pour le comprendre et l'aider à se comprendre, à se connaître et à se reconnaître dans ses responsabilités, sa fondamentale dignité, sa noblesse » commente Christian Depuyper. Le film d'Olmi est très largement inspiré de sa vie. Il y retranscrit les dires de sa grand-mère et ses souvenirs d'enfance : « Je me suis appliqué à me rappeler que je suis avant tout un paysan. Je n'ai rien inventé, je n'ai pas fait le poète qui crée à l'intérieur de sa réalité privée. Je suis retourné auprès des paysans au milieu desquels j'étais né et je me suis joint au choeur. Ainsi, l'Arbre aux Sabots est-il le film de ma grand-mère des paysans d'hier, des paysans d'aujourd'hui. Je me suis limité à être celui qui donne le coup de sifflet du départ, faisant en sorte que tous, ensuite, se mettent à chanter » commente le réalisateur. Six mois de tournage, décors réels, éclairage naturel, des paysans qui parlent leur dialecte et un budget dérisoire sont autant d'arguments qui positionnent le film comme l'une des plus grande oeuvre descendante du néoréalisme.
John Travolta se révèle, en cette fin de décennie, tout d'abord avec Saturday Night Fever ou La fièvre du samedi soir de John Badham en 1977 et ensuite avec Grease de Randal Kleiser en 1978. Cartonne aussi au box-office le film de Richard Donner Superman qui immortalise Christopher Reeve comme le héros de bleu et de rouge.

Woody AllenDès 1977, avec Annie Hall, Woody Allen avait montré une autre facette de l'étendue de ses talents. La comédie burlesque laisse place au film autobiographique teinté d'élans dramatiques. Le ton se fait plus grave, le réalisateur renonce momentanément à la comédie pure en ouvrant au milieu de sa filmographie une trilogie autobiographique. Allen, dès les premières minutes de Annie Hall, s'adresse directement au public. Avec Interiors en 1978, l'auteur ne cache plus son admiration pour Ingmar Bergman. Son auto examen se prolonge et se conclue dans Manhattan en 1979, un hommage qu'il rend à sa ville fétiche, hors de laquelle il ne peut vivre. Utilisant le moins d'intrigue possible, il incarne ce « looser névropathe » au rythme furtif et saccadé, presque bégayant, philosophant sur le monde et sur la vision qu'il a de la vie. Des conversations libres, des monologues, offrent ce personnage au regard rieur du spectateur. Manhattan, considéré comme le plus abouti des films de Allen, est une description amusante des intellectuels new-yorkais, de leurs bavardages continuels et superficiels, de leur égocentrisme. Tourné dans un noir et blanc nostalgique, le film multiplie les plans contemplatifs de Manhattan. Une vision volontairement subjective de New York, critiquée par Robert Altman : « Ce film n'est pas une image réelle de New York : où sont les Noirs, les Espagnols, les Chicanos ? Où est le métro ? ». En réponse à cela, on peut apporter les paroles de Allen Stewart Konigsberg, qui n'est autre que Woody Allen, dont les mots résument à eux seuls toute la profondeur de Manhattan : « Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par New York [...] Je voulais la montrer comme je l'ai vu quand j'avais cinq ans, et plus tard, lors de mon adolescence. Et cela allait très bien avec le thème du film, un thème que peu de gens ont remarqués : celui du vieillissement. Malgré les apparences, c'est un film triste, l'histoire de quelqu'un qui voit sa ville comme elle n'existe plus depuis des années, sur une musique qui a l'âge de son rêve et dans le style du film noir & blanc de l'époque. » On sent toute l'influence de Fellini (Amarcord), qui est le contemporain dont Allen se réclame le plus volontiers, avec Ingmar Bergman. A l'émotion esthétique suscitée par ce noir et blanc et cette dimension contemplative s'ajoute le dramatique, généré par le talent du dialoguiste Allen, mêlant sentiments et humour. Ce mélange, dans Manhattan, entre émotion et humour vaut à Allen, qui a déjà été mis en parallèle avec des génies burlesques tel que Buster Keaton pour des oeuvres comme Take the Money and Run ou Bananas, d'être comparé à Chaplin. A la différence de ce dernier, Allen n'incarne pas un vagabond. Il a un métier, un appartement, une vie sociale bien assise. Mais il est vrai que les deux bonshommes ont su, chacun à leur manière, créer un personnage qui inspire sympathie et rires : chapeau melon, petites moustaches, vêtements trop longs et grandes chaussures pour l'un, lunettes à cadre noir épais, gros nez et "tonsure rousse en bataille" pour l'autre.
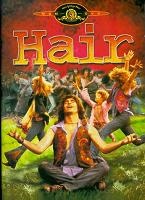
Milos Forman livre au monde en 1979, le film culte et pamphlétaire de toute une génération de jeunes américains. Hair, comédie musicale éprouvée de Broadway, chante et danse les obsessions de la guerre du Vietnam. Cette comédie musicale a été écrite par Jerome Ragni et James Rado pour la scène et cette adaptation filmique est une nouvelle preuve des talents d'adaptateurs de Forman. Le réalisateur tchèque s'immisce pour la première fois dans le genre musical. Ce film est un symbole pour le mouvement hippy, destiné à exorciser les maux causés par le Vietnam. En 1980, Hair connaît les honneurs d'une nomination aux Césars, dans la catégorie Meilleur film étranger, et aux Golden Globes, dans la catégorie Meilleure comédie / film musical.
Deuxième réalisation du britannique Ridley Scott, Alien est l'un des plus grands et des plus importants films fantastiques jamais composés. Scott impose, au travers d'un scénario relativement simple, sa vision froide et mécanique de la peur. Un concept avant une histoire. Dans le Nostromo, vaisseau spatial de retour sur terre, un prédateur décime tour à tour tous les membres de l'équipage. Le design de la créature a été confié au célèbre peintre suisse Giger. Ce dernier a enfanté de la plus terrible et de la plus connue des créatures dans l'histoire du grand écran. Mais, bien que disposant de la plus terrifiante des créatures au monde, Ridley Scott ne cède pas à la complaisance et impose sa notion du suspens. Le cinéaste ne nous donne jamais la possibilité de contempler la créature dans son entier et les apparitions de cette dernière sont très furtives. Le fait que notre oeil n'ai pas le temps de s'habituer à la vue du prédateur génère une peur et une crainte jusqu'aux dernières minutes du film. Cette impression de malaise est renforcée par le décor. Le Nostromo est un vaisseau spatial lugubre, aux couloirs qui semblent ne jamais finir. L'intérieur du Nostromo a été imaginé par Jean Giraud. Un grand film fantastique, véritable pan dans l'évolution du genre, que l'on doit à une talentueuse fusion de compétences.

David O. Selznick avait déjà tenté d'adapter le célèbre roman de Thomas Hardy : Tess d'Uberville. Mais, faute de trouver l'actrice idéale pour le rôle-titre, le projet s'est perdu. Bien des années plus tard, en France, Claude Berri met d'importants moyens à la disposition du déjà très grand réalisateur Roman Polanski, qui, lui, a trouvé « sa » Tess, pour réaliser l'adaptation filmique du grand roman. L'actrice choisie par le cinéaste n'est autre que Nastassja Kinski, la fille du fabuleux Aguirre, Klaus Kinski. La jeune femme a à peine 17 ans lorsqu'elle commence le tournage de Tess. Elle est d'autant plus précoce que ses grands débuts face à la caméra se sont déroulés alors qu'elle n'avait que quatorze ans, pour le film de Wim Wenders, Faux mouvement. La sensuelle Nastassja Kinski est la révélation du film. « Elle a un visage fait pour le cinéma, un de ces visages qui peuvent émouvoir même sans bouger, qu'on peut mettre dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle lumière, sans se soucier du meilleur profil » commente le réalisateur. L'histoire du film est celle d'une jeune paysanne, dans l'Angleterre du 19ème siècle. Après avoir été mise enceinte par un noble chez qui elle travaillait, Tess épouse le fils d'un pasteur avant d'être abandonnée puis de se remarier avec celui qui l'avait mise enceinte. Les malheurs de Tess Dubeyfield sont décrits au sein d'une société sadique dans laquelle l'innocence et la pureté sont des cibles. Tess est victime de ce monde, le film souligne la cruauté du destin, insistant sur les absurdités de la vie, les infortunes, les occasions manquées. Avec Tess, Polanski traite à nouveau des comportements humains, des comportements sociaux, même si son procédé est tout autre par rapport à ses travaux précédents, film d'époque oblige.

Apocalypse nowL'Amérique glorieuse et friande du happy end a eu du mal à se défaire, même en partie, on l'a vu plus haut, de son imagerie traditionnelle manichéenne et héroïque. La guerre du Vietnam, qui fut une interminable catastrophe pour le pays, est difficilement abordable pour ce cinéma frileux. On a tout d'abord voulu faire du Vietnam une aventure exaltante et s'attirer par le cinéma les sympathies de la population, en stigmatisant le Vietcong comme « le nouvel ennemi suprême », le nouvel indien, en quelque sorte. Dans cette optique, on peut citer le film de John Wayne, Les Bérets verts, construit sur ce modèle westernien et manichéen. A la fin des années soixante, l'opinion publique commence à comprendre les horreurs et l'inutilité de cette guerre, grâce, notamment, aux images télévisuelles. L'armée américaine est accusée d'avoir perpétré des massacres importants chez les civils. Deux documentaires pamphlétaires abordent le sujet et s'opposent à la politique américaine : The Year of Pig d'Emile De Antonio en 1965 et Hearts & Minds de Peter Davis, en 1974. Le sujet reste trop brûlant pour être abordé dans une fiction sur grand écran. Aucun producteur n'a à coeur d'investir dans une fiction allant à l'encontre du prestige national et de la fierté américaine. Deer Hunter ou Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino est le premier film à gros budget à crever (en partie) l'abcès. L'oeuvre nous montre l'influence traumatisante de la guerre sur un groupe d'américains, comme on l'a déjà expliqué. Mais la guerre du Vietnam n'y est pas révélée avec impartialité et réalisme. Pour un film de trois heures, le passage vietnamien ne dure qu'une trentaine de minutes. Le film est surtout un exorcisme « intra-muros » de la mauvaise conscience américaine. Coppola, avec Apocalypse now, va plus loin. Il fait de la guerre du Vietnam un véritable cauchemar, une descente aux enfers. Le capitaine Willard (Martin Sheen), remonte le fleuve à la recherche du Colonel Kurtz (Marlon Brando) qu'il doit éliminer. Ce parcours est un véritable périple qui dévoile « une guerre à l'américaine », remontant aux sources du mal, jusqu'à saisir l'essence du conflit vietnamien. Mais là encore, l'épisode de la guerre au Vietnam n'est évoqué que d'une façon fantasmatique. Un certain réalisme n'est toujours pas au rendez-vous, pour dépeindre ces blessures encore à vif. Le tournage du film a débuté en 1976, aux Philippines et a été très périlleux. Les prises de vues ne devaient durer que treize semaines et ne sont se sont achevées qu'au bout de 240 jours. Le budget gonfle de douze à trente et un millions de dollars. Le film de Coppola est de tous les problèmes : interruption du tournage faute de moyens, typhons détruisant les décors, problèmes avec Marlon Brando et ses demandes de salaire de plus en plus élevées, l'infarctus de Martin Sheen, la guerre civile éclatant aux Philippines et mobilisant les hélicoptères nécessaires au tournage, etc. La presse américaine, amusée par ces balbutiements douloureux, rebaptisa cyniquement l'entreprise de Coppola : Apocalypse, when ?. L'entreprise est bouclée au bout de trois ans de cauchemar. Pour en revenir à l'essence du projet, on peut citer les propos de Jacques Fieschi qui résume l'entreprise de Francis Ford comme « un journal de bord frappé d'une terrible fièvre exotique » et aux paroles de Lucien Bodard, qui déclare : « Apocalypse now ne cherche pas à décrire l'atmosphère exacte de la guerre du Vietnam. Son but est plutôt de témoigner de la folie des hommes, de leur puissance déchaînée lorsqu'ils sont pris dans l'horreur et l'inconnu ».
Apocalypse now de Francis Ford Coppola partage la palme d'or à Cannes avec Le tambour de Volker Schlöndorff. Les deux films ont en commun le fait de retracer un épisode sombre de l'histoire de leurs pays d'origine. Le tambour retrace vingt années de l'histoire de l'Allemagne au travers du destin d'un enfant, incarné par David Bennent, qui refuse de grandir. Le film, palmé à Cannes, consacre la renaissance du cinéma allemand.
Werner Herzog, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Voker Schlöndorff... Jamais, depuis les années vingt, le cinéma allemand n'a connu telle effervescence ! En cette fin de décennie, la « Troisième génération » germanique fait beaucoup parler d'elle et laisse son empreinte dans l'histoire du cinéma mondial en signant d'inoubliables chef d'oeuvres : Le Mariage de Maria Braun et La Troisième génération de Fassbinder, L'Ami américain de Wim Wenders, Aguirre ou la colère de Dieu et Nosferatu de Herzog, Le tambour de Schlöndorff... Le jeune cinéma allemand, par la résonance de ses films, est consacré partout dans le monde.
La décennie se clôt sur des mutations importantes. Le cinéma américain a changé de visage. Ses grands piliers d'antan décèdent : John Ford (1973), Howard Hawks (1977), Raoul Walsh, Alfred Hitchcock (1980), King Vidor (1982)... Des noms qui sont tous « remplacés » sur le grand écran par des Spielberg, Scorsese, Lucas, Coppola... Les nouveaux moyens de diffusion et d'exploitation (vidéocassette) s'imposent et influencent la conception des films. En 1980, Roman Polanski déclare : « Aujourd'hui, on fait deux sortes de films pour la télévision : ceux qui sont destinés au petit écran et ceux qui sont destinés au grand ». La production de téléfilms se multiplie. Dans le monde entier, de nouveaux cinéastes se manifestent : Pedro Almodovar en Espagne (Film politico, 1974), Jim Jarmusch aux Etats-Unis (Permanent Vacation, 1980), Chen Kaige en Chine (Huang tu di,1984), Aki Kaurismäki en Finlande (Valehtelija,1981), Emir Kusturica en Yougoslavie (Guernica, 1978)... Les années quatre-vingt seront très certainement propices à leur explosion...