Dossier - Sylvester Stallone : critique d'une filmographie
Cinéma / Dossier - écrit par Lestat et iscarioth, le 23/01/2007Tags : stallone rocky film rambo sylvester films cinema
Dossier complet sur la filmographie de Stallone, de ses débuts jusqu'à Rocky Balboa en 2007
20 décembre 2006 : l'Amérique voit revenir sur ses écrans l'une de ses grandes légendes cinématographiques du siècle dernier : Rocky "underdog" Balboa. Sylvester Stallone, qui avoue sans complexe que ce rôle lui colle à la peau (« le jour de ma mort, on titrera "Dernier round pour Rocky" », explique-t-il), a beaucoup peiné à trouver les financements pour ce film. Dans une interview accordée à Première pour la sortie du sixième opus de la vie de "l'étalon italien", Stallone dresse un constat assez angoissé du Hollywood actuel. Hier, Hollywood était aux mains des "cowboys", misant sur un film toujours par intuition.
Aujourd'hui, le cinéma américain est presque tout entier contrôlé par les businessmen, se basant plus sur les sciences du marketing que sur leurs propres vibrations. Stallone, indéniablement, fait parti de cette ancienne génération d'hommes de cinéma. Retour sur la carrière de l'acteur-cinéaste qui incarna, en son temps, le nouveau visage de l'Amérique.
Le temps des petits rôles
Sylvester Enzio Stallone est né le 6 juillet 1946 à New York. Son enfance est mouvementée. Selon ses propres dires, Stallone aurait été expulsé de quatorze écoles en onze ans et désigné par sa classe, à l'âge de quinze ans, comme celui « ayant le plus de chances de finir sur la chaise électrique ». Il s'intéresse très jeune au football, à la boxe et à la musculation. Grâce à ses performances sportives, Stallone décroche une bourse d'étude universitaire qui lui permet d'aller poursuivre sa scolarité en Suisse. C'est là qu'il découvre le théâtre, qu'il continue d'étudier à l'université de Miami. Stallone enchaîne tout d'abord les petits boulots. Ce n'est qu'à vingt quatre ans qu'il entre dans le milieu du cinéma, par la très petite porte : un film pornographique soft imbibé d'un delirium hippie intitulé The Party at Kitty and Stud's et rebaptisé par la suite Italian Stallion, dans sa réexploitation post Rocky.

BananasSylvester Stallone enchaîne ensuite les petits rôles, il interprète notamment un voyou s'en prenant au personnage de Woody Allen, dans une scène de métro du film Bananas. Stallone est alors souvent recruté pour jouer des rôles de petites frappes, ayant la carrure et la gueule de l'emploi. Beaucoup essayent de le décourager de devenir acteur. Avec ses yeux de cocker avachi, ses lèvres inférieures pendantes et ses difficultés - surmontées - de prononciation (il est atteint, à la naissance, d'une paralysie faciale des nerfs buccaux), il ne représente pas, aux yeux des producteurs, l'acteur parfait... A partir de 1974, Stallone tente de donner une seconde impulsion à sa carrière. Il déménage en Californie avec sa femme Sasha Czack pour y tenter de conquérir Hollywood. Il participe à l'écriture de son premier scénario, The Lord's of Flatbush et commence à obtenir des rôles de plus grande importance que de simples figurations, avec des films comme No place to hide (Rebel), Capone, La course à la mort de l'an 2000 (Death Race 2000) et Adieu ma jolie (Farewell, My Lovely). L'acteur est propulsé au firmament et découvert du grand public, en 1976, avec Rocky.
Rebel (No place to hide) - 1975
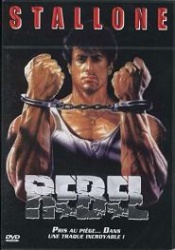
Ne vous fiez pas à l'affiche du film, créée bien à posteriori. Rebel est loin d'être une annonciation de la carrière prolifique de Stallone dans le genre d'action. Si Sylvester Stallone décroche avec ce film pour la première fois un premier rôle, ce n'est pas pour incarner la nouvelle star d'une production d'envergure. Rebel est un tout petit film d'amateurs, un navet irregardable qui doit ses éditions DVD et VHS au seul fait que Stallone est depuis lors devenu la star que l'on sait. Les jaquettes du film sont donc mensongères, elles présentent un Stallone bodybuildé, enchaîné et aux cheveux courts, qui correspond plus à celui que l'on retrouve un peu plus de dix ans plus tard dans Haute sécurité. Dans Rebel, Stallone incarne Jerry Savage, jeune révolté faisant partie d'un groupe de terroristes/révolutionnaires de 1969. Le film fleure bon les années hippies, images d'archives, grosses moustaches et camionnettes déglinguées à l'appui. On comprend mieux, au visionnage, pourquoi les maquettistes du DVD ont choisi de reprendre des images de Rambo ou d'autres films à succès de Stallone plutôt que de donner aux potentiels acheteurs un aperçu du contenu visuel réel de Rebel. La réalisation de Robert Allen Schnitzer est tout simplement nauséeuse, synthétisant tous les défauts du film amateur raté. La caméra est tremblante, la pellicule est coupée puis montée au hachoir, la luminosité est complètement aléatoire, la mise en scène et les enchaînements contradictoires. Rebel est une véritable épreuve de souffrance pour les yeux. Le rythme est lent, décomposé, seuls quelques nostalgiques trouveront la force de rester éveillé grâce à une bande son et à des images très blacksploitation. Difficile, forcément, de prêter réellement attention au jeu de Stallone à la vision éprouvante de ce film réalisé avec les pieds. Après quelques efforts, on en vient à la conclusion que Stallone se montre du même niveau de jeu que ses petits camarades sur ce film, un niveau très bas. Pour découvrir le petit Stallone des années soixante-dix, mieux vaut encore regarder le softporn Italian Stallion que Rebel. C'est dire.
La Course à la Mort de l'An 2000 - 1975

En 1975, Stallone obtient un rôle d'envergure dans La Course à la Mort de l'An 2000. Réalisé par Paul Bartel et produit par l'incontournable Roger Corman -qui avait déjà engagé l'étalon italien dans Capone-, Death Race 2000 nous décrit un monde futuriste, régi par un événement sportif ultra-violent : la course transcontinentale, où les participants foncent dans des engins surpuissants sur les routes des Etats Unis, gagnant des points à chaque personne passant sous leurs roues. A mi chemin entre Rollerball -sorti la même année- et Carmageddon -qu'il inspirera grandement-, Death Race 2000 est un film de science-fiction caustique, privilégiant l'humour noir, la critique cynique et quelques débordements gores bien sentis pour dépeindre une société en pleine décadence. Opposé à David Carradine, qui aura l'honneur de lui mettre une raclée au détour d'une scène, Sly campe Machine Gun Joe Viterbo (!), un pilote vulgaire, inculte et braillard natif de Chicago. Si Death Race 2000 a acquis avec le temps une certaine patine kitsch, à commencer par le look des véhicules très "Satanas et Diabolo", sans oublier la terrifiante cravate rose de Stallone, son aspect nerveux, ludique et revanchard en fait une série B loin d'être ridicule. Sans être oscarisable, la performance de Stallone, à l'aise dans ce registre en demi-teinte, y est par ailleurs tout à fait honorable, l'ironie du sort le faisant, déjà, vider sa mitraillette en hurlant sur un public trop amateur de son principal adversaire.
Fatigué de jouer au figurant et ne tenant pas à camper sur des rôles de voyous jusqu'à la fin de sa carrière, Sylvester Stallone écrit Rocky en 1975. Les studios se montrent très intéressés par le script mais souhaitent qu'une star confirmée investisse le rôle-titre. On parle de James Caan et de Ryan O'Neal. Le producteur fait monter les enchères jusqu'à 150 000 dollars pour que Stallone renonce à l'interprétation. Têtu, Sly réussit finalement à s'imposer dans le rôle de Rocky, vraisemblablement très imbibé d'éléments inspirés de sa propre vie : la pugnacité de Rocky pour tout donner dans le match de sa vie, c'est celle de Stallone pour s'imposer à Hollywood.
Rocky - 1976
 Rocky est un personnage emblématique du nanar sportif. Qui n'a pas un jour crié du coin de la lèvre inférieure « Adrieeeenne » ? Combien d'humoristes ont parodiées les fameuses scènes d'entraînement et de combat sur le fond sonore de « Gonna Fly Now » ? Avant de s'enfoncer dans l'auto-parodie avec quelques unes des séquelles, Rocky a été un personnage d'envergure, interprété avec talent par Sylvester Stallone. Rocky, c'est l'histoire d'un pauvre type, d'un prolo qui vit de combines avec la petite pègre locale. C'est un looser dont la seule passion est de boxer et qui vit dans la misère la plus totale dans un quartier pauvre de Philadelphie. Jusqu'au jour où on lui propose le combat de sa vie : un duel avec le très médiatique Apollo Creed pour le titre de champion du monde, un événement symbolique organisé pour le bicentenaire, censé incarner les valeurs de l'american dream. Le gros du film, ce n'est pas l'entraînement de Rocky ou même son combat, c'est sa petite vie de "troisième zone". D'où la portée très sociale du film, que l'on a tendance à oublier aujourd'hui. Dans Rocky, on voit vivre l'Amérique des pauvres : les ruelles et quartiers crasseux, les bars sordides, l'insalubrité. La réalisation de John G. Avildsen se fait presque documentaire. La caméra suit les personnages de coté (les marches dans le quartier filmées de manière linéaire) ou de face (à reculons, pour la scène de la patinoire), ce qui nous donne l'impression de vivre et d'observer à leurs cotés. Une grande sobriété. Pas d'effets appuyés, pas de montage compulsif ni de grande mise en scène. Stallone livre avec Rocky la plus belle performance d'acteur de sa carrière. Pour incarner ce personnage, il a créé toute une gestuelle : une façon de parler avec ses mains, un déhanchement sportif, un roulement d'épaules. Il impressionne aussi beaucoup par sa voix et son parler : murmurant, hésitant. Il incarne un pauvre type attachant. Evidemment, le succès est au rendez-vous, en cette année 1976. Le film a été tourné sur vingt huit jours, avec un budget d'un peu plus d'un million de dollars. Il en a rapporté 117, rien qu'aux Etats-Unis et 225 dans le monde entier. Rocky est nominé aux Oscars, dans de nombreuses catégories : meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice (pour Talia Shire), meilleur second rôle (pour Burgess Meredith), meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur son et musique. Une avalanche de nominations, pour deux récompenses, les plus importantes : le meilleur film et la meilleure réalisation.
Rocky est un personnage emblématique du nanar sportif. Qui n'a pas un jour crié du coin de la lèvre inférieure « Adrieeeenne » ? Combien d'humoristes ont parodiées les fameuses scènes d'entraînement et de combat sur le fond sonore de « Gonna Fly Now » ? Avant de s'enfoncer dans l'auto-parodie avec quelques unes des séquelles, Rocky a été un personnage d'envergure, interprété avec talent par Sylvester Stallone. Rocky, c'est l'histoire d'un pauvre type, d'un prolo qui vit de combines avec la petite pègre locale. C'est un looser dont la seule passion est de boxer et qui vit dans la misère la plus totale dans un quartier pauvre de Philadelphie. Jusqu'au jour où on lui propose le combat de sa vie : un duel avec le très médiatique Apollo Creed pour le titre de champion du monde, un événement symbolique organisé pour le bicentenaire, censé incarner les valeurs de l'american dream. Le gros du film, ce n'est pas l'entraînement de Rocky ou même son combat, c'est sa petite vie de "troisième zone". D'où la portée très sociale du film, que l'on a tendance à oublier aujourd'hui. Dans Rocky, on voit vivre l'Amérique des pauvres : les ruelles et quartiers crasseux, les bars sordides, l'insalubrité. La réalisation de John G. Avildsen se fait presque documentaire. La caméra suit les personnages de coté (les marches dans le quartier filmées de manière linéaire) ou de face (à reculons, pour la scène de la patinoire), ce qui nous donne l'impression de vivre et d'observer à leurs cotés. Une grande sobriété. Pas d'effets appuyés, pas de montage compulsif ni de grande mise en scène. Stallone livre avec Rocky la plus belle performance d'acteur de sa carrière. Pour incarner ce personnage, il a créé toute une gestuelle : une façon de parler avec ses mains, un déhanchement sportif, un roulement d'épaules. Il impressionne aussi beaucoup par sa voix et son parler : murmurant, hésitant. Il incarne un pauvre type attachant. Evidemment, le succès est au rendez-vous, en cette année 1976. Le film a été tourné sur vingt huit jours, avec un budget d'un peu plus d'un million de dollars. Il en a rapporté 117, rien qu'aux Etats-Unis et 225 dans le monde entier. Rocky est nominé aux Oscars, dans de nombreuses catégories : meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice (pour Talia Shire), meilleur second rôle (pour Burgess Meredith), meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur son et musique. Une avalanche de nominations, pour deux récompenses, les plus importantes : le meilleur film et la meilleure réalisation.
Mais où Stallone est-il allé chercher l'histoire de Rocky Balboa ? Sans aucun doute, dans son histoire personnelle, on l'a dit. On peut imaginer que le déclic a eu lieu le 15 mars 1975. Ce jour-là, Mohammed Ali, le roi de la boxe, affrontait Chuck Wepner, quasi inconnu. Wepner jouait le match de sa vie et personne ne misait un kopeck sur lui. Il savait qu'il relevait là le challenge de son existence : être face à l'un des plus grands boxeurs de l'histoire du sport. Notre Chuck Wepner a réussi à tenir 15 rounds et même à envoyer le grand Ali au tapis ! Même si ce challenger ne l'a pas emporté, il a gagné l'estime et sidéré tout le public. Cette petite histoire, officielle, ne vous rappelle rien ? Sylvester Stallone était parmi les spectateurs de ce match et sans nul doute s'est-il inspiré de l'événement pour amorcer l'écriture de Rocky, qui, selon les dires de Stallone lui-même, a été rédigé en trois jours. A noter aussi, pour l'anecdote, que le final de Rocky que nous connaissons n'est pas celui prévu à la base dans le scénario. Apollo et Rocky devaient être communément portés en triomphe par la foule... Mais la production ne souhaitait pas dépenser de l'argent pour des figurants. Stallone a imaginé Rocky et Adrian restant seuls dans la salle du match et s'en allant main dans la main (d'où l'une des affiches, en noir et blanc). Cette scène fut tournée mais, très judicieusement, Avildsen, au montage, a préféré faire s'arrêter le film sur l'accolade de Rocky avec sa fiancée.
Ce jour-là, Mohammed Ali, le roi de la boxe, affrontait Chuck Wepner, quasi inconnu. Wepner jouait le match de sa vie et personne ne misait un kopeck sur lui. Il savait qu'il relevait là le challenge de son existence : être face à l'un des plus grands boxeurs de l'histoire du sport. Notre Chuck Wepner a réussi à tenir 15 rounds et même à envoyer le grand Ali au tapis ! Même si ce challenger ne l'a pas emporté, il a gagné l'estime et sidéré tout le public. Cette petite histoire, officielle, ne vous rappelle rien ? Sylvester Stallone était parmi les spectateurs de ce match et sans nul doute s'est-il inspiré de l'événement pour amorcer l'écriture de Rocky, qui, selon les dires de Stallone lui-même, a été rédigé en trois jours. A noter aussi, pour l'anecdote, que le final de Rocky que nous connaissons n'est pas celui prévu à la base dans le scénario. Apollo et Rocky devaient être communément portés en triomphe par la foule... Mais la production ne souhaitait pas dépenser de l'argent pour des figurants. Stallone a imaginé Rocky et Adrian restant seuls dans la salle du match et s'en allant main dans la main (d'où l'une des affiches, en noir et blanc). Cette scène fut tournée mais, très judicieusement, Avildsen, au montage, a préféré faire s'arrêter le film sur l'accolade de Rocky avec sa fiancée.
La taverne de l'enfer (Paradise Alley) - 1978
 Paradise Alley est l'un des films les plus méconnus de Stallone. Pratiquement introuvable dans le commerce (pas de DVD zone 2, quelques VHS de collection à un prix d'or), Paradise Alley est un film bien mystérieux, qui laisse une grande impression d'étrangeté après visionnage. Après la gloire obtenue avec Rocky, Sylvester Stallone s'est affirmé comme un auteur à part entière, capable à la fois d'écrire et d'incarner. Sur Paradise Alley, il se charge de tout : scénario, dialogues, réalisation, interprétation... Il va même jusqu'à chanter la musique du film, Too close to paradise, avec une voix d'Elvis désaccordé ! Paradise Alley reprend quelques ficelles tirées de Rocky : le combat, le challenge, le grand match final. Ici, on ne parle plus de boxe mais de catch, et le lutteur n'est pas Stallone mais son frère dans le film, Victor, interprété par le boxeur Lee Canalito, dont c'est presque le seul film. Paradise Alley raconte l'histoire de trois frères, dans le New York des années quarante, qui trouvent la combine des combats de catch pour se faire de l'argent. Autant le dire tout de suite, on reconnaît peu New York et encore moins les années quarante. Le film est truffé d'anachronismes... Pire que ça, il est carrément hors du temps. Paradise Alley fleure bon les seventies, mais, par delà le kitsch, donne l'impression d'élaborer une esthétique crasseuse, brumeuse, post-apocalyptique, complètement baroque et loufoque. Un film entre la comédie et le drame, dans lequel Sly livre l'une de ses pires prestations d'acteur. Un véritable OVNI dans la filmographie de Stallone. Vraiment intriguant.
Paradise Alley est l'un des films les plus méconnus de Stallone. Pratiquement introuvable dans le commerce (pas de DVD zone 2, quelques VHS de collection à un prix d'or), Paradise Alley est un film bien mystérieux, qui laisse une grande impression d'étrangeté après visionnage. Après la gloire obtenue avec Rocky, Sylvester Stallone s'est affirmé comme un auteur à part entière, capable à la fois d'écrire et d'incarner. Sur Paradise Alley, il se charge de tout : scénario, dialogues, réalisation, interprétation... Il va même jusqu'à chanter la musique du film, Too close to paradise, avec une voix d'Elvis désaccordé ! Paradise Alley reprend quelques ficelles tirées de Rocky : le combat, le challenge, le grand match final. Ici, on ne parle plus de boxe mais de catch, et le lutteur n'est pas Stallone mais son frère dans le film, Victor, interprété par le boxeur Lee Canalito, dont c'est presque le seul film. Paradise Alley raconte l'histoire de trois frères, dans le New York des années quarante, qui trouvent la combine des combats de catch pour se faire de l'argent. Autant le dire tout de suite, on reconnaît peu New York et encore moins les années quarante. Le film est truffé d'anachronismes... Pire que ça, il est carrément hors du temps. Paradise Alley fleure bon les seventies, mais, par delà le kitsch, donne l'impression d'élaborer une esthétique crasseuse, brumeuse, post-apocalyptique, complètement baroque et loufoque. Un film entre la comédie et le drame, dans lequel Sly livre l'une de ses pires prestations d'acteur. Un véritable OVNI dans la filmographie de Stallone. Vraiment intriguant.
Rocky II - 1979
 Un Rocky commence là où s'est terminé le précédent. Trois ans après le très grand succès de Rocky sort une suite. Notre boxeur, après quelques tergiversations, reprend les gants pour un match revanche contre Apollo Creed. Ce que l'on reproche aux séquelles de Rocky et de Rambo, c'est que Stallone donne dans l'auto-caricature. Il reprend les mêmes ingrédients et les développe jusqu'au ridicule. Rocky Balboa n'est plus un brave type un peu paumé mais fait carrément figure de débile léger. L'aspect social du premier opus s'estompe et devient ici mineur. L'histoire d'amour entre Rocky et Adrienne, modeste et humoristique à la base, devient une romance très maniérée et mielleuse. Sans être réellement mauvais, ce nouveau Rocky se révèle beaucoup plus fade que le précédent. On notera aussi l'importance qu'a pris la religion, thème plutôt absent du premier volet. « C'est surtout à Dieu que je rend grâce » déclare Rocky après son combat. Le public n'est pas aussi nombreux pour le second Rocky que pour le premier mais les bénéfices restent confortables. On passe de 117 à 85 millions de dollars de recette. Le public français, quant à lui, reste toujours insensible aux charmes de Balboa. Le nombre d'entrées vendues dépasse petitement 500 000 tickets : le score le plus faible sur l'ensemble des cinq films. On notera la prise de gallon de Stallone à Hollywood, qui s'est largement affirmé à partir de l'énorme succès de Rocky. Il n'est plus "seulement" scénariste et acteur principal, dans Rocky II, mais aussi réalisateur. Parallèlement à cela, il est intéressant de noter, déjà, l'évolution de ce qui deviendra la franchise Rocky. Rocky, premier du nom, était une revanche. Une revanche sur la vie, sur la pauvreté, sur les préjugés, où un p'tit gars à force de courir dans des escaliers finit par se hisser en haut de l'affiche et montrer sa tête au peuple. Dans sa longue clameur finale, Rocky crie « Adrienne », mais quelque part, c'est aussi un « j'existe » qu'il balance à la foule conquise non par l'issue du match, mais par sa performance et son culot. Dans Rocky II, et de fait, dans ses suites, le boxeur n'a plus à faire ses preuves. Il est champion du monde, la foule l'adule. Il deviendra un modèle (Rocky III), voir un symbole patriotique (Rocky IV). Ses combats n'auront plus pour but la volonté rageuse de sortir de sa condition, mais celle, plus matérialiste, de conserver ses nouveaux acquis. Tout comme Rambo, qui dès Rambo II, n'est plus le stigmate vivant d'une guerre perdue, Rocky, à partir de Rocky II, n'est plus le porte-parole des "petits" mais une sorte d'icône. Une icône qui parle comme un charretier certes, mais qui, installé sur son piédestal, contemple son quartier avec la crainte enfouie d'y rechuter...
Un Rocky commence là où s'est terminé le précédent. Trois ans après le très grand succès de Rocky sort une suite. Notre boxeur, après quelques tergiversations, reprend les gants pour un match revanche contre Apollo Creed. Ce que l'on reproche aux séquelles de Rocky et de Rambo, c'est que Stallone donne dans l'auto-caricature. Il reprend les mêmes ingrédients et les développe jusqu'au ridicule. Rocky Balboa n'est plus un brave type un peu paumé mais fait carrément figure de débile léger. L'aspect social du premier opus s'estompe et devient ici mineur. L'histoire d'amour entre Rocky et Adrienne, modeste et humoristique à la base, devient une romance très maniérée et mielleuse. Sans être réellement mauvais, ce nouveau Rocky se révèle beaucoup plus fade que le précédent. On notera aussi l'importance qu'a pris la religion, thème plutôt absent du premier volet. « C'est surtout à Dieu que je rend grâce » déclare Rocky après son combat. Le public n'est pas aussi nombreux pour le second Rocky que pour le premier mais les bénéfices restent confortables. On passe de 117 à 85 millions de dollars de recette. Le public français, quant à lui, reste toujours insensible aux charmes de Balboa. Le nombre d'entrées vendues dépasse petitement 500 000 tickets : le score le plus faible sur l'ensemble des cinq films. On notera la prise de gallon de Stallone à Hollywood, qui s'est largement affirmé à partir de l'énorme succès de Rocky. Il n'est plus "seulement" scénariste et acteur principal, dans Rocky II, mais aussi réalisateur. Parallèlement à cela, il est intéressant de noter, déjà, l'évolution de ce qui deviendra la franchise Rocky. Rocky, premier du nom, était une revanche. Une revanche sur la vie, sur la pauvreté, sur les préjugés, où un p'tit gars à force de courir dans des escaliers finit par se hisser en haut de l'affiche et montrer sa tête au peuple. Dans sa longue clameur finale, Rocky crie « Adrienne », mais quelque part, c'est aussi un « j'existe » qu'il balance à la foule conquise non par l'issue du match, mais par sa performance et son culot. Dans Rocky II, et de fait, dans ses suites, le boxeur n'a plus à faire ses preuves. Il est champion du monde, la foule l'adule. Il deviendra un modèle (Rocky III), voir un symbole patriotique (Rocky IV). Ses combats n'auront plus pour but la volonté rageuse de sortir de sa condition, mais celle, plus matérialiste, de conserver ses nouveaux acquis. Tout comme Rambo, qui dès Rambo II, n'est plus le stigmate vivant d'une guerre perdue, Rocky, à partir de Rocky II, n'est plus le porte-parole des "petits" mais une sorte d'icône. Une icône qui parle comme un charretier certes, mais qui, installé sur son piédestal, contemple son quartier avec la crainte enfouie d'y rechuter...
A nous la victoire (Victory) - 1981
 C'est un fait peu connu, mais Sylvester Stallone a déjà joué avec le brésilien Pelé, reconnu comme étant le plus grand joueur de football de tous les temps. C'était en 1981, dans Victory, traduisez, en français, « A nous la victoire ». L'histoire est celle d'un match de propagande qui s'organise : l'équipe de football de l'Allemagne nazie contre une équipe représentant le reste du monde, avec des joueurs sélectionnés dans les camps de travail allemands. Stallone, pour ce film, côtoie non seulement le plus grand joueur de football au monde, mais aussi l'un des réalisateurs les plus mythiques d'Hollywood : John Huston, dont la carrière s'étend de 1941 à 1986 ! On retient de John Huston Le Faucon maltais et African Queen mais très peu souvent Victory. Et pour cause, le film est plutôt mauvais. Il s'agit d'une commande de studio, se basant sur le patchwork de stars et misant sur les thèmes fédérateurs du football et de la résistance pour faire mouche auprès des spectateurs. Notre Sly se retrouve donc au milieu d'un casting impressionnant, réunissant des acteurs d'envergure comme Michael Caine (Dressed to kill) et Max von Sydow (le prêtre dans L'exorciste) et de véritables stars du football international des années soixante-dix : Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Paul Van Himst, Co Prins et d'autres dont les noms n'évoqueront quelques souvenirs qu'aux vieux passionnés de football. Au milieu de tout ce beau monde, Stallone tient l'un des rôles principaux. Plus doué pour le football américain qu'anglais, il devient le gardien de but de l'équipe. Amusant à regarder pour les amateurs de football, Victory n'en demeure pas moins anecdotique pour les cinéphiles. Le film est aussi réaliste à propos des camps nazis qu'a pu l'être en son temps la série TV Papa Schulz. Les prisonniers de guerre, dans leurs baraquements, semblent plus être dans un camp de vacances que dans un camp de travail. Et ne parlons pas des costumes et décors. Si vous observez bien les scènes de foule, il vous sera possible de repérer quelques personnes en jogging fluo et autres accoutrements typiquement eighties. Les anachronismes sont fleuves, la reconstitution est vraiment peu crédible. Restent un petit côté « Grande évasion » qui plaira peut-être à quelques nostalgiques et les fabuleux dribbles de Pelé qui n'émouvront que quelques inconditionnels footeux. Un film anecdotique, dans la carrière de Stallone comme dans celle de Huston.
C'est un fait peu connu, mais Sylvester Stallone a déjà joué avec le brésilien Pelé, reconnu comme étant le plus grand joueur de football de tous les temps. C'était en 1981, dans Victory, traduisez, en français, « A nous la victoire ». L'histoire est celle d'un match de propagande qui s'organise : l'équipe de football de l'Allemagne nazie contre une équipe représentant le reste du monde, avec des joueurs sélectionnés dans les camps de travail allemands. Stallone, pour ce film, côtoie non seulement le plus grand joueur de football au monde, mais aussi l'un des réalisateurs les plus mythiques d'Hollywood : John Huston, dont la carrière s'étend de 1941 à 1986 ! On retient de John Huston Le Faucon maltais et African Queen mais très peu souvent Victory. Et pour cause, le film est plutôt mauvais. Il s'agit d'une commande de studio, se basant sur le patchwork de stars et misant sur les thèmes fédérateurs du football et de la résistance pour faire mouche auprès des spectateurs. Notre Sly se retrouve donc au milieu d'un casting impressionnant, réunissant des acteurs d'envergure comme Michael Caine (Dressed to kill) et Max von Sydow (le prêtre dans L'exorciste) et de véritables stars du football international des années soixante-dix : Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Paul Van Himst, Co Prins et d'autres dont les noms n'évoqueront quelques souvenirs qu'aux vieux passionnés de football. Au milieu de tout ce beau monde, Stallone tient l'un des rôles principaux. Plus doué pour le football américain qu'anglais, il devient le gardien de but de l'équipe. Amusant à regarder pour les amateurs de football, Victory n'en demeure pas moins anecdotique pour les cinéphiles. Le film est aussi réaliste à propos des camps nazis qu'a pu l'être en son temps la série TV Papa Schulz. Les prisonniers de guerre, dans leurs baraquements, semblent plus être dans un camp de vacances que dans un camp de travail. Et ne parlons pas des costumes et décors. Si vous observez bien les scènes de foule, il vous sera possible de repérer quelques personnes en jogging fluo et autres accoutrements typiquement eighties. Les anachronismes sont fleuves, la reconstitution est vraiment peu crédible. Restent un petit côté « Grande évasion » qui plaira peut-être à quelques nostalgiques et les fabuleux dribbles de Pelé qui n'émouvront que quelques inconditionnels footeux. Un film anecdotique, dans la carrière de Stallone comme dans celle de Huston.
Les Faucons de la Nuit (Nighthawks) - 1981
 Une vieille femme marche seule dans une rue de New York. Derrière elle, des silhouettes de jeunes sauvageons se dessinent dans la nuit. Le spectateur va assister impuissant à un nouvel exemple de l'insécurité urbaine ? Son estomac se noue et ses poings se serrent... mais que fait la police ? Où est Charles Bronson ? Soudain, la vieillarde tabasse ses agresseurs à coups de sac à main... Mais qui se cache sous ce châle ? Ca alors, c'est Sylvester Stallone !! Et oui, voici une entrée en matière peu commune pour un acteur qui deviendra l'emblème du gros bras et d'une certaine idée de la virilité. D'ailleurs visionner Les Faucons de la Nuit laisse aujourd'hui une curieuse impression par rapport à l'image actuelle de l'acteur. En duo avec Billy Dee Williams (Lando Calrissian chez George Lucas), Stallone interprète ici un policier chargé de la petite délinquance, vétéran traumatisé du Viet Nam, résolument non-violent et n'hésitant pas à se grimer en victime potentielle ! Il y a des films qui arrivent trop tard dans une carrière, autant dire que celui-ci arrive paradoxalement beaucoup trop tôt. Voir Stallone portant barbe et lunettes hésiter à tirer sur un terroriste laisse planer une impression de surréalisme, comme si les Faucons de la Nuit résumait prophétiquement toute la future carrière de l'acteur sous l'angle d'un effet de miroir pervers. Quel dommage qu'il ne soit pas sorti après Rambo II ou Rocky IV. En lui même, le film est un petit polar bien troussé où deux flics de la rue rejoignent une unité de contre-terrorisme visant à l'élimination (et non pas l'arrestation) d'un poseur de bombe mégalo. Réalisé joliment dans un New York tout sale, se permettant quelques fulgurances visuelles (un hélicoptère face à un téléférique), Les Faucons de la Nuit est un film assez classe, plus orienté sur les rouages de son intrigue agréable que sur les scènes d'action, rares et sèches. Veste en cuir et ray-ban, Stallone a un look d'enfer lorsqu'il ne porte pas la jupe et s'accommode parfaitement de son personnage désabusé en lutte avec ses idéaux. Jeu subtil et charisme infernal, il offre ici l'une de ses meilleures performances d'acteur. Pour l'un de ses meilleurs rôles...
Une vieille femme marche seule dans une rue de New York. Derrière elle, des silhouettes de jeunes sauvageons se dessinent dans la nuit. Le spectateur va assister impuissant à un nouvel exemple de l'insécurité urbaine ? Son estomac se noue et ses poings se serrent... mais que fait la police ? Où est Charles Bronson ? Soudain, la vieillarde tabasse ses agresseurs à coups de sac à main... Mais qui se cache sous ce châle ? Ca alors, c'est Sylvester Stallone !! Et oui, voici une entrée en matière peu commune pour un acteur qui deviendra l'emblème du gros bras et d'une certaine idée de la virilité. D'ailleurs visionner Les Faucons de la Nuit laisse aujourd'hui une curieuse impression par rapport à l'image actuelle de l'acteur. En duo avec Billy Dee Williams (Lando Calrissian chez George Lucas), Stallone interprète ici un policier chargé de la petite délinquance, vétéran traumatisé du Viet Nam, résolument non-violent et n'hésitant pas à se grimer en victime potentielle ! Il y a des films qui arrivent trop tard dans une carrière, autant dire que celui-ci arrive paradoxalement beaucoup trop tôt. Voir Stallone portant barbe et lunettes hésiter à tirer sur un terroriste laisse planer une impression de surréalisme, comme si les Faucons de la Nuit résumait prophétiquement toute la future carrière de l'acteur sous l'angle d'un effet de miroir pervers. Quel dommage qu'il ne soit pas sorti après Rambo II ou Rocky IV. En lui même, le film est un petit polar bien troussé où deux flics de la rue rejoignent une unité de contre-terrorisme visant à l'élimination (et non pas l'arrestation) d'un poseur de bombe mégalo. Réalisé joliment dans un New York tout sale, se permettant quelques fulgurances visuelles (un hélicoptère face à un téléférique), Les Faucons de la Nuit est un film assez classe, plus orienté sur les rouages de son intrigue agréable que sur les scènes d'action, rares et sèches. Veste en cuir et ray-ban, Stallone a un look d'enfer lorsqu'il ne porte pas la jupe et s'accommode parfaitement de son personnage désabusé en lutte avec ses idéaux. Jeu subtil et charisme infernal, il offre ici l'une de ses meilleures performances d'acteur. Pour l'un de ses meilleurs rôles...
Rocky III - 1982
Toum...toumtoumtoum....toumtoumtoum...toudouuum....toum...
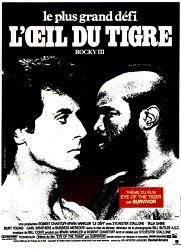
Qui a oublié ce thème ? Qui a oublié cette chanson de Survivor ? Qui a oublié cette confrontation où Rocky vacille sous les poings énervés de Mister T ? Rocky III, c'est un peu la quintessence de la franchise du boxeur, qui trouvera toute son identité visuelle et sonore influencée par les années quatre-vingt. 1982 donc, Sylvester Stallone reprend son poste de réalisateur et remonte sur le ring. Une musique marquante, un goût pour le show, un adversaire bien méchant... Rocky III partait comme une suite de routine qui perdrait en symbolique ce qu'elle gagne en légende. Pourtant, le film prend une tournure inattendue. En effet, Rocky III détruit littéralement ses deux prédécesseurs, insinuant que le succès et les victoires de Rocky ne sont basés que sur du vent. Grand champion pour le public, il reste à Rocky à trouver la légitimité dont il doute, au terme d'un combat tant physique qu'intérieur où il partira en quête de « l'oeil du tigre », ce qui le hantait alors qu'il n'était qu'un moins que rien. Remettant en cause deux films dont un culte, Rocky III s'interroge sur la notion de succès, mettant en scène un Rocky embourgeoisé qui doit se battre pour retrouver outre son titre, un bien-fondé qu'il n'a semble-t-il jamais eu. De la même manière que Rocky V, bien que les films soient sensiblement différents, Rocky III retourne aux sources, dans la salle de sport modeste où des combattants authentiques attendent leur heure. Stallone campe un boxeur fragile et encore peu habitué à un succès qu'il rejette et recherche à la fois. Sa réaction face à une statue qui lui est érigé est explicite : presque écrasé sous le poids de sa propre représentation portée aux nues, il prononcera un discours humble et gêné lors de son investiture, avant de lui assener plus tard un féroce coup de casque, devenu dégoûté de sa propre image, ce morceau de bronze représentant tout ce qu'il a réussi à construire et qui risque de lui filer entre les doigts. Réflexion culottée, Rocky III pourrait également être vu comme une mise en abîme pour un Stallone devenu soudain star de cinéma, s'interrogeant sur son statut. On devine dans les errances de Rocky l'ombre d'un acteur/réalisateur posant à plat son parcours, passant d'un film de cul miteux à deux personnages emblématiques, une phase de doute où la peur de ne rien avoir mérité prend le pas sur l'apogée d'une carrière. Rocky III traduit un besoin de distance, où Stallone comme Rocky tournent le dos quelques instants à leurs histoires respectives pour retourner aux origines de tout, le temps de dire que non, même si l'un ou l'autre brassent les dollars, ils n'ont pas oublié les périodes de vaches maigres à boxer des quartiers de viande.
D'une écriture surprenante, bien réalisé et interprété de manière convaincante par un Stallone habité, cet épisode assez sombre et souvent décrié reste sans doute l'un des plus intéressants de la saga.
Rambo (First Blood) - 1982

Qui a dit qu'un film d'action était forcément inintelligible et mauvais ? A tous ceux qui dénigrent le genre, regardez First Blood, de Ted Kotcheff, un film mettant en scène le vétéran de la guerre du Vietnam John Rambo, considéré comme le premier grand du genre. Rambo, premier du nom, n'est pas, comme on le croit souvent, un amas de grands élans patriotiques et anti-communistes, bien au contraire. La qualité de First Blood a souvent été étouffée par ses deux séquelles. First Blood est un film profond, dramatique et révélateur du grand traumatisme subi par la population américaine. Le premier film à avoir parlé des énormes dégâts causés par l'embourbement au Vietnam est sorti fin des années soixante-dix. C'était Deer Hunter (Voyage au bout de l'enfer) de Michael Cimino. Courant des années quatre-vingt, plusieurs films se sont à nouveau penchés, de diverses manières, sur le malaise : Platoon, Né un 4 juillet, Full Metal Jacket, Good morning Vietnam et surtout... First Blood. Le film de Kotcheff raconte l'histoire d'un vétéran du Vietnam arrivant dans une petite ville où il se heurte dès ses premiers pas au shérif qui ne veut pas de vagabonds "dans son genre" dans son fief. Obstiné, Rambo s'entête à vouloir rester dans cette bourgade et la police locale réagit de manière très violente à sa résistance. Rambo, pourchassé, finit par s'enfuir dans les bois où il mène contre les autorités une véritable guérilla. L'essentiel du film est basé sur les péripéties : courses-poursuites, explosions, pièges... On observe la mécanique guerrière de Rambo. Le film aurait pu être bien moins marquant s'il n'y avait pas eu cette explosion finale : le monologue de Rambo, en sanglot, se vidant de la terreur qu'il a accumulé pendant ses années de service. Les cinq minutes de gémissements et de rage vociférées par Stallone dans les derniers moments du film rendent de suite irrecevable toute parole dénigrante à propos de son talent d'acteur. Avec First Blood, Sylvester Stallone signe son deuxième chef d'oeuvre d'acteur, qui se faisait attendre depuis 1976. Pour l'anecdote, on rappellera qu'une fin alternative à celle que nous connaissons a été tournée, faisant mourir Rambo. Elle est visible en bonus de l'ultimate edition. Cette scène aurait été retenue que l'on n'aurait pas connu les deux séquelles de 1985 et 1988, ce qui n'aurait pas forcément été un mal... Pour ce qui est du box-office, First Blood se hisse dans le top de l'année, avec 125 millions de recette pour environ quatorze millions de budget. Le score de Rocky III est à peu près équivalent. Sans nul doute, 1982 fut la très grande année de Stallone.
Staying Alive - 1983
 Sylvester Stallone est tout en haut de sa forme lorsqu'il s'attaque à la réalisation de Staying Alive, First Blood et Rocky III ayant tous deux fait un malheur au box office. Staying Alive reste à ce jour le seul film réalisé par Stallone dans lequel il ne joue pas (même si on l'aperçoit à un moment du film, le temps d'une bousculade). Bandeaux rouges dans les cheveux, coupes "mulet", marcels jaunes, couronnes de paillettes, hauts ultra cintrés, moumoutes... Staying alive est un monument du kitsch. Avec ce film, John Travolta surfe sur la vague Saturday night fever, le film qui l'a révélé en 1977. Staying Alive, un autre grand tube des Bee Gees, sert de titre et de chanson de clôture à la seule et unique comédie musicale écrite par Sly. Staying alive est un film sur la danse et dont la trame repose essentiellement sur la romance. Tony Manero, coureur de jupon à la démarche chaloupée, est tiraillé entre deux amours : d'un côté la simplicité et la gentillesse de sa compagne Jackie, de l'autre, le lunatisme et la prétention de Laura, richissime star de Broadway. On sent bien le scénario écrit par Stallone. Un gars un peu simplet et spontané qui, au début du film, n'est même pas pris comme figurant dans une troupe miteuse et qui finit quatre-vingt-dix minutes plus tard star de Broadway. Ca ne vous rappelle pas un certain Rocky ? Mais Staying alive ne relève pas du genre sportif ou d'action. On nage ici en pleine romance et, bien que le film verse dans les clichés du genre, avec des jeux de regard appuyés, on peut être assez surpris du discours tenu. Pas de happy end romantique, Tony n'arrive jamais véritablement à se décider entre ses deux femmes, le sentiment amoureux reste, jusque dans les dernières minutes, tout à fait instable, fragile. Inutile de vous le dire, vous l'aurez deviné rien qu'à la vue de l'affiche (splendide), Staying alive a très mal vieilli. La BO est des plus ringardes (elle est signée Frank Stallone, le frère de Sly, qui joue et chante dans le film) et le kitsch, que nous avons déjà évoqué, atteint un niveau imbattable lors des vingt dernières minutes, celles de la représentation, avec un Travolta survolté et en sueur se trémoussant dans un petit slip Tarzan et dont la chorégraphie, qui semble pourtant déchaîner le public, ne se limite qu'à de petits sautillements...
Sylvester Stallone est tout en haut de sa forme lorsqu'il s'attaque à la réalisation de Staying Alive, First Blood et Rocky III ayant tous deux fait un malheur au box office. Staying Alive reste à ce jour le seul film réalisé par Stallone dans lequel il ne joue pas (même si on l'aperçoit à un moment du film, le temps d'une bousculade). Bandeaux rouges dans les cheveux, coupes "mulet", marcels jaunes, couronnes de paillettes, hauts ultra cintrés, moumoutes... Staying alive est un monument du kitsch. Avec ce film, John Travolta surfe sur la vague Saturday night fever, le film qui l'a révélé en 1977. Staying Alive, un autre grand tube des Bee Gees, sert de titre et de chanson de clôture à la seule et unique comédie musicale écrite par Sly. Staying alive est un film sur la danse et dont la trame repose essentiellement sur la romance. Tony Manero, coureur de jupon à la démarche chaloupée, est tiraillé entre deux amours : d'un côté la simplicité et la gentillesse de sa compagne Jackie, de l'autre, le lunatisme et la prétention de Laura, richissime star de Broadway. On sent bien le scénario écrit par Stallone. Un gars un peu simplet et spontané qui, au début du film, n'est même pas pris comme figurant dans une troupe miteuse et qui finit quatre-vingt-dix minutes plus tard star de Broadway. Ca ne vous rappelle pas un certain Rocky ? Mais Staying alive ne relève pas du genre sportif ou d'action. On nage ici en pleine romance et, bien que le film verse dans les clichés du genre, avec des jeux de regard appuyés, on peut être assez surpris du discours tenu. Pas de happy end romantique, Tony n'arrive jamais véritablement à se décider entre ses deux femmes, le sentiment amoureux reste, jusque dans les dernières minutes, tout à fait instable, fragile. Inutile de vous le dire, vous l'aurez deviné rien qu'à la vue de l'affiche (splendide), Staying alive a très mal vieilli. La BO est des plus ringardes (elle est signée Frank Stallone, le frère de Sly, qui joue et chante dans le film) et le kitsch, que nous avons déjà évoqué, atteint un niveau imbattable lors des vingt dernières minutes, celles de la représentation, avec un Travolta survolté et en sueur se trémoussant dans un petit slip Tarzan et dont la chorégraphie, qui semble pourtant déchaîner le public, ne se limite qu'à de petits sautillements...
New York cowboy (Rhinestone) - 1984
 Restons dans le kitsch. Après avoir signé la réalisation de l'une des comédies musicales les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, Sylvester Stallone joue dans Rhinestone, sa toute première comédie. L'histoire est rabâchée : il s'agit d'un pari passé par une chanteuse et son manager, de transformer un looser en chanteur country. Le looser, c'est bien évidemment Stallone, qui interprète ici Nick Martinelli, un chauffeur de taxi blagueur et un tantinet crétin. On ne peut vraiment pas dire que le poids des années ait apporté aux films : Sylvester Stallone et Dolly Parton, une chanteuse country très populaire aux Etats-Unis, rivalisent l'un l'autre en matière de touffe permanentée et de costumes ridicules mélangeant influences cow-boys et paillettes. Les amateurs de nanar se régaleront à la vue du ramassis de clichés typiques de la comédie hollywoodienne de base : l'intrigue amoureuse classique, le portrait caricatural des populations italiennes et texanes, et le fameux "coup de poing féminin"... Ceux qui ont pris plaisir à écouter les impertinences vocales de Stallone sur la B.O. de Paradise Alley se régaleront en regardant Rhinestone, qui multiplie les passages chantés. Stallone s'égosille comme un porc castré, se couvre de ridicule dans des costumes de cow-boys de supermarchés mais finit, vous vous en doutez bien, par gagner son aura de crooner. L'un des pires flops de la carrière de Sly, bien classé dans la liste IMDB des pires films jamais réalisés. Navet ou nanar ? A vous de juger !
Restons dans le kitsch. Après avoir signé la réalisation de l'une des comédies musicales les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, Sylvester Stallone joue dans Rhinestone, sa toute première comédie. L'histoire est rabâchée : il s'agit d'un pari passé par une chanteuse et son manager, de transformer un looser en chanteur country. Le looser, c'est bien évidemment Stallone, qui interprète ici Nick Martinelli, un chauffeur de taxi blagueur et un tantinet crétin. On ne peut vraiment pas dire que le poids des années ait apporté aux films : Sylvester Stallone et Dolly Parton, une chanteuse country très populaire aux Etats-Unis, rivalisent l'un l'autre en matière de touffe permanentée et de costumes ridicules mélangeant influences cow-boys et paillettes. Les amateurs de nanar se régaleront à la vue du ramassis de clichés typiques de la comédie hollywoodienne de base : l'intrigue amoureuse classique, le portrait caricatural des populations italiennes et texanes, et le fameux "coup de poing féminin"... Ceux qui ont pris plaisir à écouter les impertinences vocales de Stallone sur la B.O. de Paradise Alley se régaleront en regardant Rhinestone, qui multiplie les passages chantés. Stallone s'égosille comme un porc castré, se couvre de ridicule dans des costumes de cow-boys de supermarchés mais finit, vous vous en doutez bien, par gagner son aura de crooner. L'un des pires flops de la carrière de Sly, bien classé dans la liste IMDB des pires films jamais réalisés. Navet ou nanar ? A vous de juger !
First Blood part II (Rambo II : la mission) - 1984
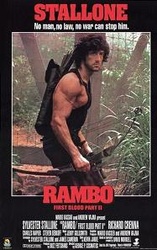
« Colonel ? Cette fois on y va pour gagner ? »
« Cette fois, ça dépend de toi »
Ne cherchez pas la transition entre First Blood, film d'action non dépourvu d'intelligence et révélateur d'un traumatisme américain et sa séquelle directe, First Blood part II. Si l'acteur principal et le personnage mis en scène sont bien les mêmes, les films n'ont, dans leur contenu, strictement rien à voir. Comme nous le savons, les derniers G.I. ont quitté le Vietnam en 1973. La guerre terminée, il a fallu plusieurs années pour que des films rendent compte du traumatisme causé. Alors que First Blood donnait dans le devoir de mémoire, First Blood II se fait porteur d'un message complètement à l'opposé idéologique. John Rambo, aux travaux forcés depuis son pétage de plomb, est rappelé par son fameux colonel Trautman (Richard Crenna) pour une mission très spéciale. C'est bien simple, Rambo va revenir au Vietnam pour libérer les derniers prisonniers américains et, au passage, rectifier le cours de l'histoire et gagner la guerre à lui tout seul. Les ennemis ? Des salauds de communistes vietnamiens et des salauds de communistes russes. Eh oui, la guerre froide n'est pas totalement terminée. Rambo II est certainement le film le plus bêtement patriotique, revanchard, manichéen et anti-communiste pondu par l'industrie américaine depuis l'invention du cinéma. Il faut remettre les choses dans leurs contextes. Les années quatre-vingt, aux Etats-Unis, ce sont les années reaganiennes. Ronald Reagan, quarantième président des Etats-Unis, était très marqué anti-communiste (Il appelait l'URSS "l'empire du mal") et pro militariste (il fit gonfler le budget de la défense et de l'armée de manière considérable). Beaucoup des films d'action tournés lors de ces années quatre-vingt étaient imbibés de cet esprit de "la paix dans la force". Rambo II est sans conteste la figure de proue de tous ces films. Pour réconcilier les américains avec leur pays, on rectifie l'histoire à grand coup de révisionnisme et de fascisme (éradiquons toute menace extérieure). « Ce qui est arrivé ici est peut-être moche, mais tu ne dois pas haïr ton pays pour ça » décoche Trautman à Rambo à la fin du film, lequel répond : « Le haïr ? Je mourrais pour lui ! ». On doit le scénario de Rambo II à James Cameron et Sylvester Stallone lui-même, vraisemblablement convaincus de la présence de prisonniers américains au Vietnam, vingt ans après la fin de la guerre. A la réalisation, on retrouve Cosmatos, qui collaborera à nouveau avec Stallone sur un autre film au contenu douteux, Cobra. Le gros de la bande originale est signée Jerry Goldsmith, mais, comme souvent, Sylvester a confié à son frère Frank l'écriture de la chanson de clôture, qu'il a composé et interprété : Peace in our lives : « Paix dans nos vies, rappelez-vous de l'appel - Des applaudissements pour mes frères, rappelez vous d'eux - Foyer des braves, nous ne tomberons jamais - La force de notre nation nous appartient à tous ». Rambo II est l'un des grands succès de l'année 1985. Il rapporte 300 millions de dollars et cartonne autant aux Etats-Unis qu'en Europe.
Rocky IV - 1985

Rocky IV1985, l'année du désastre. Après un troisième opus surprenant, Stallone se remet en scène dans son rôle fétiche. Alors que le cinéma d'action reprend allégrement les idées de Reagan, nous livrant des films aussi insensés que L'Aube Rouge ou Portés Disparus, Rocky IV semblait partir d'une bonne intention, à base de pacifisme et d'entente entre les peuples. Hélas, ce n'est au final qu'une boursouflure que le temps finit par rendre autant rigolote qu'affligeante de patriotisme primaire. Le générique donne le ton, alors qu'un gant de boxe aux couleurs de l'Amérique pulvérise un autre gant aux armes de la Russie. La suite est du même acabit : Au cours d'un combat amical contre un obscur Russe venu de ses froides contrées défier Balboa, Apollo Creed trouve la mort sous les yeux médusés de Rocky. Ce dernier va alors relever le challenge de ce nouveau venu, Yvan Drago, et s'envoler pour la Russie, afin de venger son mentor et montrer au passage qu'on ne le provoque pas impunément. On ne va pas tergiverser sur le symbolisme de la chose, Rocky IV est un joyeux nanar où Sly gagne la Guerre Froide a lui tout seul face à un jeunot nommé Dolph Lundgren, plus monolithique que jamais. Jouant avec les comparaisons foireuses -les entraînements respectifs de l'Américain et du Russe- et les touches d'humour de mauvais goûts -le robot de Paulie, le show d'Apollo-, Rocky IV se suit avec le sourire aux lèvres jusqu'à son apocalyptique match final, moment d'anthologie où Sly et Dolph se tapent dessus comme des sourds au cours d'un pugilat manquant de virer au combat de catch. Le tout étant achevé par un discours final entré depuis dans les annales. Du bonheur pour les soirées bières ! Si Stallone nous livre un scénario ni fait ni à faire, il faut toutefois lui reconnaître une certaine maîtrise technique, prouvant à nouveau son statut de réalisateur intéressant. Vif ou calme quand il le faut, Rocky IV n'accuse aucune saute de rythme et trouve son paroxysme dans ses combats aussi bouffons qu'indéniablement intenses. Mais pas d'oscars pour cette fois. Après Rambo II et avant l'inénarrable Rambo III, Sly franchit un nouveau pas dans le cinéma bas du front et il y a fort à parier que ces quelques films aussi malheureux que malheureusement ancrés dans leurs époques aient contribué à construire l'image ringarde et beuglante dont l'acteur porte toujours les stigmates. Pour Dolph Lundgren en revanche, l'affaire est bonne. Son physique impressionnant ainsi remarqué, Rocky IV ne fait rien de moins que lancer sa carrière.
Cobra - 1986
 En deux ans, Sylvester Stallone a signé deux des plus grands nanars de l'histoire du cinéma. Rocky IV et Cobra. Son image en a pris un coup. En 1986 sort Cobra, un film d'action pur et dur, affichant un duo très en vogue à l'époque : Brigitte Nielsen et Sylvester Stallone. Un couple à l'écran mais aussi dans la vie. Fraîchement divorcé de sa première femme, Sasha Czack, en 1985, Stallone se remarie avec la très célèbre actrice de série B, Brigitte Nielsen. La presse people se déchaîne sur le couple de bodybuildés. Les tourtereaux sont, à l'époque, au sommet de leur gloire médiatique. Et Cobra, qui se devait être un propulseur définitif, a reçu un accueil plutôt froid : un succès modeste au box office et, surtout, des critiques aussi assassines que justifiées. Cobra mérite, sur la longue liste des films d'action réacs, de figurer tout en haut du classement aux côtés des non moins radicaux Justicier dans la ville de Charles Bronson. Comme dans le film sus cité, le message délivré est simple : les criminels sont des détraqués. Il faut les éliminer, laver la société de ces impuretés. Stallone incarne Marion Cobretti, dit « Le Cobra », partisan de la manière forte. A de nombreux moments dans le film, on souligne grossièrement l'illégitimité du recours à la justice face à "la racaille". « Il faut vous adresser aux juges. Ils vont les enfermer, puis les libérer » ironise le Cobra. Violent, réactionnaire, Cobra est un monstre fasciste qui élimine tout sur son passage, sans aucun remord... Et avec classe ! Cobra est un action man, un nettoyeur, au profil typé et ridicule. Stallone arrive, les lunettes de soleil bleues métallisées lui couvrant la moitié du visage, une allumette au coin des lèvres (!), les santiags aux pieds, la barbe de quelques jours... Et il élimine tous les voyous à la sulfateuse l'air impassible. Les meilleures parodies n'atteignent pas ce niveau. La mission de Cobra est de protéger une jeune femme prise en chasse par un groupe de serial killers.
En deux ans, Sylvester Stallone a signé deux des plus grands nanars de l'histoire du cinéma. Rocky IV et Cobra. Son image en a pris un coup. En 1986 sort Cobra, un film d'action pur et dur, affichant un duo très en vogue à l'époque : Brigitte Nielsen et Sylvester Stallone. Un couple à l'écran mais aussi dans la vie. Fraîchement divorcé de sa première femme, Sasha Czack, en 1985, Stallone se remarie avec la très célèbre actrice de série B, Brigitte Nielsen. La presse people se déchaîne sur le couple de bodybuildés. Les tourtereaux sont, à l'époque, au sommet de leur gloire médiatique. Et Cobra, qui se devait être un propulseur définitif, a reçu un accueil plutôt froid : un succès modeste au box office et, surtout, des critiques aussi assassines que justifiées. Cobra mérite, sur la longue liste des films d'action réacs, de figurer tout en haut du classement aux côtés des non moins radicaux Justicier dans la ville de Charles Bronson. Comme dans le film sus cité, le message délivré est simple : les criminels sont des détraqués. Il faut les éliminer, laver la société de ces impuretés. Stallone incarne Marion Cobretti, dit « Le Cobra », partisan de la manière forte. A de nombreux moments dans le film, on souligne grossièrement l'illégitimité du recours à la justice face à "la racaille". « Il faut vous adresser aux juges. Ils vont les enfermer, puis les libérer » ironise le Cobra. Violent, réactionnaire, Cobra est un monstre fasciste qui élimine tout sur son passage, sans aucun remord... Et avec classe ! Cobra est un action man, un nettoyeur, au profil typé et ridicule. Stallone arrive, les lunettes de soleil bleues métallisées lui couvrant la moitié du visage, une allumette au coin des lèvres (!), les santiags aux pieds, la barbe de quelques jours... Et il élimine tous les voyous à la sulfateuse l'air impassible. Les meilleures parodies n'atteignent pas ce niveau. La mission de Cobra est de protéger une jeune femme prise en chasse par un groupe de serial killers.  Quand Stallone se fait garde du corps contre un gang de bikers fanatiques, c'est la troisième guerre mondiale ! Sortez les grenades et la sulfateuse ! On relèvera quelques passages, les plus débiles dans cette ode au bourrinage : le Cobra propulsant sa voiture en y injectant de la nitroglycérine et tirant à l'automatique de la main gauche en effectuant un dérapage parfaitement contrôlé de la main droite. Après un Rambo II aussi efficace qu'impensable, Stallone scellait là sa deuxième collaboration avec George Pan Cosmatos. Décédé en 2005, on se souviendra de Cosmatos comme d'un metteur en scène trouvant le feu sacré dans la série B énergique aux castings forts (ah, Leviathan...). Primaire et explosif, Cobra témoigne de l'indéniable aptitude de Cosmatos à livrer des films un minimum bien emballé et divertissant.
Quand Stallone se fait garde du corps contre un gang de bikers fanatiques, c'est la troisième guerre mondiale ! Sortez les grenades et la sulfateuse ! On relèvera quelques passages, les plus débiles dans cette ode au bourrinage : le Cobra propulsant sa voiture en y injectant de la nitroglycérine et tirant à l'automatique de la main gauche en effectuant un dérapage parfaitement contrôlé de la main droite. Après un Rambo II aussi efficace qu'impensable, Stallone scellait là sa deuxième collaboration avec George Pan Cosmatos. Décédé en 2005, on se souviendra de Cosmatos comme d'un metteur en scène trouvant le feu sacré dans la série B énergique aux castings forts (ah, Leviathan...). Primaire et explosif, Cobra témoigne de l'indéniable aptitude de Cosmatos à livrer des films un minimum bien emballé et divertissant.
Bras de Fer (Over the top) - 1987
 Pauvre Sylvester Stallone. A peine sort-il de la pantalonnade Cobra que le terrible Menahem Golan lui remet le grappin dessus. Bras de Fer est sans aucun doute le pire film dans lequel ait tourné notre ex-Rambo, L'Etalon Italien étant hors catégorie. C'est donc dans le giron de Cannon que Sly tourne cette histoire à la Doux Dur et Dingue, mettant en scène un routier partant à la conquête du championnat du monde de bras de fer. Surfant vaguement sur la vague Rocky, Bras de Fer tente de s'enrichir d'un certain fond social, mettant en scène un homme divorcé qui tentera de reconquérir son fils, tout en nous faisant suivre entraînements et compétions. Hélas, le résultat est à la hauteur du sujet. Si la naïveté des relations père-fils, qui s'entredéchirent pour mieux se retrouver, peut parvenir à faire illusion, en dépit de scènes téléphonées basées sur leurs différences respectives (Stallone se paye la honte dans un restoroute car son fils commande une salade...), le film sombre dans l'abîme de la stupidité dans ses phases sportives dégoulinantes de testostérone. Opposé à des adversaires plus baraqués les uns que les autres, Sly, le muscle plus hypertrophié que jamais, beugle, gémit, rougit et transpire comme un forgeron dans d'épique combat de bras de fer. A la fin, Stallone échange son camion tout pourri contre le truck flambant neuf de la victoire et s'en retourne sur les routes d'Amérique. Crétin et profondément beauf, Bras de Fer n'oublie pas de nous dispenser d'impayables scènes où notre routier se muscle le bras tout en conduisant, grâce à un ingénieux système de petites poulies. Film insensé où la mièvrerie se fait une place au milieu de figurants dont la carrure ferait passer Ken le Survivant pour une doublure de Sim, Bras de Fer ne provoque que trop rarement l'éclat de rire salvateur et s'avère même un produit profondément déprimant où Stallone se compromet dans une performance à la limite de la caricature, lui qui jadis excellait dans le registre du gars simple allant au bout de ses rêves. L'homme vaut tellement mieux. Heureusement, toutes les choses ont une fin, même les années 80...
Pauvre Sylvester Stallone. A peine sort-il de la pantalonnade Cobra que le terrible Menahem Golan lui remet le grappin dessus. Bras de Fer est sans aucun doute le pire film dans lequel ait tourné notre ex-Rambo, L'Etalon Italien étant hors catégorie. C'est donc dans le giron de Cannon que Sly tourne cette histoire à la Doux Dur et Dingue, mettant en scène un routier partant à la conquête du championnat du monde de bras de fer. Surfant vaguement sur la vague Rocky, Bras de Fer tente de s'enrichir d'un certain fond social, mettant en scène un homme divorcé qui tentera de reconquérir son fils, tout en nous faisant suivre entraînements et compétions. Hélas, le résultat est à la hauteur du sujet. Si la naïveté des relations père-fils, qui s'entredéchirent pour mieux se retrouver, peut parvenir à faire illusion, en dépit de scènes téléphonées basées sur leurs différences respectives (Stallone se paye la honte dans un restoroute car son fils commande une salade...), le film sombre dans l'abîme de la stupidité dans ses phases sportives dégoulinantes de testostérone. Opposé à des adversaires plus baraqués les uns que les autres, Sly, le muscle plus hypertrophié que jamais, beugle, gémit, rougit et transpire comme un forgeron dans d'épique combat de bras de fer. A la fin, Stallone échange son camion tout pourri contre le truck flambant neuf de la victoire et s'en retourne sur les routes d'Amérique. Crétin et profondément beauf, Bras de Fer n'oublie pas de nous dispenser d'impayables scènes où notre routier se muscle le bras tout en conduisant, grâce à un ingénieux système de petites poulies. Film insensé où la mièvrerie se fait une place au milieu de figurants dont la carrure ferait passer Ken le Survivant pour une doublure de Sim, Bras de Fer ne provoque que trop rarement l'éclat de rire salvateur et s'avère même un produit profondément déprimant où Stallone se compromet dans une performance à la limite de la caricature, lui qui jadis excellait dans le registre du gars simple allant au bout de ses rêves. L'homme vaut tellement mieux. Heureusement, toutes les choses ont une fin, même les années 80...
Rambo III - 1988
 Ce gros nul de colonel Trautman étant infoutu de partir en mission sans finir en geôle, Stallone enlève sa chemise, remonte son pantalon et s'envole en Afghanistan pour les besoins de Rambo III. Histoire de ne pas faire le voyage pour rien, il en profitera pour botter les fesses de ces salopiaux de Russes ne font rien qu'à martyriser un paisible peuple de gardiens de moutons. Si il fallait trouver une qualité à Rambo III, ce serait sans doute son côté décomplexé, accentué par un doublage français aux petits oignons. Rambo qui abat un hélicoptère avec son arc, la lampe bleue qui fait du bleu, « Dieu aurait pitié, lui non », « j'ai vidé quelques chargeurs », sans oublier l'immortel « Où sont localisés les missiles ? » « Dans ton cul ! » qui fit la joie de toute une génération, autant de scènes sur le fil du rasoir de la parodie qui font oublier le caractère bêtement réac du propos au profit d'un film d'action distrayant et bien fichu. Réalisé par Peter Mac Donald, qui dit-on laissa sa place à Russell Mulcahy (Highlander) le temps de quelques scènes, et bénéficiant à nouveau de la musique énergique de Jerry Goldsmith, Rambo III représente avant tout une sorte de vestige. Celui d'un cinéma d'action qui sentait la sueur et la poudre, où les explosions n'étaient pas des images de synthèses et où l'on osait se servir du nombre de morts à l'écran comme argument commercial. Alors oui, certaines répliques ou situations de Rambo III sont à se tordre de rire, oui, dédier ce demi-nanar au « courageux peuple Afghan » relève d'un sens de la gratification étrange, oui, à deux contre quarante-douze, ce sera dur de les encercler, et oui, les Russes ont un accent à couper au couteau, couteau qu'ils ont bien sur entre les dents pour mieux pouvoir manger les enfants. Il n'empêche que Rambo III reste, techniquement parlant, un film de qualité. D'un combat clandestin tonitruant en Thaïlande à un jeu Afghan bourrin en passant par une attaque de campement où Sly pique un sprint avant d'exploser un hélicoptère à la mitrailleuse, Rambo III, lisible et au rythme soutenu, ne faiblit jamais dans sa course à la surdose et à l'adrénaline. Avec son scénario anecdotique, son message d'un autre âge, et ne parlons même plus de l'évolution du personnage principal, Rambo III a pour lui le mérite de rester divertissant, d'offrir une action efficace et de balader son spectateur dans de splendides décors avec en bandoulière, un tantinet d'autodérision. A l'instar d'un Commando, Rambo III reste un de ces films que l'on aime avoir sous la main pour combler une soirée peinarde.
Ce gros nul de colonel Trautman étant infoutu de partir en mission sans finir en geôle, Stallone enlève sa chemise, remonte son pantalon et s'envole en Afghanistan pour les besoins de Rambo III. Histoire de ne pas faire le voyage pour rien, il en profitera pour botter les fesses de ces salopiaux de Russes ne font rien qu'à martyriser un paisible peuple de gardiens de moutons. Si il fallait trouver une qualité à Rambo III, ce serait sans doute son côté décomplexé, accentué par un doublage français aux petits oignons. Rambo qui abat un hélicoptère avec son arc, la lampe bleue qui fait du bleu, « Dieu aurait pitié, lui non », « j'ai vidé quelques chargeurs », sans oublier l'immortel « Où sont localisés les missiles ? » « Dans ton cul ! » qui fit la joie de toute une génération, autant de scènes sur le fil du rasoir de la parodie qui font oublier le caractère bêtement réac du propos au profit d'un film d'action distrayant et bien fichu. Réalisé par Peter Mac Donald, qui dit-on laissa sa place à Russell Mulcahy (Highlander) le temps de quelques scènes, et bénéficiant à nouveau de la musique énergique de Jerry Goldsmith, Rambo III représente avant tout une sorte de vestige. Celui d'un cinéma d'action qui sentait la sueur et la poudre, où les explosions n'étaient pas des images de synthèses et où l'on osait se servir du nombre de morts à l'écran comme argument commercial. Alors oui, certaines répliques ou situations de Rambo III sont à se tordre de rire, oui, dédier ce demi-nanar au « courageux peuple Afghan » relève d'un sens de la gratification étrange, oui, à deux contre quarante-douze, ce sera dur de les encercler, et oui, les Russes ont un accent à couper au couteau, couteau qu'ils ont bien sur entre les dents pour mieux pouvoir manger les enfants. Il n'empêche que Rambo III reste, techniquement parlant, un film de qualité. D'un combat clandestin tonitruant en Thaïlande à un jeu Afghan bourrin en passant par une attaque de campement où Sly pique un sprint avant d'exploser un hélicoptère à la mitrailleuse, Rambo III, lisible et au rythme soutenu, ne faiblit jamais dans sa course à la surdose et à l'adrénaline. Avec son scénario anecdotique, son message d'un autre âge, et ne parlons même plus de l'évolution du personnage principal, Rambo III a pour lui le mérite de rester divertissant, d'offrir une action efficace et de balader son spectateur dans de splendides décors avec en bandoulière, un tantinet d'autodérision. A l'instar d'un Commando, Rambo III reste un de ces films que l'on aime avoir sous la main pour combler une soirée peinarde.
Allez, pour le plaisir :
- « Tu m'entends ?
- Qui êtes-vous ?
- TON PIRE CAUCHEMAR !!! »
Après ces pérégrinations en Afghanistan, il est temps de parler plus en profondeur de ce que fut Rambo au cinéma. Principalement à partir de Rambo II, surgirent d'Amérique, d'Indonésie ou d'Italie quelques musculeux baroudeurs aux yeux éteints et à la mine déconfite. Rambo premier du nom, finalement le moins pétaradant et caricatural des trois, n'aura que peu d'émules. Toujours réactive lorsqu'il le faut, l'Italie délivrera toutefois quelques spécimens sympathiques. Dans Tonnerre, en 1983, le monolithique Mark Gregory délaissera ainsi son cuir post-apocalyptique des Guerriers du Bronze pour incarner un indien prenant les armes pour venger la terre profanée de ses ancêtres. Un peu plus tard, en 1985, Lamberto Bava sortira quant à lui un de ses films les plus estimés, Blastfighter, sous-Rambo mâtiné de Delivrance où un ancien flic apprend l'écologie à de vils braconniers, grosse pétoire à l'appui. En 1984, Enzo Castellari oublie pour sa part la jungle urbaine pour le désert dans Touareg, Le Guerrier du Désert, dans lequel Mark Harmon, ivre de vengeance, s'en va montrer de quel bois il se chauffe. Plus austères, les Etats Unis voient quand à eux l'occasion de la jouer patriotisme avec Portés Disparus (1984), envoyant Chuck Norris sauver l'honneur yankee au Viet Nam.
La sortie de Rambo II accélère les choses. L'Italie en profite pour accoucher d'un Tonnerre 2, tout en faisant un peu de recyclage avec Le Retour de Django. Dans cet étrange mic-mac virant du western au film de guérilla, Franco Nero reprend son rôle culte et joue de la mitrailleuse pour cette curieuse suite réalisée par Ted Archer. Le filon Rambo commence à se construire, au point que les distributeurs s'en mêlent, plagiant ici et là la célèbre affiche des deux premiers films, où Sly pose virilement, sa mitrailleuse à la main, dans des films n'ayant parfois aucun rapports. Ainsi le Tornado d'Antonio Margheriti, petit film de guerre n'ayant rien d'honteux sorti en 1983, voit tout bonnement son héros rebaptisé... Rando (!). Aussi mauvais que soit Rambo II, celui-ci marque les esprits. La scène dite de "la préparation" devient culte, au point d'être parodiée. Dans le Gremlins de Joe Dante, le mignon Gyzmo s'affuble d'un bandana avant de tirer à l'arc sur ses frères verdâtres. Chuck Norris continue de vider ses chargeurs dans Porté Disparu 2. Marc Lester voit dans cet engouement l'occasion de sortir le bourrin Commando, où Schwarzenegger massacre de vilains terroristes à coup de mitrailleuse, roquette, fusil et autres outils de jardin. Le Viet Nam envahit l'écran, recueillant dans sa jungle hostile des hommes seuls contre tous, ou parfois de petits commandos. Mark Gregory lui-même finira par y mettre les pieds dans Warbus, de Ferdinando Baldi. L'indécrottable Bruno Mattei n'est pas en reste et commet Strike Commando, qui n'est rien de moins qu'un demi-plagiat de Rambo II, où Sly est remplacé par le bovin Reb Brown. Le comble est atteint avec l'apparition d'un dessin animé Rambo, monument de stupidité où Stallone, grossièrement modélisé en un avatar hypertrophié, va de cavalcades en explosions.
Rambo III semblera toutefois calmer les esprits. Fidèle au poste, Fabrizio de Angelis lâche un Tonnerre 3, Pierluigi Ciriaci ballade Mark Gregory en Afghanistan dans le bien nommé Afghanistan - The Last Warbus, tandis que Joseph Zito envoie le grand Chuck sauver les enfants de Saigon dans le très violent Porté Disparu 3. Un film bien ancré dans son époque où le bon Braddock tanne le cuir des communistes à coup de fusil lance-grenades. Dans la catégorie du militaire confronté à la nature hostile, Air Force Bat 21 réussit pour sa part l'exploit de faire dans le sous-Porté Disparu, nous perdant Gene Hackman dans la jungle vietnamienne. Quelques incroyables perles, du calibre de Deadly Prey, nanar de haute volée où un simili-Rambo en minishort explose une ribambelle de sbires de diverses façons, égaient encore cette année 1988. Les années 90, moins belliqueuses, permettent à Tom Berenger de jouer au franc-tireur hanté par quelques démons dans le nerveux Sniper - Tireur d'Elite. Environnement hostile, hiérarchie reniée et répliques viriles -« Y'a pas de pédés dans la jungle ! »-, un cocktail classique et bien dosé pour un film efficace qui nous offre en prime du bullet-time avant l'heure. Et 1993 est bien sur l'année de Hot Shots 2, parodiant l'imagerie de Rambo pour l'hilarant résultat que l'on connaît.
Haute Sécurité (Lock up) - 1988
 Haute Sécurité sort la même année que l'horriblement patriotique et anti-russe Rambo III. Et, dans un sens, même si les deux histoires contées ne sont pas du tout les mêmes, les deux films convergent en un point commun : le culte du héros. Que ce soit en John Rambo ou en Franck Leone, Sylvester Stallone incarne celui par qui tout arrive. Celui qui fait se lever les foules, qui force le respect et l'admiration à grand coup de testostérone. Lock up - ou Haute sécurité dans sa traduction française - raconte l'histoire de Franck Leone, qui purge une peine de six mois de prison dans un centre pénitentiaire tranquille. Sans autre forme d'explication, Franck est tiré du lit une nuit pour être emmené dans un pénitencier cauchemardesque et concentrationnaire. Matons sadiques, tortures, humiliations, violences, Franck doit subir tous les outrages sans broncher pour espérer retrouver rapidement la liberté et vivre heureux avec sa femme qui l'attend. Mais Warden Drumgoole, le directeur de la prison, lui en veut terriblement pour des faits antérieurs et met tout en oeuvre pour faire craquer le détenu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la représentation qui est faite du milieu carcéral est complètement fictive. Le nombre d'incohérences est incalculable. On laisse partir Franck en week end dans sa première prison, on le transfère sans décision de justice au milieu de la nuit vers une autre prison, pourvue d'un garage dans lequel il est possible de passer ses journées à bricoler une grosse voiture sans rendre de compte à personne. Bref, ne cherchons pas à nous étendre, vous l'aurez de toute façon compris, Haute sécurité n'est pas un film de réalisme sur l'univers carcéral. Le film tourne du début à la fin autour du personnage idyllique, modéré, parfait, qu'incarne Stallone. On croirait certaines scènes tournées juste pour mettre en valeur la musculature de Sly (les flash du mitard, la cage au gaz mortel). A trois cents contre un, Franck Leone arrive tout de même à tirer son épingle du jeu et le film s'avance inexorablement vers le happy end. Haute Sécurité, dans la parfaite continuité de Rambo II et III ? Pas tout à fait. Ici, pas de patriotisme imbécile. Les valeurs transmises sont celles de la tolérance et de l'humanisme. Stallone incarne dans Haute Sécurité un homme qui court après le bonheur de la libération, un homme fidèle en amitié et en amour, capable de subir tous les outrages en ayant à l'esprit d'atteindre la fin de son calvaire. On est bien loin du discours du furieux Cobra, réalisé seulement deux ans plus tôt, qui condamnait tous les délinquants à la peine capitale. Ici, Stallone incarne un criminel à visage humain. Lock up démontre l'importance des valeurs humaines en prison et s'oppose formellement à la peine de mort. Evidemment, Haute sécurité reste un film d'action très viril, bourré de clichés et d'invraisemblances. Ne vous attendez pas à pouvoir le ranger entre le Trou de Jacques Becker et Midnight Express d'Alan Parker ! Un divertissement sans prétention mais très efficace, avec un message positif et un rythme soutenu.
Haute Sécurité sort la même année que l'horriblement patriotique et anti-russe Rambo III. Et, dans un sens, même si les deux histoires contées ne sont pas du tout les mêmes, les deux films convergent en un point commun : le culte du héros. Que ce soit en John Rambo ou en Franck Leone, Sylvester Stallone incarne celui par qui tout arrive. Celui qui fait se lever les foules, qui force le respect et l'admiration à grand coup de testostérone. Lock up - ou Haute sécurité dans sa traduction française - raconte l'histoire de Franck Leone, qui purge une peine de six mois de prison dans un centre pénitentiaire tranquille. Sans autre forme d'explication, Franck est tiré du lit une nuit pour être emmené dans un pénitencier cauchemardesque et concentrationnaire. Matons sadiques, tortures, humiliations, violences, Franck doit subir tous les outrages sans broncher pour espérer retrouver rapidement la liberté et vivre heureux avec sa femme qui l'attend. Mais Warden Drumgoole, le directeur de la prison, lui en veut terriblement pour des faits antérieurs et met tout en oeuvre pour faire craquer le détenu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la représentation qui est faite du milieu carcéral est complètement fictive. Le nombre d'incohérences est incalculable. On laisse partir Franck en week end dans sa première prison, on le transfère sans décision de justice au milieu de la nuit vers une autre prison, pourvue d'un garage dans lequel il est possible de passer ses journées à bricoler une grosse voiture sans rendre de compte à personne. Bref, ne cherchons pas à nous étendre, vous l'aurez de toute façon compris, Haute sécurité n'est pas un film de réalisme sur l'univers carcéral. Le film tourne du début à la fin autour du personnage idyllique, modéré, parfait, qu'incarne Stallone. On croirait certaines scènes tournées juste pour mettre en valeur la musculature de Sly (les flash du mitard, la cage au gaz mortel). A trois cents contre un, Franck Leone arrive tout de même à tirer son épingle du jeu et le film s'avance inexorablement vers le happy end. Haute Sécurité, dans la parfaite continuité de Rambo II et III ? Pas tout à fait. Ici, pas de patriotisme imbécile. Les valeurs transmises sont celles de la tolérance et de l'humanisme. Stallone incarne dans Haute Sécurité un homme qui court après le bonheur de la libération, un homme fidèle en amitié et en amour, capable de subir tous les outrages en ayant à l'esprit d'atteindre la fin de son calvaire. On est bien loin du discours du furieux Cobra, réalisé seulement deux ans plus tôt, qui condamnait tous les délinquants à la peine capitale. Ici, Stallone incarne un criminel à visage humain. Lock up démontre l'importance des valeurs humaines en prison et s'oppose formellement à la peine de mort. Evidemment, Haute sécurité reste un film d'action très viril, bourré de clichés et d'invraisemblances. Ne vous attendez pas à pouvoir le ranger entre le Trou de Jacques Becker et Midnight Express d'Alan Parker ! Un divertissement sans prétention mais très efficace, avec un message positif et un rythme soutenu.
Tango et Cash - 1988
 L'année 1988 sonne comme une remontée de pente pour Stallone. Après l'intéressant Haute Sécurité, Stallone s'essaye au buddy-movie et lance par la même occasion les premiers jalons visant à changer son image, Tango et Cash annonçant à quelques égards sa filmographie des années 90. Le scénario est rabâché -Tango et Cash, deux flics que tout oppose, vont nettoyer la ville- et le film sert sans surprise son cocktail d'humour viril et de fusillades. Néanmoins, Tango et Cash révèle une petite surprise : arborant de fines lunettes et un minuscule pistolet, Stallone laisse en effet sa place de dur à cuir expéditif à Kurt Russell, autre gueule mal employée du cinéma. Massif dans son costard, Stallone semble prendre plaisir à cette nouvelle aventure et, bien dirigé, mène honorablement son pas de deux dans ce film remuant et peuplé de tronches comme Jack Palance, Robert Z'Dar ou Brion James. De la frime -le début !-, des punchlines -la prison !!-, de l'outrance typiquement 80's -la botte de Kurt Russel !!!-, Tango et Cash ressemble à un Flic ou Zombie sans zombies. Autant dire que c'est bien bon. Retour à des rôles plus écrits, Tango et Cash permet à Sly de tourner définitivement la page des canonneries et, si l'on atteint pas encore le niveau de Rambo, de quitter les années 80 la tête plus haute que dans Bras de Fer.
L'année 1988 sonne comme une remontée de pente pour Stallone. Après l'intéressant Haute Sécurité, Stallone s'essaye au buddy-movie et lance par la même occasion les premiers jalons visant à changer son image, Tango et Cash annonçant à quelques égards sa filmographie des années 90. Le scénario est rabâché -Tango et Cash, deux flics que tout oppose, vont nettoyer la ville- et le film sert sans surprise son cocktail d'humour viril et de fusillades. Néanmoins, Tango et Cash révèle une petite surprise : arborant de fines lunettes et un minuscule pistolet, Stallone laisse en effet sa place de dur à cuir expéditif à Kurt Russell, autre gueule mal employée du cinéma. Massif dans son costard, Stallone semble prendre plaisir à cette nouvelle aventure et, bien dirigé, mène honorablement son pas de deux dans ce film remuant et peuplé de tronches comme Jack Palance, Robert Z'Dar ou Brion James. De la frime -le début !-, des punchlines -la prison !!-, de l'outrance typiquement 80's -la botte de Kurt Russel !!!-, Tango et Cash ressemble à un Flic ou Zombie sans zombies. Autant dire que c'est bien bon. Retour à des rôles plus écrits, Tango et Cash permet à Sly de tourner définitivement la page des canonneries et, si l'on atteint pas encore le niveau de Rambo, de quitter les années 80 la tête plus haute que dans Bras de Fer.
Rocky V - 1990
 Rocky IV a été un énorme succès au box office avec 128 millions de dollars de recette aux Etats-Unis et 300 millions dans le monde entier. Toutefois, le personnage de Rocky a vraiment perdu en crédibilité depuis. Ce que devient le personnage est décevant d'après la plupart des fans de la première heure. Rocky n'est plus un prolo mais une superstar. Pour ce cinquième opus, Stallone décide de revenir aux sources. De manière très peu crédible, Rocky perd tout son argent sur une bourde de Paulie. Il retourne dans sa vieille maison du quartier pauvre de Philadelphie, retrouve ses mitaines et son chapeau. Autre symbole de ce retour à 1976, le come-back de John G. Avildsen à la réalisation. Comme à l'accoutumée, un Rocky commence là où le précédent s'est arrêté. C'est donc juste après le combat contre Drago que nous retrouvons Balboa. Signalons qu'entre la fin de Rocky IV et le début de Rocky V, le fils de Balboa, Robert (interprété par Sage Stallone, le fils de Sly), passe de six à douze ans. Une croissance fulgurante ! Plus sérieusement, pour ce cinquième opus, Rocky prend un coup de jeune. La bande originale du film joue sur le hip hop et Balboa, trop vieux et accidenté pour reprendre les gants, devient le coach de Tommy Gunn, un jeune boxeur en devenir. Si le film s'est voulu ancré dans la mouvance du début des années quatre-vingt-dix (musique, vêtements), il n'en a que plus vieilli par la suite. Ce cinquième épisode est plus mièvre que les précédents, il insiste sur la relation père/fils avec presque autant de "bons sentiments" qu'Over the top. Un film très moyen donc, qui réalise de très faibles recettes en comparaison de celles amassées pour les précédents Rocky. 40 millions de bénéfice pour Rocky V, loin derrière Rocky II qui atteignait les 85 millions (dans la limite des Etats-Unis). Le deuxième et le cinquième épisode sont les deux seuls à se placer sous la barre des cent millions. A noter aussi que Stallone a pensé faire mourir Rocky à la fin de ce cinquième opus, juste après la bagarre de rue finale opposant Balboa à Gunn. L'acteur-scénariste s'est repenti en constatant à quel point Rocky était devenu un icône aux Etats-Unis et dans le monde. « Le scénario de Rocky V, que j'avais accepté de diriger, était génial, témoigne Avildsen. Rocky mourrait durant le dénouement qui était très émouvant, tragique, mais aussi plein d'espoir. Cela me touchait beaucoup et j'étais certain de réaliser un bon film. Stallone ne voulait plus reprendre le rôle ; c'était une manière de terminer la série. Je suppose que le final a changé quand le studio s'est trouvé dans une mauvaise passe financière. Et ses responsables ne voulaient pas tuer la poule aux oeufs d'or. James Bond ne meurt jamais : on prend juste un autre comédien. J'imagine que les producteurs pensent que l'on peut agir de la même façon avec Rocky qu'avec James Bond ».
Rocky IV a été un énorme succès au box office avec 128 millions de dollars de recette aux Etats-Unis et 300 millions dans le monde entier. Toutefois, le personnage de Rocky a vraiment perdu en crédibilité depuis. Ce que devient le personnage est décevant d'après la plupart des fans de la première heure. Rocky n'est plus un prolo mais une superstar. Pour ce cinquième opus, Stallone décide de revenir aux sources. De manière très peu crédible, Rocky perd tout son argent sur une bourde de Paulie. Il retourne dans sa vieille maison du quartier pauvre de Philadelphie, retrouve ses mitaines et son chapeau. Autre symbole de ce retour à 1976, le come-back de John G. Avildsen à la réalisation. Comme à l'accoutumée, un Rocky commence là où le précédent s'est arrêté. C'est donc juste après le combat contre Drago que nous retrouvons Balboa. Signalons qu'entre la fin de Rocky IV et le début de Rocky V, le fils de Balboa, Robert (interprété par Sage Stallone, le fils de Sly), passe de six à douze ans. Une croissance fulgurante ! Plus sérieusement, pour ce cinquième opus, Rocky prend un coup de jeune. La bande originale du film joue sur le hip hop et Balboa, trop vieux et accidenté pour reprendre les gants, devient le coach de Tommy Gunn, un jeune boxeur en devenir. Si le film s'est voulu ancré dans la mouvance du début des années quatre-vingt-dix (musique, vêtements), il n'en a que plus vieilli par la suite. Ce cinquième épisode est plus mièvre que les précédents, il insiste sur la relation père/fils avec presque autant de "bons sentiments" qu'Over the top. Un film très moyen donc, qui réalise de très faibles recettes en comparaison de celles amassées pour les précédents Rocky. 40 millions de bénéfice pour Rocky V, loin derrière Rocky II qui atteignait les 85 millions (dans la limite des Etats-Unis). Le deuxième et le cinquième épisode sont les deux seuls à se placer sous la barre des cent millions. A noter aussi que Stallone a pensé faire mourir Rocky à la fin de ce cinquième opus, juste après la bagarre de rue finale opposant Balboa à Gunn. L'acteur-scénariste s'est repenti en constatant à quel point Rocky était devenu un icône aux Etats-Unis et dans le monde. « Le scénario de Rocky V, que j'avais accepté de diriger, était génial, témoigne Avildsen. Rocky mourrait durant le dénouement qui était très émouvant, tragique, mais aussi plein d'espoir. Cela me touchait beaucoup et j'étais certain de réaliser un bon film. Stallone ne voulait plus reprendre le rôle ; c'était une manière de terminer la série. Je suppose que le final a changé quand le studio s'est trouvé dans une mauvaise passe financière. Et ses responsables ne voulaient pas tuer la poule aux oeufs d'or. James Bond ne meurt jamais : on prend juste un autre comédien. J'imagine que les producteurs pensent que l'on peut agir de la même façon avec Rocky qu'avec James Bond ».
L'embrouille est dans le sac (Oscar) - 1991
 La dernière (et première) véritable comédie de Stallone remonte à 1984. Sept ans plus tard, notre acteur réinvestit le genre avec cette reprise américaine d'Oscar, le film français d'Edouard Molinaro avec Louis De Funès. Sylvester Stallone reprenant un rôle joué par De Funès, inutile de dire que ça vaut le détour. L'embrouille est dans le sac est une comédie pure, très théâtrale, se déroulant du début à la fin dans la richissime demeure d'Angelo "Snaps" Provolone. Stallone incarne ce dernier, qui promet sur le lit de mort de son père (interprété par Kirk Douglas !) d'arrêter là ses magouilles de gangster et de commencer une nouvelle vie d'honnête homme. Le film est signé John Landis (The Blues brothers, Beverly Hills Cop III) et donne dans l'humour de la première à la dernière seconde. Un humour comme on l'a dit très classique, reprenant les éléments traditionnels de la farce. Des quiproquos, malentendus et retournements de situation à profusion, un jeu d'échange avec de multiples sacoches, des regards caméra, du comique de geste, de mots, de situation... Bref, un cinéma ultra théâtral. S'en étonnera-t-on ? Le film d'Oscar de Molinaro repris ici par Landis est lui-même une adaptation d'une pièce de théâtre de Claude Magnier. Rien de proprement révolutionnaire sur ce film, vous l'aurez compris. Stallone s'applique à créer des jeux de regard, un parler et une gestuelle humoristiques mais ses efforts ne l'empêchent pas d'être une énième fois nominé aux Razzies dans la catégorie pire acteur. Heureusement pour lui, cette année là, Kevin Costner et son Robin Hood sont passés par là.
La dernière (et première) véritable comédie de Stallone remonte à 1984. Sept ans plus tard, notre acteur réinvestit le genre avec cette reprise américaine d'Oscar, le film français d'Edouard Molinaro avec Louis De Funès. Sylvester Stallone reprenant un rôle joué par De Funès, inutile de dire que ça vaut le détour. L'embrouille est dans le sac est une comédie pure, très théâtrale, se déroulant du début à la fin dans la richissime demeure d'Angelo "Snaps" Provolone. Stallone incarne ce dernier, qui promet sur le lit de mort de son père (interprété par Kirk Douglas !) d'arrêter là ses magouilles de gangster et de commencer une nouvelle vie d'honnête homme. Le film est signé John Landis (The Blues brothers, Beverly Hills Cop III) et donne dans l'humour de la première à la dernière seconde. Un humour comme on l'a dit très classique, reprenant les éléments traditionnels de la farce. Des quiproquos, malentendus et retournements de situation à profusion, un jeu d'échange avec de multiples sacoches, des regards caméra, du comique de geste, de mots, de situation... Bref, un cinéma ultra théâtral. S'en étonnera-t-on ? Le film d'Oscar de Molinaro repris ici par Landis est lui-même une adaptation d'une pièce de théâtre de Claude Magnier. Rien de proprement révolutionnaire sur ce film, vous l'aurez compris. Stallone s'applique à créer des jeux de regard, un parler et une gestuelle humoristiques mais ses efforts ne l'empêchent pas d'être une énième fois nominé aux Razzies dans la catégorie pire acteur. Heureusement pour lui, cette année là, Kevin Costner et son Robin Hood sont passés par là.
Stop ! Or my mom will shoot (Arrête ! Ou ma mère va tirer !) - 1992
 Sur la lancée d'Oscar (1991), Stallone continue d'investir la comédie avec le très léger Stop ! Or my mom will shoot. Une plaisanterie hollywoodienne tout ce qu'il y a de plus bateau. L'histoire est celle du sergent Joe Bomosky, qui mène une petite vie de flic tranquille jusqu'au jour où sa mère, ultra protectrice, envahissante et naïve, débarque. La vieille dame ridiculise le sergent dans son quotidien en montrant à tout le monde les photos de son amour de fils en pampers. Le film mise beaucoup sur l'effet comique provoqué par la distorsion entre Sylvester Stallone, qui n'a déjà plus rien à prouver en tant qu'action man et Estelle Getty, il est vrai très appropriée dans ce rôle de petite vieille impossible à vivre. Aucun cliché ne vous sera épargné. Vous aurez droit à l'inévitable histoire d'amour contenue par le trop plein de virilité de notre héros, aux balles qui glissent sur le corps des personnages ainsi qu'à la course poursuite urbaine en voiture. Coté personnages, Stop ! Or my mom will shoot propose une belle brochette de "méchants" : les délinquants demeurés et obèses, les "méchants vraiment méchants", prêts à tuer pour arriver à leurs fins, mais aussi, ne l'oublions pas, l'incontournable collègue de bureau pincé et chieur. Le scénario est plutôt vague et sans réel fil conducteur. On assiste à une succession de scènes comiques et d'action. Les moments d'humour sont grassement accompagnés par la musique clownesque de Alan Silvestri, brillant dans ses compositions pour Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump...) mais ayant tout de même travaillé sur pas mal de nanars de prestige (Super Mario Bros, Sidekicks). Bref, une comédie légère, comme il y en a eu des millions et, malheureusement, comme on en fait encore aujourd'hui. Stop ! Or my mom will shoot figure tout de même parmi les plus prestigieux navets, ayant été récompensés aux Razzies par trois prix (pires acteur et actrice, pire scénario). Ceux qui ont à supporter une maman poule ne pourront toutefois pas s'empêcher de rire ou de sourire à la vue de quelques scènes.
Sur la lancée d'Oscar (1991), Stallone continue d'investir la comédie avec le très léger Stop ! Or my mom will shoot. Une plaisanterie hollywoodienne tout ce qu'il y a de plus bateau. L'histoire est celle du sergent Joe Bomosky, qui mène une petite vie de flic tranquille jusqu'au jour où sa mère, ultra protectrice, envahissante et naïve, débarque. La vieille dame ridiculise le sergent dans son quotidien en montrant à tout le monde les photos de son amour de fils en pampers. Le film mise beaucoup sur l'effet comique provoqué par la distorsion entre Sylvester Stallone, qui n'a déjà plus rien à prouver en tant qu'action man et Estelle Getty, il est vrai très appropriée dans ce rôle de petite vieille impossible à vivre. Aucun cliché ne vous sera épargné. Vous aurez droit à l'inévitable histoire d'amour contenue par le trop plein de virilité de notre héros, aux balles qui glissent sur le corps des personnages ainsi qu'à la course poursuite urbaine en voiture. Coté personnages, Stop ! Or my mom will shoot propose une belle brochette de "méchants" : les délinquants demeurés et obèses, les "méchants vraiment méchants", prêts à tuer pour arriver à leurs fins, mais aussi, ne l'oublions pas, l'incontournable collègue de bureau pincé et chieur. Le scénario est plutôt vague et sans réel fil conducteur. On assiste à une succession de scènes comiques et d'action. Les moments d'humour sont grassement accompagnés par la musique clownesque de Alan Silvestri, brillant dans ses compositions pour Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump...) mais ayant tout de même travaillé sur pas mal de nanars de prestige (Super Mario Bros, Sidekicks). Bref, une comédie légère, comme il y en a eu des millions et, malheureusement, comme on en fait encore aujourd'hui. Stop ! Or my mom will shoot figure tout de même parmi les plus prestigieux navets, ayant été récompensés aux Razzies par trois prix (pires acteur et actrice, pire scénario). Ceux qui ont à supporter une maman poule ne pourront toutefois pas s'empêcher de rire ou de sourire à la vue de quelques scènes.
Cliffhanger - 1993
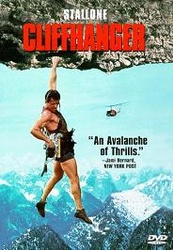
Après Bruce Willis dans la neige, Stallone dans la neige ! Le moins que l'on puisse dire est que le Viking Renny Harlin a de la suite dans les idées, à moins que ce ne soit sa nature nordique qui reprenne le dessus. Débarqué dans l'action hollywoodienne avec 58 Minutes pour vivre, deuxième volet de la trilogie Die Hard où il impose sa patte, Harlin s'attelle à cette histoire de sauveteur en prise avec une bande de gangsters. A priori, dans son schéma, rien ne sépare Cliffhanger d'un bon vieux Steven Seagal des familles. Pourtant, Renny Harlin parvient une fois de plus à hisser cette série B au dessus du tout venant, par une certaine générosité, une propension au sadisme et bien sûr, une violence aussi fun que plus explicite que la moyenne. Situé quasi-intégralement en décor montagnard, Cliffhanger enchaîne les moments de bravoure entre coups de pétoire, hélicoptères qui explosent et crapahutages d'un Stallone escaladant parois sur parois. Avec ses problèmes de scénario réglés à coup de piolet, son humour épais et sa scène d'introduction si marquante qu'elle sera parodiée dans un Ace Ventura, Cliffhanger s'impose comme un film d'action simpliste mais d'une efficacité peu commune, bénéficiant en outre d'un cadre original exploité pleinement : glace, précipice, tempête... tout un programme ! Dans le rôle du méchant patibulaire, impitoyable et sadique, on retrouve le très efficace faciès renfrogné de John Lithgow, qui nous décoche quelques mémorables répliques : « un homme qui tue un autre homme est un assassin, celui qui en tue des millions est un conquérant » (celle-là, les scénaristes l'ont pioché dans le dictionnaire des citations), « Tu voudrais bien me tuer, hein Tucker ? Alors prend un numéro et fais la queue ! » (celle-là est une authentique trouvaille, ça se sent). Dans le genre cliché, vous aurez aussi droit à la fabuleuse course au ralenti du héros criant un « noooonnnn » de désespoir face à l'ignominie assassine des méchants d'en face.
En T-shirt dans les intempéries, Stallone fait un énième numéro de sauveur aux gros muscles, le registre ne se prêtant que peu aux envolées dramatiques. Nouveau virage brusque dans la carrière de Stallone, Cliffhanger, aussi sympathique soit-il, témoigne de son échec à quitter le registre qui fit involontairement son succès. Sa reconversion en acteur comique n'aura d'ailleurs pas convaincu grand monde...
Cherchant plus que jamais à changer son image, Stallone enchaîne à partir de 1993 des rôles très différents, où, et c'est là la particularité d'une petite poignée d'entre eux, il partage l'écran des acteurs ayant un certain poids. Wesley Snipes (Demolition Man, donc), Sharon Stone et James Woods (L'Expert), Max Von Sydow et Jurgen Prochnow (Judge Dredd), Antonio Banderas (Assassins), tendance qui trouvera son paroxysme dans l'excellent Copland et son casting digne d'une fresque mafieuse. Terminé le temps du solitaire musculeux, le charisme de Stallone est désormais canalisé par de fortes présences et notre acteur devra composer avec le jeu de ses partenaires. Ce dont il s'accommodera parfaitement, Copland restant d'ailleurs pour beaucoup son meilleur rôle. Sans cet éclectisme et l'acceptation lucide de ne plus jouer les seules têtes d'affiche, la carrière de Stallone aurait sans aucun doute périclité bien plus tôt. Rappelons que le cinéma d'action américain des années 90 est très différent de celui des années 80, car marqué par la relative fin des héros-surhommes. Les années 90 sont une sorte de transition, où les gros bras tirent leurs dernières balles entre deux changements de registre -en cela, la filmographie de Schwarzenegger est éloquente : Terminator 2, Un Flic à la Maternelle, Last Action Hero, L'Effaceur...-. D'aucun diront que John Mc Tiernan en a plus ou moins sonné le glas en 1988, avec Piège de Cristal. Toujours est-il que le public et leurs repères ont changé, l'action devra composer avec cette nouvelle donne, quand elle ne subit pas l'influence et l'esthétisme du clip. Fair Games, en 1995, Hollywood Night de luxe d'une violence crasse, annonce d'ailleurs en bien des points les délires de McG et des années 2000. Ce sera sans doute là le seul point positif du film.
Demolition Man - 1993
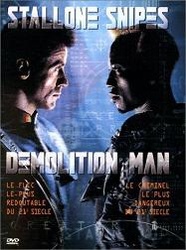
Revenons à nos moutons, ou pas, car Demolition Man, justement, témoigne bien de cette époque en porte-à-faux, jouant la carte de la SF intelligente entre deux gunfights. Dans un futur proche (1996... un peu d'indulgence que diable, nous ne sommes qu'en 1993), John Spartan, surnommé Demolition Man pour ses méthodes douces et subtiles, est sur le point d'arrêter le criminel Simon Phoenix. Dupé par celui-ci, Spartan provoque la mort d'otages au terme d'une gigantesque explosion. Incarcéré dans un cryo-pénitencier, il se retrouve réveillé plus tôt que prévu en 2032 : cryogénisé lui aussi, Phoenix a refait surface. Dans un monde de propreté et de sûreté où les jurons sont verbalisés, il n'y a que Spartan pour arrêter ce tueur d'un autre temps...
A la manière d'un Clint Eastwood du futur, Stallone campe ici un dinosaure, un homme téléporté brutalement dans une époque qui n'est pas la sienne et considéré comme on considère les peintures de Lascaux. Si l'aspect sombre de la thématique transparaît par petites touches (en 1996, Spartan avait une famille, une épidémie de MST est évoquée...), Demolition Man joue pourtant la carte du décalage et de l'humour, non sans oublier un certain cynisme. Le futur tel que le décrit Demolition Man est une sorte de dictature du bonheur, où tout est lisse, où les contacts sont évités au maximum, où la musique n'existe plus, remplacée par des spots radios abrutissants. Homme de terrain expéditif et vulgaire, Spartan se retrouve donc là, médusé, face à de la nourriture trop saine pour être honnête, à des détecteurs d'obscénités, savoureux running gag, ou encore aux fameux trois coquillages dont la nature nous échappe toujours. Et notre pauvre Sly n'est pas au bout de ses peines, lorsque, voulant mettre Sandra Bullock dans son lit, il se voit remettre un casque de réalité virtuelle... Avec sa société dorée mise à mal par les vestiges camouflés d'un passé -Simon Phoenix, mais aussi des laissés-pour-compte isolés dans les bas-fond-, il ne serait sans doute pas saugrenu de mettre Demolition Man dans une lignée proche de celle d'un Carpenter, d'autant que comme chez Big John, la forme suit le fond lorsque toute cette modernité immaculée vole en éclat sous les balles d'un actioner à l'ancienne, où Stallone et Snipes en décousent dans des fusillades démentes, punchlines à l'appui. Si Demolition Man n'est en aucun cas un pamphlet anarchiste, son ironie et son esprit revanchard en font un film de SF divertissant qui n'oublie pas de donner à réfléchir. Composant de façon jouissive avec le statut d'un Stallone beau joueur -comment oublier cette scène où l'ex-Rambo tricote un pull !-, Demolition Man est une réussite frondeuse et décomplexée, devenue avec le temps étrangement prémonitoire par la présence d'un certain Président Schwarzenegger...
L'Expert - 1994
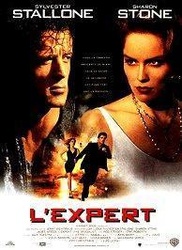
Retour en milieu urbain et en époque contemporaine pour Stallone. Sous la tutelle du futur réalisateur d'Anaconda, c'est dans la défroque d'un poseur de bombe que nous le retrouvons. A une époque où le thriller érotique redevenait tendance -la même année sortait Color of Night, avec Bruce Willis-, L'Expert joue tout naturellement la carte action/sexe et embauche de surcroît une Sharon Stone qui plus tôt tournait Basic Instinct et Sliver. Autant dire que l'on débarque en terrain connu, où la testostérone se mêlera à de lascives séances de nudité soft. Forcément, le résultat peine à convaincre. Non seulement il n'y a rien de franchement original là dedans, mais le film n'oublie pas de tomber dans le ridicule, au cours de scènes non-sensiques : une bombe dans une tasse à café, une bombe qui dit « bye bye », quand ce n'est pas notre terroriste qui défenestre un voyou d'un bus pour aider une vieille dame... Plutôt convainquant en artificier désabusé, Stallone est une fois de plus victime d'un scénario balourd. Passons la scène de douche Stallone/Stone qui ne restera pas vraiment dans les an(n)ales de l'érotisme et l'on obtient un produit léché et plus réchauffé que chaud. Allez hop, on remballe et on passe à autre chose.
Judge Dredd - 1995
 Le Batman de Tim Burton, sorti en 1989, ouvre la voie aux adaptations cinématographiques de comics. En 1995, Sylvester Stallone incarne Judge Dredd, un personnage célèbre de la bande dessinée britannique. Le film est un actioner futuriste très chargé en humour, dans la continuité de l'excellent Demolition Man. L'histoire se déroule dans un futur apocalyptique typiquement 90's, dans la lignée d'autres films comme Super Mario Bros, Starship Troopers ou le Cinquième élément. La population s'est réfugiée dans des mégalopoles où quelques hommes d'action maintiennent la loi et l'ordre. Ces "juges" ont le pouvoir d'arrêter, de questionner et de condamner. Sylvester Stallone est parfait dans ce rôle d'homme d'action-juriste inflexible et stoïque. Le haut du visage recouvert par un casque, il beugle du coin de la lèvre inférieure : « Je suis la loi ! ». Avec le même esprit que sur Demolition Man, Stallone donne dans l'autodérision. Judge Dredd fourmille de punch lines humoristiques et l'on retrouve les principaux ingrédients du film d'action : le grand méchant mégalo et sadique, le sidekick blagueur, la course-poursuite et quelques autres clichés encore plus forts comme la bagarre de filles, les révélations de dernier souffle du mourrant et le coup des engins qui refonctionnent lorsque l'on tape dessus. Le film a beaucoup déçu les adeptes du comics et a forcément donné du grain à moudre aux anti-Stallone : exit l'ultra-violence et l'implacable froideur fasciste de Judge Dredd. L'esprit du comics s'est envolé devant la machine à blanchir hollywoodienne. Moins audacieux que Demolition man donc, mais presque aussi divertissant. On notera un casting de bonne qualité : Max Von Sydow, Jurgen Prochnow, Rob Schneider et Diane Lane ainsi qu'une musique tambourinante tout à fait dans l'esprit actioner signée Alan Silvestri.
Le Batman de Tim Burton, sorti en 1989, ouvre la voie aux adaptations cinématographiques de comics. En 1995, Sylvester Stallone incarne Judge Dredd, un personnage célèbre de la bande dessinée britannique. Le film est un actioner futuriste très chargé en humour, dans la continuité de l'excellent Demolition Man. L'histoire se déroule dans un futur apocalyptique typiquement 90's, dans la lignée d'autres films comme Super Mario Bros, Starship Troopers ou le Cinquième élément. La population s'est réfugiée dans des mégalopoles où quelques hommes d'action maintiennent la loi et l'ordre. Ces "juges" ont le pouvoir d'arrêter, de questionner et de condamner. Sylvester Stallone est parfait dans ce rôle d'homme d'action-juriste inflexible et stoïque. Le haut du visage recouvert par un casque, il beugle du coin de la lèvre inférieure : « Je suis la loi ! ». Avec le même esprit que sur Demolition Man, Stallone donne dans l'autodérision. Judge Dredd fourmille de punch lines humoristiques et l'on retrouve les principaux ingrédients du film d'action : le grand méchant mégalo et sadique, le sidekick blagueur, la course-poursuite et quelques autres clichés encore plus forts comme la bagarre de filles, les révélations de dernier souffle du mourrant et le coup des engins qui refonctionnent lorsque l'on tape dessus. Le film a beaucoup déçu les adeptes du comics et a forcément donné du grain à moudre aux anti-Stallone : exit l'ultra-violence et l'implacable froideur fasciste de Judge Dredd. L'esprit du comics s'est envolé devant la machine à blanchir hollywoodienne. Moins audacieux que Demolition man donc, mais presque aussi divertissant. On notera un casting de bonne qualité : Max Von Sydow, Jurgen Prochnow, Rob Schneider et Diane Lane ainsi qu'une musique tambourinante tout à fait dans l'esprit actioner signée Alan Silvestri.
Assassins - 1995
 La passation de pouvoir, la jeunesse face à la sagesse... une thématique qui abreuva pléthore de films. Lorsque Richard Donner, en 1995, met en scène cette histoire de tueur à gage au bord de la retraite confronté à un assassin-chien fou, il joue avant tout avec un certain classicisme. Qu'importe, tant que la barque est bien menée. Si Assassins n'a pas très bien vieilli et supporte difficilement le revisionnage, il offre à Stallone un rôle sur mesure. A l'approche de la cinquantaine, l'acteur se glisse dans la peau de cet assassin sur le retour, n'attendant plus grand chose de la vie et menacé par la nouvelle garde, en la personne d'Antonio Banderas, qui l'adule autant qu'il voudrait le voir disparaître. Empruntant un peu au film d'espionnage, le film se construit comme un long jeu de l'oie et évite les grosses scènes d'action, s'appliquant à confronter deux personnalités. Lorgnant sur les traces de Mon Nom est Personne, clin d'oeil explicite à l'appui, Assassins n'atteint certes pas le niveau de l'excellent film de Tonino Valerii, mais nous ballade sur un rythme feutré et crée une osmose parfaite entre le jeu intérieur de Stallone et celui, plus expansif, de Banderas. Assumant son âge à l'écran, Stallone retrouve dans Assassins une classe et une justesse prouvant qu'il a tout d'un monstre sacré. De là à dire que sa période gros bras fut un incident de parcours, il n'y a qu'un pas...
La passation de pouvoir, la jeunesse face à la sagesse... une thématique qui abreuva pléthore de films. Lorsque Richard Donner, en 1995, met en scène cette histoire de tueur à gage au bord de la retraite confronté à un assassin-chien fou, il joue avant tout avec un certain classicisme. Qu'importe, tant que la barque est bien menée. Si Assassins n'a pas très bien vieilli et supporte difficilement le revisionnage, il offre à Stallone un rôle sur mesure. A l'approche de la cinquantaine, l'acteur se glisse dans la peau de cet assassin sur le retour, n'attendant plus grand chose de la vie et menacé par la nouvelle garde, en la personne d'Antonio Banderas, qui l'adule autant qu'il voudrait le voir disparaître. Empruntant un peu au film d'espionnage, le film se construit comme un long jeu de l'oie et évite les grosses scènes d'action, s'appliquant à confronter deux personnalités. Lorgnant sur les traces de Mon Nom est Personne, clin d'oeil explicite à l'appui, Assassins n'atteint certes pas le niveau de l'excellent film de Tonino Valerii, mais nous ballade sur un rythme feutré et crée une osmose parfaite entre le jeu intérieur de Stallone et celui, plus expansif, de Banderas. Assumant son âge à l'écran, Stallone retrouve dans Assassins une classe et une justesse prouvant qu'il a tout d'un monstre sacré. De là à dire que sa période gros bras fut un incident de parcours, il n'y a qu'un pas...
Daylight - 1996
 Daylight, la lumière du jour et pourtant, le début de la fin. Ce titre qu'on aurait pu croire prophétique pour Stallone sera pourtant l'un des derniers où le nom de la star a encore un certain poids. Quand en 1996 on va voir Daylight, on va voir "le dernier Stallone". On invite notre bon Sly sur les plateaux télé, la promo bat son plein, et votre serviteur a encore le souvenir ému de ce blouson estampillé "Daylight" qu'il était possible de gagner dans une émission de télé suisse. Une fameuse émission d'ailleurs, qui passait L'Enfer du Devoir et Les Contes de la Crypte en plein samedi après-midi, comme ça, à l'heure de la sieste. Et même si le blouson était hideux, ça n'en restait pas moins le blouson de Stallone dans le film. En 1996, Stallone est increvable, Stallone mesure trois mètres, Stallone fait trembler le sol lorsqu'il marche, quand Stallone mange des piments, ce sont les piments qui pleurent et l'on en oublierait presque qu'il y a autour un film de Rob Cohen, réalisateur du beau Coeur de Dragon. Ainsi, en dépit d'une volonté de plus en plus marquée pour Stallone de s'écarter des films "gros bras", Daylight est vendu et considéré comme un Sly de la grande époque, où notre musculeux aura la lourde tâche de sauver une poignée de survivants d'un tunnel ayant eu la fâcheuse idée d'exploser. Dur est le chemin du héros vers l'acteur, et cette volonté de s'affirmer dramatiquement aboutira au paradoxal Copland, sans nul doute une de ses meilleures performances pour un film qui ne sera plus "le dernier Stallone", mais le film d'un certain James Mangold avec plein de grands acteurs dedans. Revenons à notre tunnel. L'autre ressort promotionnel, si ce n'est artistique, est de renouer avec une tradition du film catastrophe, il est vrai un peu oubliée depuis les années 70. Si Daylight n'est pas L'Aventure du Poséidon, sa conception hybride entre le drame et l'action renvoie à ce pan de cinéma plein de pompiers intrépides, de belles phrases courageuses et de dangers à chaque pas. Dans la peau d'un sauveteur présent au mauvais endroit au mauvais moment, Stallone, plutôt en forme, grimpe, traverse, souffre et réconforte avec une conviction qui fait mouche, pendant que le scénariste prend un malin plaisir à mêler les éléments les moins compatibles pour mettre en péril l'échantillon humain prisonnier du tunnel de la mort. Echantillon où l'on retrouve Viggo Aragorn Mortensen et le fils de Sly lui-même, Sage Stallone dans la peau d'un jeune délinquant. Plutôt bien fait, parfaitement lacrymal et brassant son lot de clichés -on échappe tout de même à la femme enceinte-, Daylight nous emmène tranquillement d'un générique à l'autre le long d'un chemin de croix solide. On s'en estimera heureux, le genre catastrophe pouvant rapidement tomber dans le navet. Un film, pardon, "un Stallone" de solide facture donc, prouvant que notre intrépide préféré a malgré tout de beaux restes.
Daylight, la lumière du jour et pourtant, le début de la fin. Ce titre qu'on aurait pu croire prophétique pour Stallone sera pourtant l'un des derniers où le nom de la star a encore un certain poids. Quand en 1996 on va voir Daylight, on va voir "le dernier Stallone". On invite notre bon Sly sur les plateaux télé, la promo bat son plein, et votre serviteur a encore le souvenir ému de ce blouson estampillé "Daylight" qu'il était possible de gagner dans une émission de télé suisse. Une fameuse émission d'ailleurs, qui passait L'Enfer du Devoir et Les Contes de la Crypte en plein samedi après-midi, comme ça, à l'heure de la sieste. Et même si le blouson était hideux, ça n'en restait pas moins le blouson de Stallone dans le film. En 1996, Stallone est increvable, Stallone mesure trois mètres, Stallone fait trembler le sol lorsqu'il marche, quand Stallone mange des piments, ce sont les piments qui pleurent et l'on en oublierait presque qu'il y a autour un film de Rob Cohen, réalisateur du beau Coeur de Dragon. Ainsi, en dépit d'une volonté de plus en plus marquée pour Stallone de s'écarter des films "gros bras", Daylight est vendu et considéré comme un Sly de la grande époque, où notre musculeux aura la lourde tâche de sauver une poignée de survivants d'un tunnel ayant eu la fâcheuse idée d'exploser. Dur est le chemin du héros vers l'acteur, et cette volonté de s'affirmer dramatiquement aboutira au paradoxal Copland, sans nul doute une de ses meilleures performances pour un film qui ne sera plus "le dernier Stallone", mais le film d'un certain James Mangold avec plein de grands acteurs dedans. Revenons à notre tunnel. L'autre ressort promotionnel, si ce n'est artistique, est de renouer avec une tradition du film catastrophe, il est vrai un peu oubliée depuis les années 70. Si Daylight n'est pas L'Aventure du Poséidon, sa conception hybride entre le drame et l'action renvoie à ce pan de cinéma plein de pompiers intrépides, de belles phrases courageuses et de dangers à chaque pas. Dans la peau d'un sauveteur présent au mauvais endroit au mauvais moment, Stallone, plutôt en forme, grimpe, traverse, souffre et réconforte avec une conviction qui fait mouche, pendant que le scénariste prend un malin plaisir à mêler les éléments les moins compatibles pour mettre en péril l'échantillon humain prisonnier du tunnel de la mort. Echantillon où l'on retrouve Viggo Aragorn Mortensen et le fils de Sly lui-même, Sage Stallone dans la peau d'un jeune délinquant. Plutôt bien fait, parfaitement lacrymal et brassant son lot de clichés -on échappe tout de même à la femme enceinte-, Daylight nous emmène tranquillement d'un générique à l'autre le long d'un chemin de croix solide. On s'en estimera heureux, le genre catastrophe pouvant rapidement tomber dans le navet. Un film, pardon, "un Stallone" de solide facture donc, prouvant que notre intrépide préféré a malgré tout de beaux restes.
Copland - 1997

Copland60 000 dollars. C'est la somme que Stallone perçoit pour le tournage du film Copland, écrit et réalisé par James Mangold. Une somme bien en dessous des millions exigés par les acteurs de son envergure. Avec Copland, Sylvester Stallone veut relancer sa carrière, sur le déclin depuis déjà plusieurs années. Sly investit un rôle aux antipodes des clichés dans lesquels il s'est progressivement enfermé et se réaffirme, auprès de tous ceux l'ayant oublié, comme un très grand acteur. Copland raconte l'histoire d'un havre pour flics ripoux dans le New Jersey. Une petite enclave pavillonnaire peuplée de policiers corrompus et magouilleurs. Stallone incarne le shérif du coin : un faiblard bouffi, bedonnant et à moitié sourd, un mollasson sans envergure (il a pris une vingtaine de kilos pour le rôle). A ses côtés, on retrouve tout simplement les trois plus grands acteurs de la génération Scorsese (Mean Streets, Goodfellas) : Robert De Niro, Harvey Keitel et Ray Liotta. Remarquablement interprété, Copland est aussi une réussite scénaristique et de réalisation. James Mangold met en forme un récit policier très bien ficelé, fourni en suspense et en ambiance.
Copland marque la fin d'une époque. Une énorme performance d'acteur pour Sly, un retour en grâce avec ce rôle de composition... Mais cela ne suffit pas à relancer sa carrière. Jusqu'alors assez prolifique (un ou deux films par an), Sylvester Stallone se fait plus discret. Il met trois ans à revenir sur grand écran avec Get Carter, réenchaîne sur plusieurs échecs (Driven, Mafia love) avant de se faire encore plus fantomatique, au travers de seconds rôles ou brèves apparitions dans d'affreux navets (Taxi 3, Spy Kids 3D).
Get Carter - 2000
 Trois ans que l'on n'a plus vu Stallone sur grand écran. Après son rôle de composition dans Copland, Sly pouvait prétendre à un second départ. Get Carter devait être la confirmation. Stallone semble avoir définitivement déserté le terrain du film d'action calibré. Force est de constater que les années quatre-vingt sont définitivement révolues. Get Carter ne déborde pas d'explosions, de punchlines ni de grandes fusillades surréalistes. Le film ne donne pas dans l'excellence pour autant. Get Carter raconte l'histoire ultra-rabachée d'un "encaisseur", un gangster chargé par son patron de rafraîchir la mémoire à quelques payeurs oisifs, qui retrouve sa famille après plusieurs années d'absence pour venger la mort de son frère. Sylvester Stallone ne joue définitivement plus dans le même registre. Son jeu est beaucoup plus sobre, plus contenu. Exit les beuglements et le trop-plein de testostérone pour une ambiance plus polar et classieuse. Rien de révolutionnaire pour autant. Get Carter, remake d'un film de Mark Hodges de 1971, ennuie la critique pour son coté déjà-vu et connaît un succès très tiède au box office. Le film est réalisé de façon très maniérée. On croit déjà sentir l'influence de The Matrix avec cette troisième réalisation de Stephen Kay, ultra clipée, bourrée d'effets d'accélération et de coupure aussi désagréables que pompeuses.
Trois ans que l'on n'a plus vu Stallone sur grand écran. Après son rôle de composition dans Copland, Sly pouvait prétendre à un second départ. Get Carter devait être la confirmation. Stallone semble avoir définitivement déserté le terrain du film d'action calibré. Force est de constater que les années quatre-vingt sont définitivement révolues. Get Carter ne déborde pas d'explosions, de punchlines ni de grandes fusillades surréalistes. Le film ne donne pas dans l'excellence pour autant. Get Carter raconte l'histoire ultra-rabachée d'un "encaisseur", un gangster chargé par son patron de rafraîchir la mémoire à quelques payeurs oisifs, qui retrouve sa famille après plusieurs années d'absence pour venger la mort de son frère. Sylvester Stallone ne joue définitivement plus dans le même registre. Son jeu est beaucoup plus sobre, plus contenu. Exit les beuglements et le trop-plein de testostérone pour une ambiance plus polar et classieuse. Rien de révolutionnaire pour autant. Get Carter, remake d'un film de Mark Hodges de 1971, ennuie la critique pour son coté déjà-vu et connaît un succès très tiède au box office. Le film est réalisé de façon très maniérée. On croit déjà sentir l'influence de The Matrix avec cette troisième réalisation de Stephen Kay, ultra clipée, bourrée d'effets d'accélération et de coupure aussi désagréables que pompeuses.
Driven - 2001

DrivenGet Carter s'est peut-être cassé la figure au box office mais le film n'a pas entaché la "nouvelle image" de Sly. Après Copland et Get Carter, films dans lesquels Stallone s'est montré plus fort en gueule qu'en muscles, notre acteur se fourvoie à nouveau dans un nanar sportif de la pire espèce : Driven, un film de pilotes automobiles misant sur la romance, les effets de la gloire et quelques scènes aussi spectaculaires que ridiculement improbables. Dans Driven, Stallone incarne Joe Tanto, un pilote couillu mais qui est passé à côté de sa carrière. L'homme est rappelé par son ancien mentor pour servir de coach à un tout jeune pilote, encore juvénile, Jimmy Bly, qui doit faire face à un principal concurrent pour le titre de champion du monde : Beau Brandenburg. Tout, dans ce film, est d'une hilarante nullité. Commençons par le casting, constitué de mannequins plus que par des acteurs. Beaux et belles gosses à tous les étages, muscles saillants, luxe, petites mèches rebelles... La palme revient sans aucun doute à Estella Warren, très à l'aise dans son rôle de potiche, qui impressionne autant par sa beauté que par son absence de talent en matière de comédie. Parmi les scènes les plus débiles du film, on retiendra un Stallone qui marmonne au volant de sa formule un en ramassant des pièces de monnaie disséminées sur le circuit avec les pneus arrières de son bolide, mais aussi une ravissante course automobile en plein centre ville. Il faut aussi rajouter à cela des accidents défiant les lois de la pesanteur, surchargés en effets spéciaux prétentieux réalisés de façon minable à l'infographie, comme pour un vieux jeu vidéo. Comme si cela ne suffisait pas, viennent s'ajouter à cette base déjà catastrophique une BO tambourinante, excessive et déjà ringarde et une avalanche d'absurdités en tout genre. Les courses s'organisent de part le monde et on a droit à des clichés d'ampleur internationale. On compte une centaine de décolletés plongeants et de minijupes, la femme est utilisée dans ce film comme un élément décoratif. Estella Warren incarne bien cet état de fait : elle n'est pas un personnage pensant mais un espèce de gain que se disputent deux grands pilotes. Driven nous rappelle Rocky IV, autre grande figure du nanar sportif. Héroïsme ridicule, maniérisme, mièvreries, fierté virile, mais aussi un sens du montage excessif : ralentis indénombrables, flash back et autres effets qui insistent grossièrement sur les rapports entre personnages. Mais reconcentrons nous sur Sylvester Stallone. Avec Driven, Sly joue les grands sages, les vétérans. Il n'est plus celui par qui tout arrive mais son discours est bien le même qu'il y a presque trente ans : « Pour moi la volonté dépasse le talent » lance-t-il du bout des lèvres. En jouant dans Driven, Stallone accepte un rôle qui illustre une passation de pouvoir très symbolique. Les vieillissants doivent laisser leur place aux nouveaux venus, puis s'effacer.
D-Tox - 2002
 Stallone dans un film d'horreur ? Vieux fantasme ou prévision de catastrophe intégrale, le postulat ne laisse pas indifférent. Vendu comme un slasher à la Souviens toi d'Urban Legend 12, traduit en français d'un inénarrable Compte à Rebours Mortel, D-Tox est avant tout une sorte de thriller à huis-clos, où Sly se glisse dans la peau d'un flic alcoolique et instable suite à la mort de sa femme, écorchée salement par un maniaque insaisissable. Participant à un programme de désintoxication (d'où D-Tox) censé le sortir de la bouteille et des idées noires, une vague de suicides le poussera à croire que sa Némésis ne l'a pas oublié. Jim Gillepsie, réalisateur qui connaît ses classiques, cite Argento et The Thing, tout en entourant Stallone de seconds-rôles à "gueules", canalisant ainsi son faciès de montagne dynamitée. Il faut avouer que jusqu'à son dernier acte, D-Tox tient la route. Si l'on oublie quelques effets de flash-back façon Seven du pauvre et une impression générale de déjà-vu, le film révèle des scènes d'actions tendues, un suspens bien dosé et une trame assez originale. Quel dommage que cette belle pièce montée se prenne les pieds dans le tapis, bâclant complètement la dernière bobine, avec une fin musclée qui jure avec l'étrangeté sombre de l'intrigue. Qu'importe, le samedi-soir est comblé. En homme brisé, Stallone a décidément de beaux restes. En face, Robert Patrick cabotine pour donner le change, Tom Berenger crispe ses plus belles mâchoires et Kris Kristofferson, peinard, s'assied dans le fauteuil de la force tranquille. Tout ceci aurait pu être mieux mais aussi bien pire.
Stallone dans un film d'horreur ? Vieux fantasme ou prévision de catastrophe intégrale, le postulat ne laisse pas indifférent. Vendu comme un slasher à la Souviens toi d'Urban Legend 12, traduit en français d'un inénarrable Compte à Rebours Mortel, D-Tox est avant tout une sorte de thriller à huis-clos, où Sly se glisse dans la peau d'un flic alcoolique et instable suite à la mort de sa femme, écorchée salement par un maniaque insaisissable. Participant à un programme de désintoxication (d'où D-Tox) censé le sortir de la bouteille et des idées noires, une vague de suicides le poussera à croire que sa Némésis ne l'a pas oublié. Jim Gillepsie, réalisateur qui connaît ses classiques, cite Argento et The Thing, tout en entourant Stallone de seconds-rôles à "gueules", canalisant ainsi son faciès de montagne dynamitée. Il faut avouer que jusqu'à son dernier acte, D-Tox tient la route. Si l'on oublie quelques effets de flash-back façon Seven du pauvre et une impression générale de déjà-vu, le film révèle des scènes d'actions tendues, un suspens bien dosé et une trame assez originale. Quel dommage que cette belle pièce montée se prenne les pieds dans le tapis, bâclant complètement la dernière bobine, avec une fin musclée qui jure avec l'étrangeté sombre de l'intrigue. Qu'importe, le samedi-soir est comblé. En homme brisé, Stallone a décidément de beaux restes. En face, Robert Patrick cabotine pour donner le change, Tom Berenger crispe ses plus belles mâchoires et Kris Kristofferson, peinard, s'assied dans le fauteuil de la force tranquille. Tout ceci aurait pu être mieux mais aussi bien pire.
Mafia Love - 2002
 Dans la catégorie "le film est pas terrible, mais Stallone est très bien", Mafia Love se pose là. Sorte de comédie dramatico-sentimentale mafieuse, Mafia Love est une belle salade russe : Angelo (Anthony Quinn), parrain vieillissant, confie à Francky (Stallone), son garde du corps, la protection de son enfant unique, Jennifer, qui elle-même ignore tout de son pedigree. Angelo assassiné, Jennifer deviendra du jour au lendemain la cible d'un parrain rival, tout en tentant de cohabiter avec cet homme de main pour qui elle construira une relation insoupçonnée.
Dans la catégorie "le film est pas terrible, mais Stallone est très bien", Mafia Love se pose là. Sorte de comédie dramatico-sentimentale mafieuse, Mafia Love est une belle salade russe : Angelo (Anthony Quinn), parrain vieillissant, confie à Francky (Stallone), son garde du corps, la protection de son enfant unique, Jennifer, qui elle-même ignore tout de son pedigree. Angelo assassiné, Jennifer deviendra du jour au lendemain la cible d'un parrain rival, tout en tentant de cohabiter avec cet homme de main pour qui elle construira une relation insoupçonnée.
Mafia Love est avant toute chose le dernier film d'Anthony Quinn, qui décédera peu après. Forcement, le meurtre d'Angelo et l'enterrement de celui-ci prennent aujourd'hui une résonance étrange. Cette prémonition macabre mise à part, Mafia Love n'est jamais qu'un tout petit film, presque entièrement porté par un Stallone livrant une belle performance d'acteur. Son duo avec Anthony Quinn restera sans doute un des plus beau moment de sa filmographie tant le plaisir des deux comédiens à cohabiter est visible.
Film posé et un tantinet nostalgique, on ne retiendra pourtant de Mafia Love que quelques gags (dont un strip tease torride au point de provoquer une crise cardiaque), un joli final sous le soleil sicilien et l'incroyable vision d'un Stallone jouant au cuisinier aguerri. Non, pas comme Steven Seagal, un VRAI cuisinier. Mafia Love est une aussi une sorte de révélation, celle que Sly avait somme toute pas mal d'atouts pour réussir dans le film de gangster, dans le genre porte-flingue à la Luca Brazzi. Ce sera dans une autre vie...
Les Maîtres du Jeu - 2003

Parmi tous les métiers qu'a interprété Stallone à l'écran, le joueur professionnel relève de l'inédit. Tout comme le torero d'ailleurs. Prenez note, messieurs-dames les producteurs. Avec Les Maîtres du Jeu, Sly revient au second plan. Si son rôle est essentiel pour l'intrigue, ses apparitions à l'écran se font rares, au profit de Gabriel Byrne, Thandie Newton et Stuart Towsend. Premier film du nouveau venu Damian Neeman, Les Maîtres du Jeu nous fait suivre les combines d'un trio de tricheurs tentant de plumer une légende vivante du poker (Stallone, donc), seul survivant d'une partie mythique qui trente ans plus tôt dégénéra en fusillade. Tables de jeux tamisées, costards, numéros de frime, cartes battues avec adresse, liasses de dollars, coups de Trafalgar rondement menés... Les Maîtres du Jeu est un film qui la joue grand-seigneur. Si sur le papier, le sujet n'a pas de quoi enjouer les foules, le résultat à l'écran se révèle loin d'être inintéressant. Mieux vaut cependant connaître un minimum le poker et les parties de carte pour apprécier pleinement le film, qui apparaît rapidement comme une sorte de concours de triche et de grosses mises. Avec son scénario à tiroirs où tout le monde se poignarde dans le dos, son aspect clinquant et désuet, sans oublier cette incroyable scène où un dragueur se fait voler un rein en croyant participer à un jeu sado-maso, Les Maîtres du Jeu se regarde tranquillement, au rythme des jetons et de la fumée de cigare. Souriant dans son costume, Stallone fait le minimum syndical, il est vrai peu encouragé par une histoire ne lui demandant qu'à rester assis à regarder des cartes. Mais même lorsqu'il reste assis à regarder ses cartes, Stallone reste Stallone. Ça ne s'explique pas. Incroyable comme les grands acteurs peuvent paraître grands lorsqu'ils sont payés à rien faire. Pour son visiblement premier essai, on pardonnera à Damian Neeman d'échouer à transformer son film en une sorte de microcosme où les cartes seraient une métaphore de la vie, note d'intention dévoilée dès l'introduction. Plus préjudiciables sont cependant ce mafieux efféminé vite énervant, ou le choix de Thandie Newton, qui à l'aise face à Tom Cruise (MI2) se fait ici bouffer par tout le reste du casting. Pour sa part, Melanie Griffith s'en sort autrement mieux, formant avec Stallone un couple gentiment glamour. Old School et racé, Les Maîtres du Jeu fait oublier ses défauts et se déguste agréablement.
The Contender

Stallone dans une real TV ? Blasphème ! Hérésie ! Qu'on se rassure -quoique-, ce n'est pas dans the Contender que Sly va manger des vers de terre pour gagner un fétiche moche. Dans cette sorte de Popstar version boxe, Stallone joue les Benjamin Castaldi et assure les moments forts de l'apprentissage de boxeurs en herbe. Doute, émotion, larme, rage, tensions internes, dépassent de soi, rien ne manque à cette émission à la réalisation très léchée survolée par les violons d'Hans Zimmer. Hollywoodien jusqu'à l'outrance, The Contender fait bien sur tout pour nous rappeler un certain Rocky. Dommage que ce Show -appelons les choses comme elles le sont- soit trop monté/réalisé/coupé pour convaincre totalement. Les fans de Sly eux-mêmes n'y trouveront pas leur compte, ses apparitions étant anecdotique.
Sylvester Stallone, une icône, pour le meilleur et pour le pire

Sly dans le premier RamboAvec Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone est la figure emblématique du film d'action, le tout dernier genre cinématographique en date, héritier du western ou du polar -voire du film de guerre-, dont on peut estimer la naissance et l'émergence dans les années quatre vingt.
Très rapidement, le film d'action s'est affirmé comme brut de décoffrage, manichéen voire propagandiste. Le genre a symbolisé l'idéologie américaine dans tout ce qu'elle a de caricaturale : culte de la force et de la puissance, défense de valeurs et morales réactionnaires voire droitières. Sylvester Stallone a très rapidement incarné cet esprit et son image en est encore imbibé aujourd'hui. Des prouesses musclées et surhumaine, un culte de la victoire, de la persévérance et une haine farouche envers ceux désignés comme des ennemis. D'abord représentant du petit peuple, Stallone est rapidement devenu le symbole de la gloire et de la réussite, voire même parfois un instrument de propagande (Rambo II et III). Ainsi stigmatisé, Sly a vu se fermer devant lui les portes de la reconnaissance publique et artistique. Cette image lui a collé à la peau à un point que les Guignols, l'émission satyrique et marionnettiste française bien connue, a choisi son visage pour incarner la "World Company" : le capitalisme sauvage et le contrôle des masses (« Tu vas l'avoir ta putain d'guerre ! »). Stallone, caricaturé en France, n'est pas forcément plus respecté dans son pays. Les Razzies états-uniens, récompensant chaque année les pires films, réalisateurs et acteurs de l'année, sur le contre-modèle des Oscars, ont décerné à de nombreuses reprises la "récompense" du pire acteur à Stallone. Il est d'ailleurs le record man des Razzies, avec trente nominations pour dix prix reçus. Même s'il a joué dans beaucoup de nanars, l'acteur n'est pas à considérer comme un Chuck Norris, un Jean-Claude Van Damme ou un Steven Seagal. Il a prouvé, à de nombreuses reprises, ses qualités d'acteur et de scénariste. Stallone est en fait passé à côté de sa carrière, n'ayant su se défaire de son image de gros bras beuglard au profit de rôles plus diversifiés. A défaut, il a su à de nombreuses reprises jouer de son image.
Grandeur et décadence

Construire son corps tout en développant une carrière plus intellectuelle était-il incompatible avec les années 80 ? Entre deux rôles musclés, le réalisateur et scénariste Stallone a pourtant construit une oeuvre plus subtile que ne le laissaient supposer ses gros bras. A bien regarder, le plus gros problème de Sly, outre ses choix de carrière douteux, est d'avoir incarné sciemment le rêve américain sans pour autant réussir à en imposer sa vision. Une vision de son pays individualiste, revancharde, où rien n'est acquis pour qui ne s'en donne pas les moyens, fut-ce par la force des poings. Stallone aime son pays, mais sait parfaitement que l'on peut y perdre son statut plus vite que l'on a réussi à le construire. La filmographie de la star, bien qu'un peu schizophrénique, parle d'elle même, de Rocky -saga passant de la gloire à la remise en question- à ses derniers films -traitants du passage de témoin, d'une époque révolue et d'une place à conserver- en passant par Rambo -ce héros du Viet Nam dont personne ne veut plus après usage-. A côté de cela, Sly a incarné, peut être le premier, ce cinéma simpliste entièrement voué à un héros bodybuildé, ouvrant la voie aux Schwarzenegger, Dolph Lundgren et autres émules dont on mettait le nom bien en grand sur l'affiche. A leur côté, le petit étalon italien est devenu un héros, le représentant hypertrophié d'une Amérique belle et forte. Sly est passé des films les plus humains à ceux les plus bourrins et lui même de l'humilité à la mégalomanie. Laquelle des deux facettes représente le mieux le bonhomme ? Peut être aucune ou les deux. Quelque part, tout était déjà écrit dans les Rocky. Sly a bataillé pour arriver au sommet, en a savouré le parfum, peut-être plus que de raison, avant d'en dégringoler. Aujourd'hui, vieilli, usé mais pas fatigué, Sly remonte sur le ring. Avec bravoure, seul contre tous et sans davantage de prétention que de faire sortir son personnage fétiche. Son alter-ego. Le fantôme de sa carrière. Rocky Balboa.
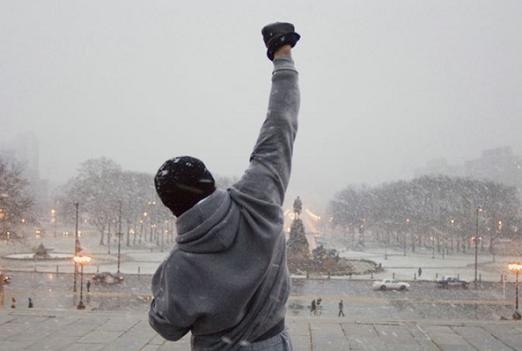
Filmographie
- L'étalon italien (Italian Stallion / The Party at Kitty and Stud's) - 1970
- Escapade à New York (The Out-of-Towners) - 1970
- Lune de miel aux orties (Lovers and Other Strangers) - 1970
- Bananas - 1971
- Klute - 1971
- Les mains dans les poches (The Lord's of Flatbush) - 1974
- Rebel (No place to hide) - 1975
- Prisonnier de la seconde avenue (The Prisoner of Second Avenue) - 1975
- Capone - 1975
- La course à la mort de l'an 2000 (Death Race 2000) - 1975
- Adieu ma jolie (Farewell, My Lovely) - 1975
- Cannonball - 1976
- Rocky - 1976
- FIST - 1978
- La taverne de l'enfer (Paradise Alley) - 1978
- Rocky II - 1979
- Les faucons de la nuit (Nighthawks) - 1981
- A nous la victoire (Victory) - 1981
- Rocky III - 1982
- Rambo (First blood) - 1982
- Staying alive - 1983
- New York cowboy (Rhinestone) - 1984
- Rambo II (Rambo: First Blood Part II) - 1985
- Rocky IV - 1985
- Cobra - 1986
- Bras de fer (Over the top) - 1987
- Rambo III - 1988
- Haute sécurité (Lock up) - 1988
- Tango & Cash - 1988
- A man called... rainbo - 1990
- Rocky V - 1990
- L'embrouille est dans le sac (Oscar) - 1991
- Arrête ! Ou ma mère va tirer ! (Stop ! Or my mom will shoot) - 1992
- Cliffhanger - 1993
- Demolition man - 1993
- L'expert (The Specialist) - 1994
- Judge Dredd - 1995
- Assassins - 1995
- Daylight - 1996
- The good life - 1997
- Cop land - 1997
- Get Carter - 2000
- Driven - 2001
- D-Tox - 2002
- Mafia love (Avenging Angelo) - 2002
- Taxi 3 - 2003
- Les maîtres du jeu (Shade) - 2003
- Spy Kids 3D - 2003