Dossier - Le Fantastique Gothique 1/3
Cinéma / Dossier - écrit par Lestat, le 20/11/2005Tags : fantastique gothique cinema litterature roman recit genre
Première partie du dossier consacré au fantastique gothique
Le gothique
Pour bien aborder le fantastique gothique, il convient de remonter à la source même du genre, et quitte à faire un mauvais jeu de mot, aux fondations. En effet, avant d'être une branche musicale dérivée du punk, le gothique était un genre littéraire et avant cela même, un courant architecturale. Sans entrer dans les 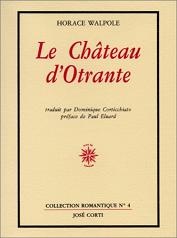
détails, on distingue l'art gothique de l'art roman par le biais des cathédrales, qui de trapues passèrent à hautes et naturellement éclairées. Pour soutenir toutes ces hauteurs, dont le but implicite était de se rapprocher le plus possible de Dieu, il fallut innover, et c'est ainsi que l'on obtient cette pure caractéristique gothique qu'est la voûte, qui encore aujourd'hui empêchent Notre Dame de Paris de s'écrouler sur les fidèles. Tout ceci est encore loin des films embrumés de la Hammer. Il faut attendre 1763 qu'un certain Horace Walpole rédige ce qui sera considéré comme le premier roman gothique -ou roman noir- de l'Histoire. Dépourvu de tout bagage littéraire, Walpole est avant tout un homme d'âge mur qui, après avoir collectionné tout un bric-à-brac à caractère moyenâgeux, entrepris de coucher sur le papier ses fantasmes. En résulte le Château d'Otrante, roman qui fera souffrir tout amateur de littérature, fantastique ou non. Plutôt mal écrit et tournant tranquillement en rond, Le Château d'Otrante est un récit embrouillé qui n'en fini plus. Malgré tout, il impose ce que deviendront les grands clichés du genre. Au fil de ces pages insensées défilent des passages secrets, une malédiction, un fantôme et une belle jeune fille cloîtrée, fuyant devant un châtelain qui entend bien en faire son épouse. Le roman de Walpole est donc surtout passé à la postérité pour avoir ouvert la porte (grinçante) à quelques auteurs bien mieux inspirés. Outre Matthew Lewis, dont Le Moine reste un ouvrage essentiel pour la littérature gothique, on retiendra ainsi les incontournables apports d'Anne Radcliffe, qui donna clairement ses lettres de noblesse au genre. A la littérature gothique vient se greffer un bestiaire de fantômes, d'être maudits et bien plus tard, de la créature la plus rattachée au genre, le vampire. Là encore les romans les plus fondateurs en sont les plus mal écrits. Le Vampire de John Polidori (1819), qui entre deux bâillements rappellera au lecteur le souvenir d'un certain Bram Stoker -qui ne prendra la plume que quelques 80 ans après Polidori- voir d'Anne Rice. Varney le Vampire (1847), de Thomas Preskett Prest, bafouille qui malgré son grand âge a l'avantage d'être gore et sexy, sans parler d'un style roublard qui reste agréable à lire. Le vampirisme s'accorde parfaitement au genre gothique, par sa mythologie presque païenne, son fétichisme vestimentaire et architectural, sa symbolique sexuelle et bien sur, son aspect anti-religieux que l'on trouve par exemple dans la peur de la croix. Car si il y a bien une chose à retenir de la littérature gothique, c'est sa volonté de construire ses intrigues autour de personnages impurs, qui par définition seront à la fin déchus par des êtres purs (une pureté de libido, d'esprit et en ces époques pieuses, de culte), quand ils ne sont pas victimes de leurs propres folies. C'est le cas du moine du roman de Lewis par exemple, qui à vouloir tirer le Diable par la queue finira par y perdre âme et vie. Ou tout simplement du Baron Frankenstein dont la créature non-née de Dieu se retournera contre lui. Dès Walpole, nous trouvons ainsi une forte symbolique religieuse, chère aux racines du mouvement, en la personne d'un moine devenu solution de la plupart des problèmes. Lewis, Radcliffe voir notre Marquis de Sade ont développé quand à eux un axe sexuel du Mal, autre caractéristique du gothique, avec, dans le cas de Lewis, ce moine, qui rompt son voeu de chasteté par le viol ou, pour les autres, ces jeunes filles confrontées à des pervers en tout genre, comme de bien entendu sauvées de ces satyres par des jeunes gens autrement plus prudes. Une tendance pas si éloignée du domaine religieux car jetant un clin d'oeil on ne peut plus appuyé au satanisme et sa supposée liberté sexuelle. Vous l'autre compris, le fantastique gothique est finalement un genre assez moral où, quelque soit le degré dramatique de l'intrigue, ce qui est contre-nature est amené à disparaître. Le cinéma suivra cette tendance, avec ces inévitables brasiers qui à la fin des films, lavent toutes traces de perversion. Ces même flambées qui désormais vierge de toute symbolique, donnent toujours un certain charme à ce genre révolu. Mais attention toutefois à ne pas faire d'amalgame, pureté et morale ne sous-entendant pas un manichéisme primaire. Si les personnages de Walpole sont dépourvues de toutes ambiguïté de caractères, la littérature gothique n'est jamais éloignée de la notion de malédiction. Des pages emplies de personnages torturés par leurs propres natures, apportant une finesse et une noirceur de registre qui se broda petit à petit autour de ce qui n'était à la base que des romans dit "de terreur".
Le fantastique gothique au cinéma se sera construit assez tôt sa propre imagerie, principalement de lieux et de costumes, il est vrai jamais vraiment éloignée de son pendant littéraire. Un monde fait de lieux ancestraux envahis par la brume, d'auberges remplies d'autochtones effrayés, de cryptes poussiéreuses, de dames recluses et d'héros au coeur noble. Sans oublier ce qui est devenu l'essence même du fantastique gothique : son aspect profondément tragique, ne se terminant que sur l'inévitable chute d'un être condamné par sa condition. A l'écran, ce sont amours maudits, malédictions inéluctables, vengeances d'outre-tombe, créatures inadaptées au monde... autant de drames qui se jouent en des théâtres devenus château, vielle demeure, moulin ou opéra. Plus que par son atmosphère parfois ésotérique, la folie de son architecture ou les décolletés affolants de ses actrices, c'est sans doute par cet aspect résolument sombre où se fondait une ambiance délicieusement macabre que le fantastique gothique est devenu l'un des plus beaux genres du cinéma.
"...et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvai en vue de la mélancolique Maison Usher. Je ne sais comment cela se fit, - mais, au premier coup d'oeil que je jetai sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. " - Edgar Allan Poe
Vampires et vieilles pierres
On aurait pu croire que les premières bobines gothiques nous seraient parvenues d'Angleterre, faisant succession à la littérature du même bois. Pourtant, chercher les origines du genre au cinéma nous fait parcourir des contrées bien plus familières. C'est en effet en France et surtout en Allemagne que l'on peut placer les origines du fantastique gothique. Une coïncidence peut être moins surprenante qu'il n'y parait. En effet, il faut tenir compte de l'élément historique, allant d'un long Moyen Âge au simple fait que le cinématographe soit né dans l'Hexagone, mais peut être aussi du fait que l'Allemagne - ou plutôt ce qui était alors le St Empire romain Germanique- par exemple était une terre riche en sorcellerie. Un fameux foyer était d'ailleurs situé dans ce qui deviendra l'Alsace sundgauvienne. Il serait intéressant d'évoquer ce que l'on peut voir à Altkirch au moment de Noël, mais revenons à nos moutons. Le fantastique gothique apparaît et se développe donc assez tôt dans le septième art. En 1896, George Méliès nous gratifiait déjà d'une oeuvre au nom évocateur, le Manoir du Diable. L'homme, qui était autant réalisateur que magicien, s'est rapidement servi de la caméra pour mettre en image ses univers et ses rêves. Le Manoir du Diable va jusqu'à être considéré par certains analystes comme le premier film de vampire de l'histoire, un vampirisme toutefois bien plus suggéré, sans grandes caractéristiques. Méliès pour sa part ne s'est pas arrêté en si bon chemin et tourne cette même année le Cabinet de Mephistopholès qui semblerait davantage se rapprocher du genre merveilleux. Pour vagabonder un peu, nous pouvons également faire un petit détour par les Etats Unis, où Thomas Edison tourne en 1910 un Frankenstein, qui sans être un incontournable présente quelques éléments bien macabres. Mais là où le gothique va vraiment prendre son envol, c'est bel et bien en terre allemande, avec le cinéma expressionniste. Cinéma tout en contraste et en univers hallucinés, l'expressionnisme allemand se marie par définition fort bien avec le genre fantastique et nous offrira deux films essentiels pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Der Golem en 1916 (Paul Wegener) et bien sur, Nosferatu, oeuvre charnière du courant.
 Aussi catholique soit-il, le genre gothique dénote quelques fois un mélange de fascination et de crainte envers le Judaïsme et le peuple Juif, stigmate sans doutes symptomatique de l'époque concernée, que l'on retrouve par exemple dans Melmoth ou l'Homme Errant, autre roman précurseur du genre. Hasard ou non, c'est bien dans le folklore juif qu'est ancré Der Golem. S'inspirant du mythe éponyme, Der Golem prend place dans le ghetto juif d'une ville indéterminée, située dans ce que l'on devine être l'Allemagne. D'une résonance étrange, surtout mis en parallèle des évènements tragiques de la Seconde Guerre Mondiale, Der Golem nous montre un peuple menacé, contraint de se construire un être d'argile pour se protéger et faire valoir leurs droits. Malgré tout, si il frise le film engagé par son sujet, Der Golem est finalement assez convenu. Conçu aux prémices de l'expressionnisme, son intérêt est sans doute plus pictural que réellement cinématographique, avec ces jeux d'ombres, de contrastes et ses effets visuels qu'encore aujourd'hui nous sommes en droit de trouver superbes. Et c'est essentiellement par ce visuel qu'il trouve sa place ici. Ne touchant le gothique que du bout du doigts, Der Golem part dans un délire architectural, qui parfois n'est pas sans rappeler l'esthétisme biscornu du Cabinet du Dr Caligari. Caves enfouies où l'on pratique de mystiques cérémonies, ville fortifiée aux lourds remparts, escaliers tortueux, passages secrets...Tout cela manque de château sinistre, mais nous ramène de plein fouet au genre. Quand au Golem du titre, il s'agit déjà là d'une créature prisonnière d'elle-même, victime de sentiments nouveaux. Sa chute sera le fait d'une petite fille, habillée de blanc. Soit la pureté à son plus haut degré de symbolisme. Der Golem, l'ancêtre direct du Frankenstein de James Whale ? Peut être pas encore, mais si le film a plus de stigmates des débuts de l'expressionnisme que du gothique, sa filiation avec le genre, dans une vision que n'aurait pas reniée Mary Shelley, est presque indéniable.
Aussi catholique soit-il, le genre gothique dénote quelques fois un mélange de fascination et de crainte envers le Judaïsme et le peuple Juif, stigmate sans doutes symptomatique de l'époque concernée, que l'on retrouve par exemple dans Melmoth ou l'Homme Errant, autre roman précurseur du genre. Hasard ou non, c'est bien dans le folklore juif qu'est ancré Der Golem. S'inspirant du mythe éponyme, Der Golem prend place dans le ghetto juif d'une ville indéterminée, située dans ce que l'on devine être l'Allemagne. D'une résonance étrange, surtout mis en parallèle des évènements tragiques de la Seconde Guerre Mondiale, Der Golem nous montre un peuple menacé, contraint de se construire un être d'argile pour se protéger et faire valoir leurs droits. Malgré tout, si il frise le film engagé par son sujet, Der Golem est finalement assez convenu. Conçu aux prémices de l'expressionnisme, son intérêt est sans doute plus pictural que réellement cinématographique, avec ces jeux d'ombres, de contrastes et ses effets visuels qu'encore aujourd'hui nous sommes en droit de trouver superbes. Et c'est essentiellement par ce visuel qu'il trouve sa place ici. Ne touchant le gothique que du bout du doigts, Der Golem part dans un délire architectural, qui parfois n'est pas sans rappeler l'esthétisme biscornu du Cabinet du Dr Caligari. Caves enfouies où l'on pratique de mystiques cérémonies, ville fortifiée aux lourds remparts, escaliers tortueux, passages secrets...Tout cela manque de château sinistre, mais nous ramène de plein fouet au genre. Quand au Golem du titre, il s'agit déjà là d'une créature prisonnière d'elle-même, victime de sentiments nouveaux. Sa chute sera le fait d'une petite fille, habillée de blanc. Soit la pureté à son plus haut degré de symbolisme. Der Golem, l'ancêtre direct du Frankenstein de James Whale ? Peut être pas encore, mais si le film a plus de stigmates des débuts de l'expressionnisme que du gothique, sa filiation avec le genre, dans une vision que n'aurait pas reniée Mary Shelley, est presque indéniable.
L'expressionnisme allemand va continuer son chemin, porté par le sinueux Caligari et surtout par deux réalisateurs indissociables de la mouvance, Fritz Lang et Friedrich Murnau. Voila qui tombe bien, c'est ce dernier qui en 1921 offre une version filmée de Dracula, qui contrairement à ce que l'on croit n'est pas la première, certaines archives faisant mention de deux films respectivement hongrois et russe qui lui furent antérieurs. Par ailleurs, Nosferatu est une version tout à fait non-officielle. Mais qu'importe, lorsque l'on parle du vampire-roi -pardon, du Comte Orlock- le gothique n'est jamais très loin. Si Nosferatu n'est pas un film techniquement extraordinaire, souffrant sans doute de la technologie de l'époque -on reste loin des plans pesants de Metropolis sorti six ans plus tard-, il s'impose avant tout comme un bon plagiat du classique de Bram Stoker, en reprenant à la lettre les passages obligés. A l'écran, une crypte ancestrale, une petite auberge, un labyrinthique château médiéval, autant d'éléments qui deviendront clichés, et qui s'accommodent à merveille des parti-pris esthétiques de Murnau. Dans le rôle titre, l'inquiétant visage de Max Shrek sublime tout ceci, ombre menaçante montant dans les coursives d'un bateau devenu morgue. Toutefois, le personnage d'Orlock est complètement manichéen et de fait, Nosferatu s'éloigne de l'aspect tragique qui emplissant déjà Der Golem. Le film de Murnau n'en a pas moins pénétré l'imaginaire, devenant une référence principalement visuelle.
Entre les années 10 et 30, Nosferatu et Der Golem restent cependant, avec le Vampyr de Carl Theodor Dreyer, parmi les principaux représentants du fantastique gothique en Allemagne. En effet, il ne semble pas que le pays de Goethe ait connu un réel engouement pour le genre, au profit du courant expressionniste qui, lui, permettra à des films aussi importants que l'Aurore ou M le Maudit de voir le jour. En vérité, il faut attendre que la route poussiéreuse du gothique traverse tout un océan pour s'envoler de plus belle. Une route qui suit les traces d'un petit exploitant de salles qui un jour décida que, quitte à diffuser des films, autant que ce soient les siens...
De la brume dans les décors
Les Etats Unis sont une terre où l'on cultive le business et l'ambition. Carl Laemmle en bon laboureur, fera du cinéma un profit et de l'univers son but à atteindre. En ces débuts du cinéma, sans entrer dans les détails, l'autorité s'appelle Thomas Edison qui avec sa compagnie possède le monopole de la distribution et de la production. Laemmle, tel le Baron Frankenstein, se confectionnera un géant pour lui tenir tête. Son nom ? Universal. Universal, ses créatures, ses décors, ses acteurs, autant d'organes qui feront des années 30 la première véritable grande décennie du fantastique gothique.
Carl Laemmle est un homme d'affaire, et donc n'est pas un sot. Pour que le cinéma soit rentable, il faut des films susceptibles d'être vus. Pour que le public soit intéressé par une histoire, il faut tout d'abord qu'il la connaisse, ensuite, qu'il y retrouve des acteurs qu'il aime. Universal dès ses débuts va ainsi se placer sur le créneau on ne peut plus populaire de l'adaptation de grands classiques de la littérature, avec une star en tête d'affiche. Jules Verne, Robert Louis Stevenson et Victor Hugo sont ainsi joués sur les écrans, ce dernier permettant d'introduire un des premier acteur reconnu comme incontournable d'Universal : Lon Chaney Senior. Nous sommes alors en 1923 et celui que l'on surnomma l'Homme aux 1000 Visages, car ayant joué la plupart de ses rôles grimé, campait ici le rôle titre du Bossu de Notre Dame, tout droit sorti des pages du poète français. En cette époque, le cinéma est encore muet et de fait, les acteurs doivent employer des trésors d'expressivité. En découle cet aspect de théâtre filmé, un style dont aura beaucoup de mal à s'affranchir Universal. D'autant qu'en Amérique et chez Universal en particulier, tout ou presque est construit et tourné en studio. L'allemand Nosferatu par exemple bénéficiait quand à lui de décors naturels. Fort de ce handicap, les premières productions de Carl Laemmle montent toujours plus haut dans la grandiloquence. En 1923, il reconstitue une cathédrale. La firme au globe ne va pas s'arrêter là. Il y eut une cathédrale ? La prochaine étape sera un opéra. 1925 est une date charnière, celle d'un film qui dévoilera déjà ce que seront les productions gothiques d'Universal. Cette année-là sera-celle d'un amour maudit qui ne pourra s'apaiser que dans la mort : le Fantôme de l'Opéra. Pouvait-on trouver sujet plus gothique que celui du roman de Gaston Leroux ? Un personnage solitaire, rejeté du monde, un lieu particulier et chargé d'histoire, tout est là pour une tragédie qui nous entraîne dans les sous-sols de l'Opéra de Paris, mystérieuses catacombes présentant ici un lac souterrain, là une série de pièges et de passages secrets. Une imagerie respectée, jusqu'au final où l'opéra se voit pris d'assaut par la foule, torches à la main. Le Fantôme de l'Opéra est et reste un chef d'oeuvre du muet, très théâtral dans son approche, où l'on sent malgré tout poindre une influence expressionniste, lorsque de grandes ombres s'étirent dans de sombres coulisses.
D'une trame plus dramatique que réellement fantastique, Le Fantôme de l'Opéra, héritant lui-même des bases du Bossu de Notre Dame, va inaugurer tout un bestiaire, issu de la culture fantastique ou non. Ces fameux monstres d'Universal seront à l'origine de l'âge d'or de la firme qui se tournera alors purement et simplement vers l'épouvante. Pour tout ceci, il faut à présent faire un petit saut vers les années 30 qui voit fleurir les principales productions gothiques d'Universal. La première, et principal déclencheur, sera bien sûr Dracula, de Tod Browning. Plutôt que de s'inspirer du texte originel de Bram Stoker, cette adaptation puise en réalité dans une pièce de théâtre au fort succès, qui se joue en ce début de décennie jusqu'à Broadway. Comme toujours Carl Laemmle voit grand et fait construire de monumentaux éléments de décors dans les studios d'Universal. Dans le rôle titre, il n'y a au préalable qu'un nom possible : Lon Chaney. Hélas, le destin jouera un de ces tours dont il est si friand. En 1930, Lon Chaney décède. Perdant à la fois une tête d'affiche et un grand acteur, Laemmle se rabat sur le même comédien qui, sur les planches, fait trembler les foules. Un comédien venu des Balkans, au regard sinistre et à l'accent étrange : Bela Lugosi. Un remplacement qui se fera au pied levé. Si Lugosi comprend encore mal l'anglais, sa présence et son aura malveillante suffisent à rendre exceptionnel un film qui sans cela, n'aurait rien de très extraordinaire. Quoiqu'il en soit, l'alchimie opère, et l'on oublie quelques effets spéciaux ratés pour une ambiance feutrée et plus théâtrale que jamais, car tout à la fois pur produit Universal et interprété par Lugosi, acteur tout ce qu'il y a de plus expansif. D'une petite auberge au sinistre château du vampire, tout en cercueil, toiles d'araignées et bestioles galopantes -dont un couple de tatous !-, Dracula joue la carte de la tradition, et assume pleinement sa filiation au genre, nous glissant au passage un peu de brume pour habiller la nuit et les décors trop vides.
Quoiqu'il en soit, l'alchimie opère, et l'on oublie quelques effets spéciaux ratés pour une ambiance feutrée et plus théâtrale que jamais, car tout à la fois pur produit Universal et interprété par Lugosi, acteur tout ce qu'il y a de plus expansif. D'une petite auberge au sinistre château du vampire, tout en cercueil, toiles d'araignées et bestioles galopantes -dont un couple de tatous !-, Dracula joue la carte de la tradition, et assume pleinement sa filiation au genre, nous glissant au passage un peu de brume pour habiller la nuit et les décors trop vides.
Non sans avoir bataillé avec la censure, Dracula sort en 1931 et s'impose comme un joli succès. Ce sera le déclic pour Universal, qui voit là une boite de Pandore. La même année, Carl Laemmle ne laisse pas refroidir et remet le couvert, s'attaquant à une autre grande figure de la littérature gothique : Frankenstein. Le succès de Lugosi allant avec celui de Dracula, notre producteur décide en toute logique de lui faire jouer la créature du roman. Mais Lugosi refuse et s'en retourne vers d'autres plateaux. Finalement, Universal se tourne vers un acteur qui évolua un temps dans son giron, comme second rôle : un certain William Henry Pratt, plus connu sous son nom de scène, Boris Karloff. Pour cette fois, la firme fait preuve d'une certaine prudence dans son approche de l'horreur vis à vis du public. Le film débute ainsi par une petite aparté, où un personnage, debout sur une estrade, informe le spectateur que ce qu'il voit n'est jamais qu'une fiction. Un moyen qui en vaut un autre, ayant pour lui d'être cohérent avec les parti-pris de la compagnie -on pense ainsi au Prologue, cher au monde du théâtre et de la tragédie- et contre lui de créer une certaine distanciation qui aujourd'hui peut agacer. Mais qu'importe. Dirigé par James Whale, Frankenstein reste un des plus grands films de l'Age d'or d'Universal. Cimetière brumeux où des hommes louches exhument des corps, laboratoire mystérieux où un docteur de prend pour Dieu... Plus maîtrisé que Dracula, Frankenstein est un nouveau pas en avant et présente de superbes décors. Et surtout, le film dévoile un maquillage incontournable du cinéma. Parlez de Frankenstein à quelqu'un, voici ce qu'il verra en premier : cette tête carrée, barrée par une cicatrice, d'où dépassent encore deux électrodes. Un travail assez incroyable pour l'époque, sous lequel Karloff sua et souffrit sans broncher. Assimilant complètement l'esprit du roman de Mary Shelley, Frankenstein oublie rapidement son registre horrifique pour plonger dans un drame touchant, suivant les pas d'un monstre en proie à un monde qui n'est pas le sien. Habité par son rôle, Karloff compose une créature qui vient de naître, partagée entre la peur, la curiosité et l'émerveillement, que ses découvertes conduiront à un meurtre bien involontaire, lors d'une scène à l'absurdité poignante. Film d'épouvante se muant peu à peu en drame teinté de réflexion humaniste, Frankenstein de James Whale reste à ce jour inégalé. Une histoire maudite, qui termine dans un brasier impitoyable où la créature hurle toute sa détresse à la face d'une foule médusée.
 Nouveau succès pour Universal, qui n'abandonnera pas le filon gothique, ni sa nouvelle star, Boris Karloff. Ce qui aurait été difficile si ce n'est idiot : Karloff en plus d'avoir prouvé tout son talent, est également une gueule dont le charme froid reste en mémoire. Un physique un peu atypique qui sera réemployé dès 1932, à l'occasion de la Momie, signé Karl Freund. Davantage dans le sujet, 1932 est également l'année de The Old Dark House, où un groupe de voyageur se réfugie dans un sinistre château. Un film réalisé par James Whale, qui adaptait une oeuvre pour la deuxième fois -le film étant tiré d'un roman de JB Priestley-, avant de se consacrer en 1933 à l'Homme Invisible, nouvelle prouesse d'effets spéciaux, bien entendu inspiré des écrits de HG Welles. Tout ceci nous amène en 1934. Cette année, Universal met sur pied Le Chat Noir, vaguement inspiré d'Edgar Poe. 1934, choc des titans, où Karloff partage la vedette avec Bela Lugosi. Les deux hommes n'ont pourtant pas grand chose en commun -en plus de se détester cordialement-. Lugosi est un acteur très démonstratif, voir cabotin. Karloff au contraire possède un jeu beaucoup plus rentré, bien plus intérieur. Les deux monstres ne se complèteront que mieux. C'est en effet un pas de deux exceptionnel que nous livrent ici Karloff et Lugosi, confrontant chacun leurs jeux respectifs dans une mystérieuse demeure aux lourds secrets. Une fois de plus très théâtral, le Chat Noir dénote également une vision du cinéma qui ne s'est toujours pas affranchie du muet, où la musique est presque omniprésente, où Karloff prend soudain des allures de mime. Le Chat Noir est un film hors du temps, où l'on descend de tortueux escaliers, où l'on joue sa vie aux échecs, où des femmes sont sacrifiées dans d'étranges cérémonies jusqu'à un final superbe, où la vengeance plonge avec une rare profondeur dans l'horreur pure et dure. Mais l'année phare de la période gothique d'Universal restera sans doute 1935. Cette année là, ce n'est pas moins de trois films qui voient le jour. Une adaptation de Poe, Le Corbeau, où l'on retrouve à nouveau le duo Karloff/Lugosi, The Werewolf of London, et ce qui pourrait être vu comme l'apogée de la firme : La Fiancée de Frankenstein. La Fiancée de Frankenstein, toujours réalisé par James Whale et toujours avec Boris Karloff en créature, est un film beaucoup plus tragique que son aîné et s'impose comme un drame fantastique au plus pur sens du terme. Alchimie parfaite d'épouvante, d'émotions, de soins de décors et de jeux d'acteurs, la Fiancée de Frankenstein est le point d'orgue du fantastique gothique pour Universal. D'ailleurs, après ce chef d'oeuvre, Universal fera une pause, pour ne produire pratiquement plus que des suites ou des films d'un fantastique plus global. On retiendra tout de même l'excellent Le Loup Garou, où Lon Chaney Jr crapahute dans des bois embrumés, victime d'une malédiction lycanthrope.
Nouveau succès pour Universal, qui n'abandonnera pas le filon gothique, ni sa nouvelle star, Boris Karloff. Ce qui aurait été difficile si ce n'est idiot : Karloff en plus d'avoir prouvé tout son talent, est également une gueule dont le charme froid reste en mémoire. Un physique un peu atypique qui sera réemployé dès 1932, à l'occasion de la Momie, signé Karl Freund. Davantage dans le sujet, 1932 est également l'année de The Old Dark House, où un groupe de voyageur se réfugie dans un sinistre château. Un film réalisé par James Whale, qui adaptait une oeuvre pour la deuxième fois -le film étant tiré d'un roman de JB Priestley-, avant de se consacrer en 1933 à l'Homme Invisible, nouvelle prouesse d'effets spéciaux, bien entendu inspiré des écrits de HG Welles. Tout ceci nous amène en 1934. Cette année, Universal met sur pied Le Chat Noir, vaguement inspiré d'Edgar Poe. 1934, choc des titans, où Karloff partage la vedette avec Bela Lugosi. Les deux hommes n'ont pourtant pas grand chose en commun -en plus de se détester cordialement-. Lugosi est un acteur très démonstratif, voir cabotin. Karloff au contraire possède un jeu beaucoup plus rentré, bien plus intérieur. Les deux monstres ne se complèteront que mieux. C'est en effet un pas de deux exceptionnel que nous livrent ici Karloff et Lugosi, confrontant chacun leurs jeux respectifs dans une mystérieuse demeure aux lourds secrets. Une fois de plus très théâtral, le Chat Noir dénote également une vision du cinéma qui ne s'est toujours pas affranchie du muet, où la musique est presque omniprésente, où Karloff prend soudain des allures de mime. Le Chat Noir est un film hors du temps, où l'on descend de tortueux escaliers, où l'on joue sa vie aux échecs, où des femmes sont sacrifiées dans d'étranges cérémonies jusqu'à un final superbe, où la vengeance plonge avec une rare profondeur dans l'horreur pure et dure. Mais l'année phare de la période gothique d'Universal restera sans doute 1935. Cette année là, ce n'est pas moins de trois films qui voient le jour. Une adaptation de Poe, Le Corbeau, où l'on retrouve à nouveau le duo Karloff/Lugosi, The Werewolf of London, et ce qui pourrait être vu comme l'apogée de la firme : La Fiancée de Frankenstein. La Fiancée de Frankenstein, toujours réalisé par James Whale et toujours avec Boris Karloff en créature, est un film beaucoup plus tragique que son aîné et s'impose comme un drame fantastique au plus pur sens du terme. Alchimie parfaite d'épouvante, d'émotions, de soins de décors et de jeux d'acteurs, la Fiancée de Frankenstein est le point d'orgue du fantastique gothique pour Universal. D'ailleurs, après ce chef d'oeuvre, Universal fera une pause, pour ne produire pratiquement plus que des suites ou des films d'un fantastique plus global. On retiendra tout de même l'excellent Le Loup Garou, où Lon Chaney Jr crapahute dans des bois embrumés, victime d'une malédiction lycanthrope.
Théâtral, tragique, porté par des acteurs de légendes, Universal aura marqué l'épouvante, popularisant un univers fait de noir, de blanc et de brume. Toutefois cette partie ne serait complète sans s'épancher un petit peu sur le milieu de la série B de ces années là. Car il ne serait pas juste de cantonner le fantastique américain des années 30 et 40 à la seule firme de Carl Laemmle. Certes, rares ont été les films qui atteignirent le niveau des meilleures oeuvres de la compagnie, tant au niveau de la qualité que de la filiation au genre gothique, mais il s'en trouve tout de même qu'il convient d'évoquer ici. Indiquons par exemple un sous-genre un peu bâtard dit Old Dark House Movie, qui comme son nom l'indique tourne autour de quelques lugubres bâtisses. Parallèle rêvé pour l'imagerie gothique, qui se développera par petite touches dans ces sombres couloirs et terribles orages. Durant les années 30, le prolifique Franck Strayer en sortira deux représentants. The Monster Walks en 1933 et The Ghost Walks, en 1934. Le premier, s'appuyant sur un postulat qu'on pourrait trouver, en creusant bien, inspiré d'Edgar Poe, voit un singe faire peur aux dames dans une mystérieuse demeure. Pas follement original sur le papier, The Monster Walks au titre bien mensonger se raccroche aux branches par son ambiance lourde et son tonnerre tonitruant. Pétri du même moule ou presque, the Ghost Walks nous présente à son tour une maison aux lourds secrets et une météo épouvantable. Un peu d'humour, quelques passages secrets et une jolie surprise finale font un moment agréable de ce film rappelant un Cluedo géant. Deux incursions un peu bancales donc, qui ne font pas oublier que Franck Strayer est avant tout l'auteur de The Vampire Bat en 1933, un thriller fantastique assez savoureux où une petite ville est en proie à une vague de meurtres. Meurtres rapidement catalogués comme étant l'oeuvre de vampires. Bien qu'un peu trop bavard, The Vampire Bat est une pure série B maîtrisée de bout en bout. On pourra même être agréablement surpris par son approche réellement et totalement cinématographique, s'éloignant complètement du style théâtral d'Universal à la même époque -dont The Monster Walks est en revanche empli-. Rien de vraiment gothique en revanche dans The Vampire Bat, hormis une scène très réussie se déroulant dans une caverne.
Tout cela nous amène aux années 40, période ô combien importante où Bela Lugosi tourne paradoxalement quelques uns de ses meilleurs films pour ensuite connaître le début de la fin. Deux titres seraient à retenir ici : The Human Monster et The Corpses Vanishes. Le premier (1940) nous montre Lugosi dans la peau d'un médecin meurtrier, le Dr Orloff. Un personnage qui doit rappeler des choses à certains, et pour cause, nous le retrouveront bien plus tard en 1961 chez l'hispanique Jésus Franco. Dans un de ses rôles les plus violents, Lugosi campe un praticien responsable d'une compagnie d'assurance, assassinant ses clients pour toucher la prime. Parallèlement, il tient plus ou moins les rênes d'un institut pour aveugles, dont les membres l'aident dans ses noirs desseins. Ce sont peut être ces scènes à l'institut qui donnent toute sa force au film, rappelant parfois curieusement l'Île du Dr Moreau lorsque les mystérieux patients écoutent les paroles bibliques d'un prédicateur de pacotille. Parmi ces patients, un homme muet, aveugle, atrocement défiguré, qui, évoluant dans les sombres décors de l'institut, nous ramènes de plein fouet au genre gothique. Il serait d'ailleurs intéressant de comparer ce film avec celui de Jésus Franco. Les deux oeuvres sont tout à fait complémentaires, puisque présentant dans les deux cas un médecin assassin et un serviteur aveugle et muet, qui se rebellera contre son maître. Le film de Franco est toutefois plus affilié au genre traité ici. Quand à The Corpse Vanishes (1942), c'est sans doute avec Dracula de Browning et White Zombie de Victor Halperin l'un des meilleurs films de Lugosi. Dans la peau d'un savant fou kidnappant des jeunes mariées pour sauver sa femme, l'acteur évolue dans un film tragique, théâtral qui parfois reprend les codes du cinéma muet. Traditionnel dans sa conception, éparpillant par-ci par-là quelques cercueils, une cave secrète et un amour désespéré, The Corpses Vanishes est tout simplement un film superbe.
Nous retrouverons également Lugosi dans un registre plus purement gothique à l'occasion de Frankenstein contre le Loup Garou (1943) ou dans le "comique" Abbott et Costello contre Frankenstein. Mais l'arrivée des années 50 sonnera la déchéance pour le vieil acteur, sans parler du genre, de moins en moins prisé. D'ailleurs, aux Etats Unis, il faudra attendre les années 60 pour que l'horreur gothique revienne dans toutes sa splendeur. C'est ici que l'histoire s'arrête pour le gothique américain... pour l'instant.
Le coup de marteau des années 50
Nous avons vu que le fantastique gothique possède un berceau direct, l'Angleterre, par le biais de la littérature. Comme dans tout cycle naturel des choses, le genre aura ensuite vagabondé, se sera construit ici et là, pour revenir plus tardivement à ses sources et enfin exploser. En 1932 en Angleterre, un exploitant de salle, Enrique Carreras, s'associe avec William Hinds homme de théâtre et dirigeant d'une chaîne de bijouterie (!). Ensembles, ils montent leurs propre compagnie de production. Hammer Film est née, et avec elle, le fantastique gothique connaîtra un bond sans précédent. Tout simplement parce que la Hammer, plus qu'Universal, aura su créer une tel impact que son style s'en retrouvera imité, copié et il faut bien le dire, égalé et surpassé.
Aux prémices de son histoire, la Hammer se consacre à la comédie et déjà un peu au fantastique, dans des films sans cachet particulier. Pour l'anecdote, Hammer produira en 1936 The Mystery of Mary Celeste, film qui n'a pas grande importance dans son histoire -ne serait-ce que parce qu'il est particulièrement poussif et ennuyeux- mais au sein duquel nous retrouvons un certain Bela Lugosi en énigmatique marin. En vérité, l'histoire de la Hammer ne débute réellement qu'après la Seconde Guerre Mondiale. Une renaissance tardive due au conflit, forçant la compagnie à fermer boutique jusqu'en 1946, où elle connaîtra une période de vache maigre. Ce n'est que vers le milieu des années 50 qu'Hammer film pourra se remettre à flot, sortant des films autrement plus majeurs, comme l'adaptation des aventures du professeur Quatermass (The Quatermass Experiment, 1955, sorte d'ancêtre à notre X-Files). D'ailleurs, c'est sans doute de Quatermass que tout découla. Le public accueillant plutôt chaudement cette histoire naviguant dans les eaux troubles du fantastique, la Hammer décide d'exploiter pleinement le créneau, et met sur pied une adaptation de Frankenstein. Plus de vingt ans après, c'est en quelque sorte le schéma d'Universal qui se répète, avec à l'avantage de la firme anglaise, le film de James Whale devenu un classique. Ce projet deviendra Frankenstein s'est Echappé, en 1957. Un film qui pourrait être le parfait résumé de ce que fut la grande époque de la Hammer. Dans le rôle du baron Frankenstein, un acteur souvent sollicité par la firme qui n'avait jusqu'alors fait que décliner, Peter Cushing. Dans le rôle de la créature, un anglais qui roule sa bosse depuis quelques temps déjà dans l'ombre des premiers rôles, un certain Christopher Lee. A la réalisation, ce sera un réalisateur confirmé, engagé par la firme au début des années 50. Un réalisateur qui deviendra indissociable de la Hammer et du fantastique gothique : Terence Fisher.
 Hammer, ses costumes, ses décors, sa lande brumeuse... et ses couleurs. Le cinéma est au début de son ère colorisée et la Hammer entend bien s'imposer dans les films d'épouvante en couleur. L'explication du formidable impact de la firme anglaise se trouve sans doute là, dans sa faculté à soudain proposer quelques chose non pas de nouveau mais de rarement vu. Hinds et Carreras l'auront compris aussi, et quitte à extrapoler, peut être est-ce pour cela que les productions Hammer sont d'une forme superbe, mais d'une écriture parfois négligée. Frankenstein s'est échappé n'y échappe pas (!) et à l'instar de son successeur, le fabuleux Cauchemar de Dracula, présente des trous narratifs et un aspect expéditif assez contraignants. Pourtant, Frankenstein s'est échappé est pourvu d'indéniables qualités et développe une imagerie époustouflante, imagerie que l'on reconnaîtra par la suite comme partie intégrante de la Hammer. Le début de Frankenstein s'est échappé nous emmène dans un lugubre cachot, où le Baron Frankenstein, au bord de la folie et condamné pour meurtre, tente de plaider son innocence en racontant son histoire. Ce long flashback sera le corps du film en lui même. Frankenstein s'est échappé est un titre français qui s'avérerait presque mensonger, sans doute dû au fait que la pensée populaire a assimilé la créature de Frankenstein à Frankenstein lui même. Le titre original, Curse of Frankenstein, est bien plus représentatif de ce qu'est en réalité le film. Car ici, le parti-pris est de s'intéresser au Baron lui-même plus qu'au fruit de ses expériences macabres. La créature, que nous voyons finalement assez peu, n'a qu'un rôle secondaire. Ici, la star est Cushing, praticien froid, impitoyable, allant jusqu'au meurtre pour assouvir ses obsessions. Christopher Lee, surprenant, se fond quand à lui dans un rôle muet et saccadé, poupée désarticulée assez lointaine du personnage original de Mary Shelley, que l'on pourrait rapprocher de la créature d'Universal. A la différence que la créature de la Hammer n'est pas tragique, n'est pas ambiguë. Son cerveau abîmé ne le fait aspirer qu'à tuer. Un manichéisme assez primaire, présentant comme aux origines du genre, deux êtres purs, un homme et une femme, pour contrer deux incarnations du mal, Frankenstein et son monstre. De fait, nous avons ici une histoire simpliste ou en tout cas moins subtile que l'était son pendant américain. Mais Frankenstein s'est échappé, c'est aussi un décor mi-naturel, mi-reconstitué, s'opposant aux studios camouflés des productions d'Universal, une forêt sépia où flotte quelques volutes de brouillards, un prélèvement de cerveau dans le caveau d'un petit cimetière, un laboratoire croulant sous les fioles et les cornus, un château cachant de lourds secrets derrière des portes closes. Et aux côtés de tout cela, Frankenstein et sa fiancé en costume victoriens, des pièces aménagées avec goûts contrebalançant des éléments de décors trop visibles, des couleurs qui n'en finissent plus de crever l'écran. Du rouge, du vert, des détails minutieux, des garde-robes gargantuesques... et du sang écarlate. Hammer, c'est aussi une approche de la violence relativement inédite pour l'époque. Des mains coupées, une balle frappant Christopher Lee en pleine tête... le hors champ est évidement de mise, mais en grattant un peu, il ne serait peut être pas ridicule de placer certains films de la Hammer au même rayon que tout ces films plus explicites que la moyenne, qui plus tard donnèrent naissance au genre gore. Scandale critique et succès public, l'un allant rarement sans l'autre, Hammer ne s'arrête pas en si bon chemin. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Fisher, Cushing et Lee re-signent ensemble l'année suivante pour la nouvelle adaptation d'un classique de la littérature. Les mythes à dépoussiérer par le technicolor ne manquent pas et c'est une autre grande figure qui revient sur le devant de la scène. 1958 sera marqué par les capes et les crocs et offre une cure de jouvence à Dracula.
Hammer, ses costumes, ses décors, sa lande brumeuse... et ses couleurs. Le cinéma est au début de son ère colorisée et la Hammer entend bien s'imposer dans les films d'épouvante en couleur. L'explication du formidable impact de la firme anglaise se trouve sans doute là, dans sa faculté à soudain proposer quelques chose non pas de nouveau mais de rarement vu. Hinds et Carreras l'auront compris aussi, et quitte à extrapoler, peut être est-ce pour cela que les productions Hammer sont d'une forme superbe, mais d'une écriture parfois négligée. Frankenstein s'est échappé n'y échappe pas (!) et à l'instar de son successeur, le fabuleux Cauchemar de Dracula, présente des trous narratifs et un aspect expéditif assez contraignants. Pourtant, Frankenstein s'est échappé est pourvu d'indéniables qualités et développe une imagerie époustouflante, imagerie que l'on reconnaîtra par la suite comme partie intégrante de la Hammer. Le début de Frankenstein s'est échappé nous emmène dans un lugubre cachot, où le Baron Frankenstein, au bord de la folie et condamné pour meurtre, tente de plaider son innocence en racontant son histoire. Ce long flashback sera le corps du film en lui même. Frankenstein s'est échappé est un titre français qui s'avérerait presque mensonger, sans doute dû au fait que la pensée populaire a assimilé la créature de Frankenstein à Frankenstein lui même. Le titre original, Curse of Frankenstein, est bien plus représentatif de ce qu'est en réalité le film. Car ici, le parti-pris est de s'intéresser au Baron lui-même plus qu'au fruit de ses expériences macabres. La créature, que nous voyons finalement assez peu, n'a qu'un rôle secondaire. Ici, la star est Cushing, praticien froid, impitoyable, allant jusqu'au meurtre pour assouvir ses obsessions. Christopher Lee, surprenant, se fond quand à lui dans un rôle muet et saccadé, poupée désarticulée assez lointaine du personnage original de Mary Shelley, que l'on pourrait rapprocher de la créature d'Universal. A la différence que la créature de la Hammer n'est pas tragique, n'est pas ambiguë. Son cerveau abîmé ne le fait aspirer qu'à tuer. Un manichéisme assez primaire, présentant comme aux origines du genre, deux êtres purs, un homme et une femme, pour contrer deux incarnations du mal, Frankenstein et son monstre. De fait, nous avons ici une histoire simpliste ou en tout cas moins subtile que l'était son pendant américain. Mais Frankenstein s'est échappé, c'est aussi un décor mi-naturel, mi-reconstitué, s'opposant aux studios camouflés des productions d'Universal, une forêt sépia où flotte quelques volutes de brouillards, un prélèvement de cerveau dans le caveau d'un petit cimetière, un laboratoire croulant sous les fioles et les cornus, un château cachant de lourds secrets derrière des portes closes. Et aux côtés de tout cela, Frankenstein et sa fiancé en costume victoriens, des pièces aménagées avec goûts contrebalançant des éléments de décors trop visibles, des couleurs qui n'en finissent plus de crever l'écran. Du rouge, du vert, des détails minutieux, des garde-robes gargantuesques... et du sang écarlate. Hammer, c'est aussi une approche de la violence relativement inédite pour l'époque. Des mains coupées, une balle frappant Christopher Lee en pleine tête... le hors champ est évidement de mise, mais en grattant un peu, il ne serait peut être pas ridicule de placer certains films de la Hammer au même rayon que tout ces films plus explicites que la moyenne, qui plus tard donnèrent naissance au genre gore. Scandale critique et succès public, l'un allant rarement sans l'autre, Hammer ne s'arrête pas en si bon chemin. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Fisher, Cushing et Lee re-signent ensemble l'année suivante pour la nouvelle adaptation d'un classique de la littérature. Les mythes à dépoussiérer par le technicolor ne manquent pas et c'est une autre grande figure qui revient sur le devant de la scène. 1958 sera marqué par les capes et les crocs et offre une cure de jouvence à Dracula.
 Dracula et la Hammer, une association devenue mythique. Le Cauchemar de Dracula est l'un des films les plus importants de la firme anglaise, celui qui affirmera son style et le fera entrer dans la conscience collective. Celui qui fera pleinement de la Hammer une compagnie dédiée au genre. Comme pour Frankenstein s'est échappé, le Cauchemar de Dracula s'éloigne complètement du grand roman de Bram Stoker pour une approche plus directe, privilégiant le cadre, la violence et déjà, un érotisme léger. Jouant non sans une certaine outrance avec l'imagerie gothique, Le Cauchemar de Dracula se dévoile dès l'introduction, où une imposante sculpture d'aigle, de ce que l'on devine être l'aile d'un gigantesque château, nous saute au visage, rapidement suivie du fameux générique en lettre rouges et à la typographie vieillotte typique de la Hammer. S'en suit un plan dans une crypte où apparaît le cercueil poussiéreux de Dracula, se recouvrant lentement d'un filet de sang vermillon. Le Cauchemar de Dracula nous rejoue tout les clichés avec un certain bonheur : la petite auberge d'autochtones peu affables, la nuit embrumée, la dame captive, la course en calèche, l'enterrement prématuré... Mais n'oublie pas de donner un sérieux coup de jeune au mythe. Le casting en cela est exemplaire. Le professeur Van Helsing devient un jeune et fougueux savant, prenant les traits de Peter Cushing. Côté Dracula, même chose, le vampire inquiétant mais vieillissant est remplacé par un homme vif et dans la force de l'âge, incarné par un Christopher Lee trouvant là le rôle de sa vie. Toute une thématique du roman de chevalerie (un jeune premier et un vieux sage contre un monstre millénaire) qui tombe à l'eau, et de fait, plus besoin de Johnathan Harker, le seul ayant son âge respecté, liquidé lors du premier acte. Et que dire du final musclé où Van Helsing et Dracula se livrent à un véritable pugilat, si ce n'est qu'on est désormais loin de l'aspect théâtral des prémices du genre. Mais avec le gothique, la tradition n'est jamais très loin. Tout ceci terminera par le feu... d'une certaine manière.
Dracula et la Hammer, une association devenue mythique. Le Cauchemar de Dracula est l'un des films les plus importants de la firme anglaise, celui qui affirmera son style et le fera entrer dans la conscience collective. Celui qui fera pleinement de la Hammer une compagnie dédiée au genre. Comme pour Frankenstein s'est échappé, le Cauchemar de Dracula s'éloigne complètement du grand roman de Bram Stoker pour une approche plus directe, privilégiant le cadre, la violence et déjà, un érotisme léger. Jouant non sans une certaine outrance avec l'imagerie gothique, Le Cauchemar de Dracula se dévoile dès l'introduction, où une imposante sculpture d'aigle, de ce que l'on devine être l'aile d'un gigantesque château, nous saute au visage, rapidement suivie du fameux générique en lettre rouges et à la typographie vieillotte typique de la Hammer. S'en suit un plan dans une crypte où apparaît le cercueil poussiéreux de Dracula, se recouvrant lentement d'un filet de sang vermillon. Le Cauchemar de Dracula nous rejoue tout les clichés avec un certain bonheur : la petite auberge d'autochtones peu affables, la nuit embrumée, la dame captive, la course en calèche, l'enterrement prématuré... Mais n'oublie pas de donner un sérieux coup de jeune au mythe. Le casting en cela est exemplaire. Le professeur Van Helsing devient un jeune et fougueux savant, prenant les traits de Peter Cushing. Côté Dracula, même chose, le vampire inquiétant mais vieillissant est remplacé par un homme vif et dans la force de l'âge, incarné par un Christopher Lee trouvant là le rôle de sa vie. Toute une thématique du roman de chevalerie (un jeune premier et un vieux sage contre un monstre millénaire) qui tombe à l'eau, et de fait, plus besoin de Johnathan Harker, le seul ayant son âge respecté, liquidé lors du premier acte. Et que dire du final musclé où Van Helsing et Dracula se livrent à un véritable pugilat, si ce n'est qu'on est désormais loin de l'aspect théâtral des prémices du genre. Mais avec le gothique, la tradition n'est jamais très loin. Tout ceci terminera par le feu... d'une certaine manière.
La Hammer a tapé dans l'oeil des cinéastes et entre dans la légende. Se réveillant sur le tard, la firme conclura déjà la décennie, avec La Revanche de Frankenstein, toujours avec Cushing et Lee et bien sur, Le Chien des Baskerville, encore avec Cushing et Lee. Le Chien des Baskerville ou l'aboutissement du style Hammer des années 50, un film qui trouve enfin une richesse d'écriture tout en conservant la beauté d'une lande emplie de brouillard, la splendeur des couleurs et le soin des costumes. Ainsi s'achèvent les années 50 pour ce qui nous intéresse ici. Bien sur, ces films de Terence Fisher malgré leurs statuts ne sont que quelques-uns parmi d'autres dans l'histoire de la Hammer, qui d'ici 1960 entreprendra de dépoussiérer également la Momie (La Malédiction des Pharaons) ou Dr Jekyll et Mr Hyde (Les deux visages du Dr. Jekyll).
-Lire Partie 2-