Halloween - Dossier John Carpenter
Cinéma / Dossier - écrit par Lestat, le 26/09/2004Tags : halloween carpenter john film cinema myers michael
Dossier sur la carrière de John Carpenter
Pour commencer à parler de Carpenter, il faut avant tout mettre en avant ce qui en fait un auteur unique, à savoir... son absence de reconnaissance chez ses compatriotes. Ce grand être voûté aux allures d'Apaches à la moustache tombante pratique un cinéma un peu revanchard, sec comme un coup de trique et glorifiant les westerns dont il ne manque pas de pleurer la mort prématurée. De fait, il apparaît quelque peu à part dans le circuit, ayant son lot de bides pour des films devenus cultes au fil des ans. Un statut étrange qu'il définit lui même par une phrase devenue célèbre : "En France, je suis un auteur, en Allemagne, je suis un cinéaste. En Grande Bretagne, je suis un réalisateur de film d'horreur. Aux Etats-Unis, je suis un bon à rien". Paradoxe d'un réalisateur à qui l'on doit quelques uns des plus grands films de l'histoire du cinéma d'horreur et de SF, ou tout du moins ceux qui eurent le plus d'influence sur celui-ci. John Carpenter, c'est une vingtaine de films et presque autant de bras d'honneur à tout un système où il n'a pas sa place et ne l'aura sans doute jamais. Aux années Reagan, il répondra Invasion Los Angeles. Aux héros propres sur eux, il répondra par Snake Plissken. A la poignée de dollars qu'on voudra bien lui accorder, il répondra par Prince des Ténèbres. Et tout ce que Tarantino aura entrepris avec Kill Bill n'a fait sans doute que sourire en coin l'ami John, lui qui avait fait la même chose 20 ans plus tôt, avec Jack Burton...
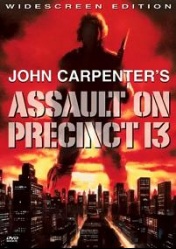
Une carrière qui ne captiva que rarement les foules en son temps, une personnalité hors-normes... On aimerait presque dire que John Carpenter est entré dans le cinéma par la petite porte, se heurtant aux écoles de cinéma, apprenant sur le tas les dures lois du métiers. Et pourtant Carpenter suivit un cursus tout ce qu'il y a de plus prestigieux. Poussé par une passion du fantastique qu'il acquiert très tôt et ne perdit jamais, John Carpenter entre à 20 ans au département cinéma de l'University of South California, où il réalisera son premier court-métrage : The Resurrection of Bronco Billy. Récompensé par l'Oscar du meilleur court métrage, The Resurrection of Bronco Billy montre déjà l'intérêt que porte le réalisateur en herbe à un sous-genre alors en train de s'éteindre : le western. 1974 est la première date significative pour Carpenter, car celle de son premier véritable film : Dark Star, cette fois-ci un SF mis en place avec son ami Dan O'Bannon (Le Retour des Morts Vivants). Dark Star, à la base un moyen métrage, connaîtra une cure d'étirements pour se transformer en long, devenant alors un film curieux tiraillé entre le délire de deux potes et les exigences d'un producteur casse-pied. Dark Star, sorte d'hybride indéfinissable, devint l'une des références pour ce qui deviendra le futur Alien de Ridley Scott (scénarisé par O'Bannon...) tout en présentant un des extraterrestres les plus grotesques de l'histoire du cinéma, sorte de ballon de plage sur patte qui n'évite pas le ridicule.
Mais c'est réellement en 76 et surtout en 78 que la carrière de John Carpenter va réellement commencer puis exploser. 76, c'est l'année d'Assaut, sorte de remake urbain du Rio Bravo de son idole Howard Hawks. Maîtrisé et abouti, Assaut fera forte impression, permettant au jeune réalisateur de se voir ouvrir quelques portes. C'est au Festival de Londres, en 1978, que Carpenter va saisir ce qui restera la chance de sa vie.
A cette époque, un nouveau sous-genre est en train d'émerger, titillé par l'héritage de Mario Bava et surtout par Tobe Hooper. Bien qu'encore un peu timide et ne possédant pas encore de caractéristiques propres, si ce n'est celles de ses ancêtres spirituels, le slasher-movie faisait ainsi son apparition. Le Slasher, de to slash : entailler, se distingue dans le cinéma d'horreur par une approche humaine et plausible : pas de vampires, de fantômes ou de démons, mais des maniaques en tout genre, parfois inspirés de serial killer bien réels. Au public de déterminer ce qui l'effraie le plus... Pourtant, Massacre à la tronçonneuse, le "papa", un peu à cheval entre deux univers, ne fit pas réellement d'émules directes ou alors davantage, par son personnage de gros taré vociférant, sur le terrain du survival, autre sous-genre comprenant des noms aussi disparates que Délivrance ou récemment Détour Mortel, et c'est là que Carpenter entre en jeu, en livrant Halloween. Halloween s'impose dès lors et tout à la fois comme le film qui propulsera le genre, en écrira les grandes lignes directrices et en deviendra l'éternelle référence. Rien que ça, beaucoup pour ce qui n'est "qu'un" troisième film. Pourtant, Halloween ne fait pas dans l'originalité : s'inspirant de Bava, il lorgne également beaucoup vers Black Christmas, un petit film canadien sorti quatre ans plus tôt, en 74 (Bob Clark, l'homme de Le Mort Vivant). Là où le film tire son épingle du jeu et fera s'ébranler le cinéma d'horreur, c'est avant tout par les coups de surin d'un certain Michael Myers. Un masque blanc inexpressif, un mutisme à toute épreuve, une démarche lente et inexorable, un grand couteau de cuisine... Michael Myers fait figure de requin silencieux et implacable, surgissant lorsque l'on s'y attends le moins et disparaissant à sa guise, nouant ainsi avec une veine fantastique bien à propos. Carpenter créé là un tueur qui deviendra culte, dont le look fera fureur et qui bien entendu entrera dans la grande famille des boogeymens. Leçon de mise en scène et thématiques qui deviendront clichés, Halloween suit également une sorte de code d'honneur, où le tueur, devenu croquemitaine et châtieur, s'en prend à des jeunes aux moeurs légères. Une tendance que l'on retrouvera tout le long de la mouvance, caricaturée dans Scream ou exploitée jusqu'à l'outrance dans les Vendredi 13, où Jason trucide dès que ça commence à forniquer. Le film d'horreur à croquemitaines, du moins tel qu'il est développé par les Américains, sert alors de parabole à l'encontre des écarts de conduite : fumez de la drogue, picolez, baisez, vous finirez avec un couteau dans le bide, tel est le message. A l'inverse, la pucelle prude aura toute les chances de s'en sortir indemne.
Du reste, malgré son influence monstrueuse, il faut avouer qu'Halloween a particulièrement mal vieilli. Plutôt daté, distribué chez nous en version francisée, ce qui n'arrange rien (le tueur se voit ainsi rebaptisé d'un fringant "Michel Meyer"...), le film ne se regarde plus que d'un oeil. Ce qui devait probablement être un joli morceau de suspense et de suggestif à sa sortie n'empêche aujourd'hui plus le bâillement. Dommage. Halloween est pourtant bien devenu un film culte et est indéniablement une pierre blanche dans l'histoire du cinéma d'horreur, ainsi que pour Jamie Lee Curtis, qui deviendra alors la Scream Queen qui monte.
Du reste, Halloween fait toujours partie des plus grands succès de John Carpenter. De son tueur, dont la franchise s'instaurera réellement fin 80, début années 90, le réalisateur ne s'occupera plus, si l'on excepte le deuxième, où il doit recoller les morceaux laissés par Rick Rosenthal (également réalisateur d'Halloween Resurrection, le huitième). Un épisode pas plus mauvais que le premier, au demeurant, pour ce qui deviendra une série de bientôt neuf aventures de qualité plutôt variable.
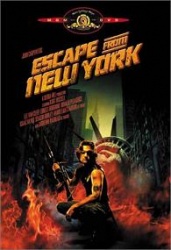
New York 1997Trois films et John Carpenter impose déjà ce qui deviendra sa marque de fabrique. Un style rugueux, implacable, surplombé par d'étranges accords qu'il assure le plus souvent lui même. Il s'impose tel un homme orchestre, il fait tout, contrôle tout, de la musique aux effets spéciaux. L'hémoglobine à outrance, il s'en passe, le démonstratif, ça ne l'intéresse pas. Son cinéma a un aspect minéral et brut où vient de lover une ambiance et une tension qu'il saura toujours développer comme personne. Le début des années 80 marquera une période phare pour le réalisateur qui enchaînera respectivement en 1980, 1981 et 1982 trois des films les plus marquants de sa carrière. Fog pour commencer. Ce film de fantômes, angoissant et lent, marque la rencontre de Carpenter avec son égérie, Adrienne Barbeau. Mais c'est surtout en 82 qu'apparaîtra son nouveau coup de maître : New York 1997 (Escape from New York).
Peu de films auront révolutionné la Science Fiction, au point parfois de devenir la référence d'un genre à part entière. Star Wars, Mad Max, Alien aussi. New York 1997 bien que nantit d'un budget plutôt serré, est de ceux-là. Défilé de tronches et de pointures (Kurt Russell, Ernest Borgnine, Donald Pleasance, Isaac Hayes, Lee Van Cleef et son regard d'acier) et surtout, un anti-héros devenue grande figure populaire du cinéma : Snake Plissken, le renégat borgne, envoyé contre son gré dans la gigantesque cité-prison qu'est devenu New York à la recherche du Président. Par la suite souvent imité, l'Italie se jeta bien entendu sur le concept, n'hésitant pas parfois à mélanger des références avec du Terminator ou du Mad Max pour amoindrir les plagiats. Film culte mais film sombre, New Yotk 1997 décrit une démocratie à la limite du totalitarisme, un monde violent où la racaille est livrée à elle même dans les pénitenciers immenses, sorte de Cour des Miracles des temps modernes. Qui est vraiment prisonnier, qui est du bon côté du mur ? Western futuriste désabusé, se fendant d'humour assez froid, de petites phrases cultes, New York 1997 a fait date et sert toujours de référence. Dernier exemple ? Le jeu vidéo adapté des Chroniques de Riddick, dont la vidéo d'introduction enchaîne les clins d'oeils.
Puis arrive 1983, l'année du malentendu. L'apothéose pour beaucoup, et 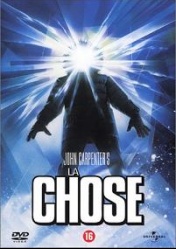
certainement le début de la crise. En 1983 deux films se partagent le box office, E.T., de Steven Spielberg et celui qui nous intéresse présentement, The Thing, de John Carpenter. Le premier est une gentille parabole sur le racisme, avec un extraterrestre à bonne bouille, l'autre est un film à bestioles innommables, pessimiste et glacé. Antithèses parfaites, la renommée du Spielberg, plus familial, va enterrer The Thing au Box Office. Pire, par comparaison, The Thing est taxé des pires tares par son explicisme et de machisme par son absence de femmes. En première ligne, Carpenter n'en sortira pas grandi.
Remake de La Chose d'un autre Monde, d'Howard Hawks, The Thing marquera finalement une date dans l'horreur, ne serait-ce que par ses impressionnants effets spéciaux signés Rob Bottin et s'impose tel un pur film de trouille, nerveux, pessimiste et diablement efficace. Assistant de Rick Baker (Le loup garou de Londres), Rob Bottin deviendra comme son mentor une légende des effets spéciaux et maquillages, à qui l'on doit les beaux lycanthropes de Hurlements, de Joe Dante. Pour The Thing, Bottin signe une créature qui effectivement est une chose, qui ne ressemble à rien, enchevêtrement d'animal, d'humain, voir d'insecte semblant sortir tout droit d'un bouquin de Lovecraft. La chose de The Thing est en osmose avec le film : fascinante mais trouble et incertaine. Une grande réussite. Film paranoïaque, noir, violent et bénéficiant d'un climat psychologique tendu, The Thing égraine une poignée de scènes à s'en bouffer les ongles, celle du test sanguin étant sans doute à compter parmi les plus grand moment de flippe.
The Thing avait tout pour réussir : un réalisateur qui monte, des effets spéciaux extraordinaire, une interprétation sans failles, le coup de pouce d'un grand studio... malgré tout, le film, premier film studio de Carpenter qui signait ici chez Universal, fit un beau bide et n'enchanta ni les critiques, ni le public. Trop sanglant, trop désespéré... en face, c'est Spielberg et ET, rappelons-le, et The Thing fait office de mouton noir. Aujourd'hui bien sûr, le film est adulé et repompé dans tous les sens. Encore récemment, Sean Cunningham, porté disparu depuis 1989, faisait son retour avec Terminal Invasion, où un aéroport enneigé est la proie d'aliens polymorphes... Nom d'une doudoune, voilà qui me rappelle quelque chose !
Sans être traîné dans la boue, Carpenter avec ce film se prend tout de même une sacrée claque, certaines critiques allant jusqu'à le taxer de pornographe. Il faut dire que pour une fois, sans être gore, le réalisateur use agréablement du pot de vermillon. Echaudé, Carpenter va s'écarter de l'horreur, un temps. Il rencontre bien Stephen King pour l'adaptation de Christine, mais sans davantage de succès. De ce roman, il faut bien le dire, plutôt mineur dans l'oeuvre de King, Carpenter signe un film fantastique qui certes ne marquera pas grand chose, mais s'avère envoûtant et efficace, puisant toute sa force dans l'aura malfaisante de l'auto hantée. Effets spéciaux agréables, acteurs convaincants, un joli suspens et au final, un petit classique hautement fréquentable. A mon sens parmi les meilleures adaptations de King. Christine a toutefois le luxe d'être présenté à Avoriaz et sa voiture, exposée au public. Cette voiture aux allures de vamp, séductrice puis croqueuse d'hommes, qui finalement porte tout le film. A la fin du festival, on en retrouva une poignée cassée. La légende veut que le responsable soit un certain Jean-Pierre Putters, mais chut, il ne faut pas l'ébruiter...
Après Christine, Carpenter tourne donc la page pour de bon ou presque. C'est à ce moment qu'il réalisera Starman et les Aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin (Big Trouble in Little China), qui ne fait pas vraiment salles combles non plus. Nous sommes en 86, et Carpenter qui est l'un des rares Européen à avoir vu Legend of Zu, rend avec Jack Burton un joli hommage à Tsui Hark bien avant que ça ne devienne tendance de le faire.
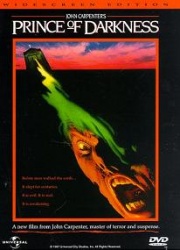
Prince des ténèbresEn 1987, un John Carpenter que l'on croyait détaché du giron horrifique y reviendra pourtant à grands pas, en s'intéressant aux forces occultes. Et pour parler de démons, quoi de mieux que de vendre son âme au diable ? A cette époque, le réalisateur, découragé de ses flops signe un contrat avec Alive Film, petite filiale de la géante Universal. Le premier fruit de cette collaboration, doté comme de bien entendu d'un budget grotesque de 3 millions de $, reste à mon sens son film fantastique le plus abouti, le plus sombre et forcément, le plus beau. Avec l'Antre de la Folie, pour moi le chef d'oeuvre de Carpenter : Prince des Ténèbres. D'une noirceur abyssale, Prince des Ténèbres narre les études d'un groupe de chercheurs, qui, retranchés dans une église, analysent un récipient de liquide verdâtre qui pourrait bien être l'Antéchrist. Pendant qu'au dehors, le chaos commence... Désespéré, lent, oppressant, Prince des Ténèbres rappelle tour à tour La Nuit des Morts Vivants et l'Exorciste, tout en ayant une personnalité propre. Carpenter, habitué à ne pas faire de chichis dans sa mise en scène, nous livre un film dur et âpre, sans réels héros, dont on devine aisément que l'issue ne sentira pas vraiment la happy end. Totalement dénué d'humour, violent, pessimiste à souhait, voir parfois onirique, Prince des Ténèbres lorgne vers les univers d'un Lovecraft, terrifiants et diablement obsédants. Au casting, l'incontournable Donald Pleasance en prêtre désabusé et l'inattendu chanteur Alice Cooper en clochard possédé font merveille. Une perle.
1988, toujours chez Alive Film, Carpenter reviendra sans crier gare à la Science-Fiction, toutefois mâtinée d'horreur, avec un de ses films les plus engagés. Nous sommes donc en 1988, soit un an avant que Ronald Reagan ne laisse la présidence à George Bush Senior. De Reagan, dont les analystes se plaisent dorénavant à comparer la politique avec l'actuelle de George Bush Jr, on se rappellera un farouche combattant du communisme, allant jusqu'à baptiser en 1985 l'URSS "d'Empire du Mal". Reagan c'est aussi l'homme qui lança son pays dans la course aux armements, saigna l'URSS aux quatre veines et qui finalement donna à l'Amérique cette image de rempart défenseur du Monde Libre. Bien entendu, le cinéma sous Reagan s'est laissé aller à toutes sortes de films réacs plus ou moins niais. C'est les grandes années de la firme Cannon, surtout connue pour avoir fait de Charles Bronson un ringard fini. Et de son leader, Menahem Golan, qui que ce soit du côté réalisation ou production nous lâches des Delta Force ou des Invasion USA , nanars affligeants de patriotisme où le Chuck Norris national botte le cul de terroristes basanés tendance Rouge. Bref, l'Amérique est grande, l'Amérique est forte, l'Amérique est immortelle, sans reproches et les Américains sont tranquilles dans leurs cocons. Sauf que Carpenter dit non. Il y a quelques choses de pourri au royaume de la Liberté, et le réalisateur entend bien le dévoiler. Son "J'accuse" se nomme Invasion Los Angeles, They Live en Vo. Un film où un modeste ouvrier qui croit en son pays en découvrira la face cachée et prendra les armes pour tenter de le libérer. Dans les publicités, les journaux, des messages de propagandes ou de bonne moeurs apparaissent aux yeux d'une poignée de résistants qui ont ouvert les yeux sur l'ordre établi, ou plutôt les ont couvert de filtres spéciaux. Si les lunettes roses permettent en voir la vie comme telle, celle de Carpenter la font apparaître plutôt noire. "Obéit", "soit fécond", toute une critique de la société de consommation et de l'avilissement renvoyant aux meilleures années de Romero. Rappelant parfois l'Invasion des Profanateurs de Sépultures de Don Siegel (où il n'est d'ailleurs jamais question de profanateurs de sépultures...), Carpenter adapte ici à sa sauce une petite nouvelle de Ray Nelson écrite dans les années 60 et en sort un film en tout point culte, où surnage ses passions. Tapant sur la politique en vogue, Invasion Los Angeles est également un pur Western urbain, faisant apparaître le héros John Nada, dont le patronyme signifie "rien", tel un laissé pour compte, mais aussi comme une sorte de cow-boy sans nom, qui comme dans les bons vieux Leone, vient, constate, agit, et repart. Pur divertissement mâtiné de revendications, Invasion Los Angeles est un peu le Zombie - Dawn of the Dead de Carpenter. Dommage qu'il n'aura pas le même impact que le Romero. Invasion Los Angeles, toujours réalisé pour une bouchée de pain, marque la fin du contrat avec Alive Film. De là, plus grand chose, et Carpenter va prendre quelques vacances, le temps de recharger ses colts de despérado du cinéma.
Il ne réapparaîtra que timidement en 1992, avec Les Aventures d'un Homme Invisible. Variation autour d'un thème surexploité, Les Aventures d'un Homme Invisible est un film sympa et agréable, mais plutôt mineur malgré quelques bonnes idées développant le sujet. Le Carpenter tel qu'on l'aime reviendra réellement en 1994 avec le sublime l'Antre de la Folie, l'un de ses meilleurs films. Faisant la part belle aux hommages à King et, surtout, à Lovecraft, l'Antre de la Folie est une descente aux enfers, effrayante, à l'ambiance aliénée et au bestiaire monstrueux. Jamais un film n'aura tant mérité son titre : l'Antre de la folie, cauchemardesque à souhait, est une véritable plongée dans un univers inquiétant où le spectateur ne sait plus quoi penser. La présence trouble de Sam Neil, tout simplement monumental, est la petite touche qui fait grimper le film au firmament des pièces incontournables du cinéma. Pour beaucoup point d'orgue de son oeuvre, Carpenter va loin, très loin avec son Antre de la Folie, dans un film à l'accès difficile mais qui ne laisse pas indemne, devenue une référence du cinéma fantastique et l'une des meilleures digressions autour de l'univers du Père de Cthulhu.
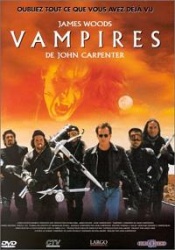
1995 est l'année d'un remake : Le Village des Damnés, film de Wolf Rilla tourné en 1960, dont le style de réalisation, en y regardant de plus prêt, rappelle effectivement certain tics de Carpenter. 1996, pas grand chose non plus à se mettre sous la dent avec Los Angeles 2013, séquelle-remake de son New York 1997. Envoyé sur l'ile-prison de Los Angeles sans qu'on lui en laisse trop le choix, Snake Plissken doit cette fois-ci ramener la fille du Président, non sans avoir coller une paire de baffes à son nouveau boyfriend, le Che Guevara local. Western urbain nihiliste, Los Angeles 2013 va de l'intéressant au jouissif sans toutefois s'élever plus haut que son prédécesseur qui, disons le tout net, se suffisait largement à lui même. Reste que ce n'était assurément pas le but, le plaisir de revoir ce vieux truand de Snake Plissken, la présence de la décidément belle Pam Grier et la fin, ultime pied de nez ramenant à la noirceur de son modèle. C'est en 1998 que Carpenter va à nouveau se lâcher avec l'excellent Vampires.
Vampires suit le courant amorcé par des films tels que Les Prédateurs, Génération Perdue ou Aux Frontières de l'Aube, visant à faire entrer le mythe dans la modernité. Ici, les vampires ne sont pas de suaves créatures distinguées, dignes successeurs d'Anne Rice ou de Bram Stoker, mais des monstres impies, crades et sans codes d'honneur, aux allures de truands ou de bikers. Aride et poussiéreux, le film de Carpenter prend plus que jamais des allures de Western. Face aux vampires en cuir noir, une équipe d'anti-héros chargée par le Vatican de les envoyer ad-patres. Buffy ? Que nenni. Pas ou peu de femmes. Des hommes qui ont la gâchette facile, l'humour gras et la fuck you attitude d'un trompe la mort. Un film brut aux odeurs de sueur et le sang, intemporel et désespéré. So long, Cow Boy... Vampires, en outre d'être une leçon de mise en scène, reste également le film le plus gore qu'est fait Carpenter : un homme se fait trancher en deux dans le sens de la longueur, un prêtre repeint les murs avec son cerveau... Un choix qui surprend de la part de ce réalisateur qui a toujours privilégié les ambiances et la violence pure au Grand Guignol.
Et maintenant, que devient-il, notre John Carpenter ? Après Ghosts of Mars en 2001, qui aurait pu s'appeler Assaut sur Mars, Carpenter ne donne plus signe de quoi que ce soit. Au fil de ses derniers films, il annonce sa retraite, encore et encore. Peut-être est-ce pour de bon, à présent ? De lui n'émane plus que quelques productions pas bien glorieuses : citons Vampires 2 avec Jon Bon Jovi (rires), de Tommy Lee Wallace, bon faiseur de série B qui signa le curieux Halloween 3. Malgré ce qu'il pense de sa propre carrière, Carpenter est devenu un réalisateur de légende, adulé par des millions de fans. Sa conception du cinéma, sèche, référentielle, parfois engagée et sans fioritures en a fait un auteur à part entière. Il aura su donner de purs divertissements, tels que Jack Burton ou Los Angeles 2013, varier les genres et offrir une filmographie certes hétéroclite, mais gavée de pièces maîtresses dont le cinéma ne s'est jamais remis. John Carpenter c'est aussi l'osmose avec des acteurs fétiches qui n'auront jamais été aussi bons que sous sa caméra. Donald Pleasance bien sur, mais surtout Kurt Russell. De The Thing à Los Angeles 2013 en passant par Jack Burton, Kurt Russell qui n'est pas à proprement parler un play-boy d'Hollywood aura su donner corps à une poignée de personnages cultes et surtout, par sa prestation nonchalante, rendre immortel Snake Plissken. Carpenter n'aura pas toujours le succès mais ses bébés, ses monstres pourrait-on dire, restent gravés quelque part et attendent là, tapis quelque part entre l'ombre et la lumière : Vampires figure toujours au top des fans de films de vampires. Il est toujours bon ton pour un anti-héros de prendre des airs à la Snake Plissken. Le slasher ne s'affranchit toujours pas d'Halloween...

Filmographie de John Carpenter
Ghosts of Mars (2001)
Vampires (1997)
Los Angeles 2013 (Escape from L.A.) (1996)
L' Antre de la folie (In the Mouth of Madness) (1995)
Le Village des damnés (Village of the Damned) (1995)
Body Bags (1993)
Les Aventures d'un homme invisible (Memoirs of an Invisible Man) (1992)
Invasion Los Angeles (They live) (1988)
Prince des ténèbres (Prince of Darkness) (1987)
Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin (Big trouble in Little China) (1986)
Starman (1985)
Christine (1983)
The Thing (1982)
New York 1997 (Escape from New York 1997) (1981)
Fog (The Fog) (1980)
Halloween, La Nuit des masques (Halloween) (1978)
Le Roman d'Elvis (Elvis, The Movie) (1978)
Assaut (Assault on precinct 13) (1976)
Dark Star (1974)